
****
Nouveau mais sans doute pas aussi novateur qu'annoncé, Winter's bone, deuxième long métrage de Debra Granik (le premier à parvenir jusqu'à nos écrans), fait preuve d'une belle solidité. Les hasards de la distribution faisant parfois bien les choses, le film est sorti une semaine après True grit, avec qui il entretient bien des rapports. Dans un étrange paysage hivernal, une jeune héroïne tenace se lance dans une quête, liée à l'absence du père, qui va lui faire côtoyer les frontières de la mort : ce résumé est recevable dans les deux cas. Cependant, si tout le monde a trouvé à peu près les mêmes choses dans le dernier opus en date des frères Coen, les jugements ne se singularisant finalement que par la position donnée au film par rapport au genre, au True grit original d'Hathaway ou à la filmographie des auteurs, Winter's bone a suscité des commentaires plus divers, chacun semblant y déceler des idées et des références qui ne frappent pas particulièrement les autres (le fait que nous découvrions totalement le cinéma de Debra Granik y est probablement pour quelque chose). Ainsi, le film peut ne pas ressembler à l'idée que l'on s'en était fait avant la projection. Par exemple, pour ma part, je n'y ai guère trouvé de fantastique, et si une certaine parenté avec Délivrance peut être facilement repérée, d'une part, elle ne parcourt le film de Granik que d'une façon relativement superficielle et d'autre part, ce rapprochement avec le chef d'œuvre de Boorman ne rend pas bien compte de la réalité de Winter's bone ni ne lui rend vraiment service.
Il n'y a pas, ici, de voyage linéaire au bout de la nuit. Certes la jeune Ree va évoluer et effectuer un passage en arpentant un territoire géographique que la mise en scène s'efforce de transformer en paysage mental (et elle y parvient). Mais ses déplacements, effectués essentiellement à pied, ne l'amènent pas bien loin, les distances étant de plus escamotées par le découpage. Les rencontres qu'elle fait n'impliquent pas des personnes totalement inconnues, et pour cause : dans cette région, tout le monde semble appartenir à la même famille. Ree en appelle d'ailleurs sans cesse aux liens du sang pour essayer d'arracher les informations qu'elle demande à ses interlocuteurs. Mais l'idée de famille est à considérer également dans un autre sens, renforçant encore la sensation d'oppression déjà distillée, celui du groupe de trafiquants, voire de criminels, cercle dont le tracé épouse assez précisément celui du premier, généalogique.
Aux codes stricts propres à ces communautés confondues, s'ajoute le maillage mis en place par la cinéaste. Les abords des maisons sont encombrés de ferrailles et les intérieurs sont exigus. L'image est quadrillée par les bois, les arbres et leurs ramifications, les clôtures et les portails, les murs du centre social et les enclos de la foire aux bestiaux, toutes choses qui entravent. On comprend dès lors que le rite de passage nécessite l'usage d'une tronçonneuse. Violentée, Ree reprend ses esprits et s'aperçoit qu'elle est entourée de plusieurs individus menaçants, leur nombre paraissant excessif par rapport au but recherché qui est d'intimider une fille sans défense. La mise en scène, qui table sur la proximité des corps soumis au regard de la caméra, trouve sa cohérence et son efficacité.
Le prétexte à la fiction est des plus simples : Ree doit retrouver la trace de son père disparu quelques jours auparavant, sous peine de voir la maison familiale saisie, sa mère malade, son frère, sa sœur et elle-même mis à la porte par la justice. L'univers du conte pointe son nez mais le film n'y verse pas explicitement (on retient tout de même le moment où Ree est invitée à franchir le fil de fer barbelé afin de s'enfoncer dans la forêt). Le parcours initiatique débute classiquement, en envoyant l'héroïne d'un point à l'autre, ce qui fait naître la crainte de la répétition sur la longueur mais la progression ne se fait pas comme prévu. Des pistes aboutissent sur rien, la boîte de vitesse est souvent remise au point mort, Ree revient régulièrement dans sa maison sans plus de certitudes. Le fil narratif en général prolonge ce qui fonde, au niveau inférieur, la mise en scène, soit une succession de plans-cellules, choix très contemporain d'une avancée par bribes, d'une alternance de séquences plus ou moins opérantes, plus ou moins signifiantes, plus ou moins déterminantes par rapport au drame raconté. La question de la vie ou de la mort du père est rapidement tranchée, en plein milieu du film, ce qui provoque une césure. Si l'enjeu reste le même, la problématique est déplacée. Scindée en deux, l'œuvre tient tout de même debout, comme la protagoniste principale. Elle gagne même en intensité, dévoilant une mécanique plus serrée qu'il n'y paraissait. Les rapports et les regards portés sur certains personnages évoluent et la nécessité de quelques séquences s'affirme a posteriori, qu'il s'agisse des premières rencontres ponctuées régulièrement par un regain de tension ou de celle du dépeçage de l'écureuil appelée à résonner vers la fin, lors du moment le plus marquant du film. A cet endroit, j'émettrai d'ailleurs une petite réserve, car il me semble qu'il manque un plan à cette séquence. Un plan sur une (ou deux) main(s). Debra Granik nous le refuse et je ne suis pas certain qu'elle ait eu raison de rester si prudente dans son cadrage. Donner à voir cet élément macabre aurait rendu, à mon sens, l'initiation plus "complète". Ce détail ne m'empêche toutefois pas de vous recommander le film.
 WINTER'S BONE
WINTER'S BONE
de Debra Granik
(Etats-Unis / 100 mn / 2010)

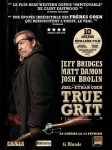 TRUE GRIT
TRUE GRIT
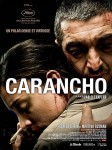 CARANCHO
CARANCHO
 INCENDIES
INCENDIES
 BLACK SWAN
BLACK SWAN

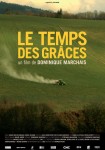 LE TEMPS DES GRÂCES
LE TEMPS DES GRÂCES
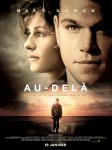 AU-DELÀ (Hereafter)
AU-DELÀ (Hereafter)
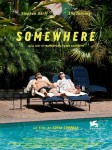 SOMEWHERE
SOMEWHERE
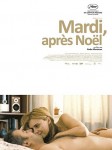 MARDI, APRÈS NOËL (Marti, dupa craciun)
MARDI, APRÈS NOËL (Marti, dupa craciun)
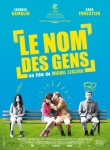 LE NOM DES GENS
LE NOM DES GENS