(Masahiro Shinoda / Japon / 1969)
■□□□
 Quatrième et dernier film de cette série Shinoda, où l'on voit malheureusement qu'indépendance et radicalité ne sont pas forcément synonymes d'extase. A la fin des années 60, le cinéaste avait quitté la célèbre maison de production de la Shochiku. L'une de ses premières réalisations hors-système est ce Double suicide à Amijima (Shinju ten no Amijima), tiré d'une pièce du dramaturge Monzaemon Chikamatsu, grand écrivain de théâtre de marionnettes et de kabuki de la fin du XVIIe siècle. Lassé d'oeuvrer dans des genres bien définis comme le film noir ou le film de sabre, Shinoda décida de partir dans l'expérimentation en adaptant ce récit. Le générique s'égrène au fil des préparatifs pour un spectacle de marionnettes. Dans un style documentaire, on voit s'affairer les artistes dans les coulisses : préparation des costumes et des accessoires et habillage dans des tenues entièrement noires pour les manipulateurs qui auront à se fondre dans le décor de la scène. Parmi eux, Masahiro Shinoda lui-même, en conversation téléphonique avec sa scénariste, s'inquiète de l'avancement de l'histoire et évoque quelques choix de mise en scène (que l'on découvrira effectivement plus tard).
Quatrième et dernier film de cette série Shinoda, où l'on voit malheureusement qu'indépendance et radicalité ne sont pas forcément synonymes d'extase. A la fin des années 60, le cinéaste avait quitté la célèbre maison de production de la Shochiku. L'une de ses premières réalisations hors-système est ce Double suicide à Amijima (Shinju ten no Amijima), tiré d'une pièce du dramaturge Monzaemon Chikamatsu, grand écrivain de théâtre de marionnettes et de kabuki de la fin du XVIIe siècle. Lassé d'oeuvrer dans des genres bien définis comme le film noir ou le film de sabre, Shinoda décida de partir dans l'expérimentation en adaptant ce récit. Le générique s'égrène au fil des préparatifs pour un spectacle de marionnettes. Dans un style documentaire, on voit s'affairer les artistes dans les coulisses : préparation des costumes et des accessoires et habillage dans des tenues entièrement noires pour les manipulateurs qui auront à se fondre dans le décor de la scène. Parmi eux, Masahiro Shinoda lui-même, en conversation téléphonique avec sa scénariste, s'inquiète de l'avancement de l'histoire et évoque quelques choix de mise en scène (que l'on découvrira effectivement plus tard).
Le récit à proprement parler peut ensuite démarrer. C'est celui du couple illégitime que forment Jihei, un riche marchand marié à sa cousine, et Koharu, une courtisane. Amoureux fous, ils se disent prêts à mourir ensemble. Le scandale grossit et la famille vient briser les derniers espoirs de rachat de Koharu par Jihei, malgré la compréhension de sa femme. Ne reste plus alors aux amants qu'à s'enfuir pour se suicider. Toute l'introduction dans la maison de geishas poursuit la mise à distance qu'imposait le générique. Les décors sont simplifiés jusqu'à l'abstraction; dessins et écritures emplissent murs et sols (on pense beaucoup, pour prendre une référence contemporaine au Dogvillede Lars Von Trier). Les personnages peuvent d'un coup se figer, comme manipulés par le metteur en scène et les hommes en noir du théâtre sont là. Ils observent, attendent silencieusement, puis changent le décor, tendent un accessoire aux protagonistes-marionnettes qui, bien sûr, ne les voient pas. Le décalage ainsi obtenu avec le jeu très théâtral des acteurs du drame, la stylisation extrême et quelques visions érotiques fulgurantes font de cette première partie un moment très intrigant.
Seulement, au fur et à mesure, les procédés distanciateurs s'effacent, ne laissant plus à l'écran qu'une captation de pièce somme toute assez classique. De longs plans séquences nous confinent dans deux ou trois lieux et n'offrent plus qu'un unique degré de lecture (hormis de trop brefs moments, tel ce saccage de la maison par Jihei qui devient changement de décor). Le récit se met à patiner et le spectacle des pleurs incessants, des déclarations implorantes et des atermoiements des personnages devient fatigant. La fuite du couple, si elle ne nous épargne pas non plus ces tergiversations larmoyantes, a le mérite d'élargir le cadre. Une étonnante dernière scène d'amour dans un cimetière se déroule sous les yeux d'un marionnettiste et son regard indéchiffrable dirigé vers ses créatures enlacées nous fait retrouver un instant la distanciation et le trouble de la première partie.
Comme dans les trois autres films dont il a été question ces derniers jours, on sent derrière la caméra la présence d'un metteur en scène assez virtuose, passionné, extrêmement cultivé. Shinoda aime à gorger ses oeuvres de réflexions très poussées sur la société japonaise, l'histoire, la politique ou le théâtre. Vu d'ici et maintenant, leur complexité en est parfois rebutante. Il me semble que c'est lorsque le discours du cinéaste ne surplombe pas tout, mais qu'il se diffuse simplement au travers d'un scénario de genre, que la réussite est au bout du chemin (soit, indéniablement : Fleur pâle et La guerre des espions).
 Troisième temps de mon périple chez Masahiro Shinoda. Si Assassinat ployait quelque peu sous le poids de la politique, La guerre des espions (Ibun Sarutobi Sasuke) doit sa réussite au fait qu'il soit d'abord une enthousiasmante variation sur un genre avant de distiller ses réflexions.
Troisième temps de mon périple chez Masahiro Shinoda. Si Assassinat ployait quelque peu sous le poids de la politique, La guerre des espions (Ibun Sarutobi Sasuke) doit sa réussite au fait qu'il soit d'abord une enthousiasmante variation sur un genre avant de distiller ses réflexions. Deuxième étape de ma visite chez Masahiro Shinoda : Assassinat (Ansatsu).
Deuxième étape de ma visite chez Masahiro Shinoda : Assassinat (Ansatsu). Plaisir de la découverte. Voici la première des quatre galettes d'un coffret dvd consacré au cinéaste japonais Masahiro Shinoda, qui m'était jusque là parfaitement inconnu. L'homme, né en 1931 et ayant signé en 2003 son trente-deuxième long-métrage, a débuté en 1960, soit au moment où le cinéma mondial commençait à bouger dans tous les sens. Shinoda appartient donc à la Nouvelle Vague japonaise et Fleur pâle (Kawaita hana) prend place dans ce mouvement grâce à, au moins, deux caractéristiques : un fort sentiment de vie rendu par le plaisir communicatif de filmer les rues et, conjointement, un désir d'expérimentation esthétique.
Plaisir de la découverte. Voici la première des quatre galettes d'un coffret dvd consacré au cinéaste japonais Masahiro Shinoda, qui m'était jusque là parfaitement inconnu. L'homme, né en 1931 et ayant signé en 2003 son trente-deuxième long-métrage, a débuté en 1960, soit au moment où le cinéma mondial commençait à bouger dans tous les sens. Shinoda appartient donc à la Nouvelle Vague japonaise et Fleur pâle (Kawaita hana) prend place dans ce mouvement grâce à, au moins, deux caractéristiques : un fort sentiment de vie rendu par le plaisir communicatif de filmer les rues et, conjointement, un désir d'expérimentation esthétique. Voici ma première rencontre, longtemps attendue, avec Roger Corman. Ses propres films étant peu diffusés, son nom semble aujourd'hui évoquer plus un type de production et un statut de "parrain" de jeunes talents qui débutèrent chez lui (Scorsese, Coppola, Hellman, Demme, Dante...) qu'une oeuvre de cinéaste. Celle-ci est pourtant pléthorique, comptant plus de cinquante longs-métrages de 1955 à 1971 (puis plus une seule mise en scène jusqu'à un Frankenstein, en 1990). Comme l'ensemble de ses productions, l'éclectisme caractérise ces films : westerns, policiers, musicals. Toutefois, sa réputation s'est faîte essentiellement sur le fantastique. Sur ce point, parmi bien d'autres, son aventure peut se comparer à celle des productions Hammer qui faisaient dans le même temps les beaux jours du cinéma britannique.
Voici ma première rencontre, longtemps attendue, avec Roger Corman. Ses propres films étant peu diffusés, son nom semble aujourd'hui évoquer plus un type de production et un statut de "parrain" de jeunes talents qui débutèrent chez lui (Scorsese, Coppola, Hellman, Demme, Dante...) qu'une oeuvre de cinéaste. Celle-ci est pourtant pléthorique, comptant plus de cinquante longs-métrages de 1955 à 1971 (puis plus une seule mise en scène jusqu'à un Frankenstein, en 1990). Comme l'ensemble de ses productions, l'éclectisme caractérise ces films : westerns, policiers, musicals. Toutefois, sa réputation s'est faîte essentiellement sur le fantastique. Sur ce point, parmi bien d'autres, son aventure peut se comparer à celle des productions Hammer qui faisaient dans le même temps les beaux jours du cinéma britannique. Un bon Aldrich, auquel le scénario de Dalton Trumbo donne un air de tragédie classique. Bren O'Malley (Kirk Douglas) arrive dans le ranch mexicain de son ancienne maîtresse Belle Breckenridge (Dorothy Malone), mariée à un éleveur qui a déjà un pied dans la tombe (Joseph Cotten). O'Malley est poursuivi depuis la frontière par Stribling (Rock Hudson) qui veut le livrer à la justice pour le meurtre de son beau-frère et la mort indirecte de sa soeur. Ils se retrouvent et, suite à leur embauche par Breckenridge pour convoyer, tous ensemble, ses 1000 têtes de bétail jusqu'au Texas, ils passent un accord : une fois passés en Amérique, ils régleront leurs comptes. Aux dangers extérieurs attendus (bandits, indiens...) pendant le périple, s'ajoute la complication des relations dans le petit groupe qui inclut Belle et sa fille Melissa (Carol Lynley), autour desquelles tournent les deux hommes. Leur estime mutuelle naissante n'empêchera pas l'affrontement final au coucher du soleil.
Un bon Aldrich, auquel le scénario de Dalton Trumbo donne un air de tragédie classique. Bren O'Malley (Kirk Douglas) arrive dans le ranch mexicain de son ancienne maîtresse Belle Breckenridge (Dorothy Malone), mariée à un éleveur qui a déjà un pied dans la tombe (Joseph Cotten). O'Malley est poursuivi depuis la frontière par Stribling (Rock Hudson) qui veut le livrer à la justice pour le meurtre de son beau-frère et la mort indirecte de sa soeur. Ils se retrouvent et, suite à leur embauche par Breckenridge pour convoyer, tous ensemble, ses 1000 têtes de bétail jusqu'au Texas, ils passent un accord : une fois passés en Amérique, ils régleront leurs comptes. Aux dangers extérieurs attendus (bandits, indiens...) pendant le périple, s'ajoute la complication des relations dans le petit groupe qui inclut Belle et sa fille Melissa (Carol Lynley), autour desquelles tournent les deux hommes. Leur estime mutuelle naissante n'empêchera pas l'affrontement final au coucher du soleil. Jean-Paul Rappeneau a raconté à la radio, il y a quelque temps, une anecdote intéressante. Ayant terminé La vie de château, il avait assisté à une projection de son film en compagnie de l'un des grands spécialistes de la comédie italienne (je ne me rappelle plus si il s'agit de Risi, Monicelli ou Comencini). Tout heureux d'avoir si bien réussi son coup, il demanda son avis à l'italien. Celui-ci finit par répondre à peu près ceci : "Oui, c'est pas mal, mais chez nous, les comédies à partir d'événements historiques importants, on fait ça depuis longtemps."
Jean-Paul Rappeneau a raconté à la radio, il y a quelque temps, une anecdote intéressante. Ayant terminé La vie de château, il avait assisté à une projection de son film en compagnie de l'un des grands spécialistes de la comédie italienne (je ne me rappelle plus si il s'agit de Risi, Monicelli ou Comencini). Tout heureux d'avoir si bien réussi son coup, il demanda son avis à l'italien. Celui-ci finit par répondre à peu près ceci : "Oui, c'est pas mal, mais chez nous, les comédies à partir d'événements historiques importants, on fait ça depuis longtemps." Mon chemin, troisième film de Jancso, pose les fondements de son esthétique. La technique commence à s'appuyer sur d'amples plans séquences, figure qui prendra au fil du temps de plus en plus d'importance dans le cinéma du hongrois. Que ceux qui ont déjà souffert devant un film de Bela Tarr ne soient pas effrayés en trouvant dans une même phrase les expressions "plan séquence" et "hongrois". Ici, la sensation du temps est complexifiée, magnifiée par des mouvements d'appareils extraordinaires, par les déplacements des groupes dans le cadre, par la simultanéité d'actions à l'avant et l'arrière-plan. Pas de solennité, ni de confusion. Le terme est parfois utilisé abusivement, mais pas pour Jancso : c'est bien une merveilleuse chorégraphie qui s'offre à nos yeux.
Mon chemin, troisième film de Jancso, pose les fondements de son esthétique. La technique commence à s'appuyer sur d'amples plans séquences, figure qui prendra au fil du temps de plus en plus d'importance dans le cinéma du hongrois. Que ceux qui ont déjà souffert devant un film de Bela Tarr ne soient pas effrayés en trouvant dans une même phrase les expressions "plan séquence" et "hongrois". Ici, la sensation du temps est complexifiée, magnifiée par des mouvements d'appareils extraordinaires, par les déplacements des groupes dans le cadre, par la simultanéité d'actions à l'avant et l'arrière-plan. Pas de solennité, ni de confusion. Le terme est parfois utilisé abusivement, mais pas pour Jancso : c'est bien une merveilleuse chorégraphie qui s'offre à nos yeux. D'un film à l'autre, quelques éléments sont invariables : volonté de traiter une période historique marquante, tournage dans la grande plaine hongroise, goût prononcé pour les nus féminins en mouvement, opposés aux uniformes militaires des hommes. Psaume rouge (prix de la mise en scène à Cannes en 1972) est composé exclusivement de plans séquences (une vingtaine pour une durée totale de 1h20). Sinueux, ils créent sans cesse des figures circulaires, plus précisément d'encerclement, puisqu'il s'agit d'étouffer un mouvement révolutionnaire. Le procédé pourrait être rigide, mais loin de contraindre, l'art de Jancso permet l'éblouissement. Dans ces plans incroyables, la vie entre par n'importe quel côté (chevaux ou individus, que l'on perd et retrouve un instant plus tard) et le mouvement est constant (celui de la caméra est redoublé par celui des personnages, constamment en train de marcher).
D'un film à l'autre, quelques éléments sont invariables : volonté de traiter une période historique marquante, tournage dans la grande plaine hongroise, goût prononcé pour les nus féminins en mouvement, opposés aux uniformes militaires des hommes. Psaume rouge (prix de la mise en scène à Cannes en 1972) est composé exclusivement de plans séquences (une vingtaine pour une durée totale de 1h20). Sinueux, ils créent sans cesse des figures circulaires, plus précisément d'encerclement, puisqu'il s'agit d'étouffer un mouvement révolutionnaire. Le procédé pourrait être rigide, mais loin de contraindre, l'art de Jancso permet l'éblouissement. Dans ces plans incroyables, la vie entre par n'importe quel côté (chevaux ou individus, que l'on perd et retrouve un instant plus tard) et le mouvement est constant (celui de la caméra est redoublé par celui des personnages, constamment en train de marcher). Un crime dans la tête (The Manchurian candidate) est un thriller politique, un étonnant film d'espionnage réalisé avec un regard assez acide. En Corée, des soldats américains sont faits prisonniers. Ils sont manipulés psychologiquement, puis renvoyés chez eux sans souvenirs de l'expérience imposée mais prêts à être à tout moment "dirigés" à leur insu. Le but de l'opération est l'assassinat d'un candidat à la Maison Blanche et son remplacement par un politicien fantoche. Ce film de Frankenheimer est ouvertement anti-communiste. Il ne se résume pas cependant à cette position, car il est tout aussi clairement anti-fasciste. Ce sont bien les deux extrêmes qui sont renvoyés dos à dos. Les allusions au McCarthysme et à ses dérives insupportables sont évidentes. Finalement, c'est au sein même de la bonne société américaine que sont nichés les plus grands ennemis de la démocratie, plus que chez les Rouges à l'étranger.
Un crime dans la tête (The Manchurian candidate) est un thriller politique, un étonnant film d'espionnage réalisé avec un regard assez acide. En Corée, des soldats américains sont faits prisonniers. Ils sont manipulés psychologiquement, puis renvoyés chez eux sans souvenirs de l'expérience imposée mais prêts à être à tout moment "dirigés" à leur insu. Le but de l'opération est l'assassinat d'un candidat à la Maison Blanche et son remplacement par un politicien fantoche. Ce film de Frankenheimer est ouvertement anti-communiste. Il ne se résume pas cependant à cette position, car il est tout aussi clairement anti-fasciste. Ce sont bien les deux extrêmes qui sont renvoyés dos à dos. Les allusions au McCarthysme et à ses dérives insupportables sont évidentes. Finalement, c'est au sein même de la bonne société américaine que sont nichés les plus grands ennemis de la démocratie, plus que chez les Rouges à l'étranger. 7 ans et 6 films plus tard (dont 7 jours en mai et Grand prix), Les parachutistes arrivent (The gypsy moths) s'éloigne considérablement du registre virulent d'Un crime dans la tête, car Frankenheimer entamait là un virage esthétique certain. Les parachutistes en question ne sont pas des militaires mais trois sportifs casse-cous proposant un spectacle itinérant de voltige. Le trio pose ses valises dans un petite ville du Kansas et plus précisément dans la maison de la tante du plus jeune, Malcolm, qui revient ainsi, plus de dix ans après, au pays. Ainsi se fait la chronique de quelques journées pas si tranquilles, tout étant réuni pour que l'arrivée de ces trois saltimbanques mélancoliques perturbent la petite vie de famille bourgeoise bien rangée.
7 ans et 6 films plus tard (dont 7 jours en mai et Grand prix), Les parachutistes arrivent (The gypsy moths) s'éloigne considérablement du registre virulent d'Un crime dans la tête, car Frankenheimer entamait là un virage esthétique certain. Les parachutistes en question ne sont pas des militaires mais trois sportifs casse-cous proposant un spectacle itinérant de voltige. Le trio pose ses valises dans un petite ville du Kansas et plus précisément dans la maison de la tante du plus jeune, Malcolm, qui revient ainsi, plus de dix ans après, au pays. Ainsi se fait la chronique de quelques journées pas si tranquilles, tout étant réuni pour que l'arrivée de ces trois saltimbanques mélancoliques perturbent la petite vie de famille bourgeoise bien rangée.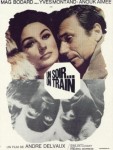 Il est difficile de rendre compte d'Un soir, un train et d'en dégager les mérites sans en déflorer la trame jusqu'à son aboutissement. Je tenterai donc de m'arrêter avant de trop en dire. Mathias (Yves Montand) est professeur de linguistique dans une université flamande. Sans être marié, il vit avec Anne (Anouk Aimée), costumière de théâtre, française un peu perdue dans cette province non-francophone. Le couple semble en crise, atteint par cette maladie bien connue, découverte en Italie au début des années 60 : l'incommunicabilité. Le soir, Mathias doit prendre le train qui l'amènera vers une université voisine où il doit donner une conférence. Il se dispute avec Anne, mais cette dernière finit par revenir vers lui et s'installer dans le même compartiment, juste avant le départ. C'est en plein trajet, après s'être assoupi, qu'un événement semble faire basculer Mathias dans une autre dimension : Anne a disparu, les passagers dorment tous, le train s'arrête puis abandonne Mathias et deux autres personnes dans une campagne qu'ils ne reconnaissent pas. Des flashs d'accident au moment critique et l'omiprésence, dans les minutes précédentes, de la mort sous diverses formes (du sujet de la pièce de théâtre sur laquelle travaille Anne à la visite de Mathias au cimetière), laissent peu de doutes quant à la nature du passage auquel est contraint le héros. Sauf que...
Il est difficile de rendre compte d'Un soir, un train et d'en dégager les mérites sans en déflorer la trame jusqu'à son aboutissement. Je tenterai donc de m'arrêter avant de trop en dire. Mathias (Yves Montand) est professeur de linguistique dans une université flamande. Sans être marié, il vit avec Anne (Anouk Aimée), costumière de théâtre, française un peu perdue dans cette province non-francophone. Le couple semble en crise, atteint par cette maladie bien connue, découverte en Italie au début des années 60 : l'incommunicabilité. Le soir, Mathias doit prendre le train qui l'amènera vers une université voisine où il doit donner une conférence. Il se dispute avec Anne, mais cette dernière finit par revenir vers lui et s'installer dans le même compartiment, juste avant le départ. C'est en plein trajet, après s'être assoupi, qu'un événement semble faire basculer Mathias dans une autre dimension : Anne a disparu, les passagers dorment tous, le train s'arrête puis abandonne Mathias et deux autres personnes dans une campagne qu'ils ne reconnaissent pas. Des flashs d'accident au moment critique et l'omiprésence, dans les minutes précédentes, de la mort sous diverses formes (du sujet de la pièce de théâtre sur laquelle travaille Anne à la visite de Mathias au cimetière), laissent peu de doutes quant à la nature du passage auquel est contraint le héros. Sauf que...