

****/****
Deux films de Jean-Pierre Melville appartenant à deux périodes distinctes de sa carrière. Je viens de découvrir l'un et de revoir l'autre et j'ai du mal à leur trouver un air de famille. Le premier marqua les esprits à l'époque mais il est aujourd'hui bien peu vu et commenté. Le second fait encore référence au fil des rediffusions télévisées, gardant sa place dans la mémoire collective au milieu des grands polars melvilliens qui l'entourent. Pourtant si dissemblables, ils sont finalement, à mon sens, et contrairement à ce que je pensais au départ, de qualité comparable.
Les enfants terribles est vraiment un étrange film, qui peut dérouter aujourd'hui de la même façon qu'il le fit en 1950. Tout d'abord, faute de connaître (Quand tu liras cette lettre, 1953) ou d'avoir revu récemment (Le silence de la mer, 1947) les œuvres qui, avec celle-ci, constituent la première manière du cinéaste, il m'est difficile de faire la part des choses. Dans ce travail à deux, il est en effet plus aisé de repérer les éléments personnels venant du scénariste-adaptateur de son propre roman, Jean Cocteau, que ceux apportés par le réalisateur-producteur, Jean-Pierre Melville, et cela jusque dans le traitement de l'image.
Cette tragique histoire d'un couple frère-sœur dégage un romantisme adolescent vénéneux et fait preuve, à de nombreuses occasions, d'une étonnante cruauté. L'inceste y est absolu mais, bien que le film soit éminemment physique, il ne passe jamais par la sexualité. Il ne faut pas y voir ici de la pudibonderie mais une volonté délibérée des auteurs de se placer sur un autre plan. Il s'agit de tendre vers la folie, via la claustration, le repli.
Quittant peu leur chambre commune sous le toit de leur mère mourante, le frère et la sœur auront rapidement, après avoir changé de territoire, l'idée de la reconstituer à l'identique. Cet éternel retour du décor n'est que l'un des nombreux signes d'irréalité qui déstabilisent, avec bonheur, ce récit. Comme il est dit, Elisabeth accepte les "miracles" sans s'interroger (entre autres ceux d'ordre financier permettant au couple de maintenir leur train de vie), mais c'est tout le monde s'agitant autour de ces deux enfants terribles qui semble hors de la réalité (ou de la normalité des comportements). Tous ceux qui gravitent autour de ce couple sont comme hypnotisés.
Dans ce huis-clos quasi-permanent (les escapades à l'extérieur sont rares, bien qu'importantes), le décalage créé a bien sûr quelque chose à voir avec le théâtre et, de manière très stimulante, cette parenté est tantôt assumée (la scénographie, les entrées et sorties, le très net et très surprenant écho s'entendant lors des échanges dans la "dernière chambre" du château, qui donne une texture sonore directe totalement inattendue...), tantôt dépassée (le découpage vif, les cadrages audacieux, les échelles de plans variables...), de sorte que l'on a l'impression de tirer tous les bénéfices des deux arts. Voilà du théâtre intégrant de beaux morceaux de cinéma.
Certains doivent énormément à Cocteau, en particulier ceux en appelant à l'illusion fantastique (tel ralenti inversé, tel décor en mouvement). Et dans ce film si original en comparaison des productions de l'époque, un autre lien existe, me semble-t-il, avec Orson Welles. Melville a en effet cherché à dynamiser visuellement ce récit en intérieurs en ayant recours à des contre-plongées accentuées, en chargeant ses cadres et en choisissant des angles de prises de vues improbables. Par ailleurs, nous pouvons voir Les enfants terribles en pensant précisément à Citizen Kane : la neige est là, Rosebud aussi, démultiplié (les trèsors conservés dans le tiroir), ainsi que Xanadu (la grande demeure où s'installe, dans la deuxième partie, la sœur puis, bientôt, son frère).
Mais de manière plus étonnante encore, et pour se diriger dans l'autre sens, le film semble annoncer, par plusieurs détails, la Nouvelle Vague (dont les principaux artisans seront globalement bienveillants avec Cocteau et, au moins pour un temps, avec Melville) : la musique de Vivaldi n'est pas toujours utilisée de façon synchrone (elle semble dire autre chose que ce que montre les images), une voix off (celle de Cocteau lui-même) commente ou prolonge de façon détachée et littéraire ce qui se joue sur l'écran, les registres familiers et soutenus alternent dans les dialogues, les comportements de la jeunesse provoquent, et les regards, en deux ou trois occasions, visent le spectateur directement à travers la caméra...
Certes, l'œuvre n'est pas sans défaut. Le jeu saccadé d'Edouard Dermit, interprétant Paul, gêne de temps à autre (celui de sa partenaire, Nicole Stéphane, est bien plus assuré et fluide) tandis que le texte récité par Cocteau est parfois redondant. Mais cela ne fait finalement qu'ajouter à l'étrangeté de la chose, qui est particulièrement forte et expressive.
Revoir à la suite L'armée des ombres, film souvent admiré au cours de plus jeunes années, c'est abandonner toute idée de surprise et voir apparaître plus facilement quelques scories qui, en ces autres temps, ne me sautaient pas alors aux yeux.
Il est vrai, cependant que la séquence centrale londonienne m'avait toujours laissé une impression bizarre. Aujourd'hui, il me semble qu'elle a tendance à déteindre quelque peu sur tout le film. Quand Melville montre ce rendez-vous de Gerbier et de son chef avec le Général De Gaulle, on ne sait trop s'il filme (dans l'ombre) la légende, s'il peint une image d'Epinal, s'il s'agenouille devant le Grand Homme. Cette poignée de secondes constituent un point extrême mais force est de constater que L'armée des ombres ne dévie jamais de l'imagerie orthodoxe de la Résistance française à l'occupant allemand. Peut-être que la légère gêne que procure cette fidélité sans faille au dogme serait moins palpable si la vision portait de façon plus serrée encore sur ce petit groupe de quatre ou cinq personnes s'activant avec Gerbier (la séquence du barbier, joué par Serge Reggiani, est marquante mais n'apporte pas de contrepoids). Dans L'armée des ombres, la Résistance est une entité très homogène... Enfin, la rareté et la gravité des dialogues font que ceux-ci pèsent lourd, au risque de dériver vers la sentence ou le mot d'auteur (comme par exemple dans le dialogue entre Gerbier et "Le Masque" à la fin de la séquence de l'exécution, toujours aussi éprouvante, du traître).
Ainsi, oui, l'ensemble est un peu trop raide. Mais il garde tout de même de sa force. Frappe toujours la photographie de Pierre Lhomme, qui donne l'impression de regarder un film sans couleurs (seuls le gris, le bleu foncé, le brun...), un film nocturne, un film qui enserre. Image et son se rejoignent dans le même dessein : dire l'oppression. Silences et bruits infernaux alternent, aussi menaçants les uns que les autres. Le moteur de l'avion ou du camion, le tic-tac de l'horloge, agressent comme la mitrailleuse, la gestion particulière du temps long par Melville accentuant l'effet.
Les affreux hasards de la guerre sont prétextes à quelques trouvailles scénaristiques plus ou moins habiles. Glaçantes à la première vision, elles semblent plutôt, ensuite, participer à "l'alourdissement" général du film. Mais après tout, au milieu de toute cette gravité, une certaine malice peut être décelable : la rencontre avec De Gaulle est collée à la projection d'Autant en emporte le vent dans un cinéma de Londres, illustrée par une image au lyrisme appuyé, et plus loin, Gerbier, aux portes de la mort, croit-on, repense à quelques bribes de son existence, occasion pour le cinéaste d'insérer de brefs plans en flash-back et de faire passer pour tel un qui ne l'est nullement (des mains tenant un livre de Luc Jardie, le patron, une image qui n'est pas en retard mais en avance...).
Inutile de revenir sur la science de l'espace de Melville (l'espace qui, épuré, est aussi, chez le cinéaste, du temps qui s'écoule), sauf à dire que c'est cela, en grande partie, qui rend les morceaux de bravoure inoubliables. Mieux vaut terminer sur une dimension particulière du film, qui nous place un peu en-deça, émotionnellement parlant, mais qui est précieuse : l'idée que l'Histoire elle-même ne peut pas tout mettre à jour, qu'il existe aussi des sacrifices inutiles, que tant de choses restent pour toujours dans l'ombre, que tant d'actes sont à jamais inconnus.

 LES ENFANTS TERRIBLES
LES ENFANTS TERRIBLES
L'ARMÉE DES OMBRES
de Jean-Pierre Melville
(France, France - Italie / 100 mn, 145 mn / 1950, 1969)

 LE VOYAGE FANTASTIQUE (Fantastic voyage)
LE VOYAGE FANTASTIQUE (Fantastic voyage)




 THE SHOOTING (ou LA MORT TRAGIQUE DE LELAND DRUM)
THE SHOOTING (ou LA MORT TRAGIQUE DE LELAND DRUM)


 L'HORRIBLE DOCTEUR ORLOF (Gritos en la noche)
L'HORRIBLE DOCTEUR ORLOF (Gritos en la noche)

 HAMLET (Gamlet)
HAMLET (Gamlet)

 LE JOURNAL DE DAVID HOLZMAN (David Holzman's diary)
LE JOURNAL DE DAVID HOLZMAN (David Holzman's diary)


 LES ENFANTS TERRIBLES
LES ENFANTS TERRIBLES
 VIETNAM, ANNÉE DU COCHON (In the year of the pig)
VIETNAM, ANNÉE DU COCHON (In the year of the pig)
 YOYO
YOYO
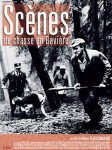 SCÈNES DE CHASSE EN BAVIÈRE (Jagdszenen aus Niederbayern)
SCÈNES DE CHASSE EN BAVIÈRE (Jagdszenen aus Niederbayern)
 SA MAJESTÉ DES MOUCHES (Lord of the flies)
SA MAJESTÉ DES MOUCHES (Lord of the flies)