Suite du flashback
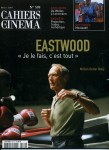
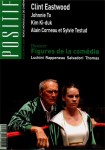 2005 : Les Cahiers mettent en valeur cette année-là le cinéma coréen, d'Im Kwon-taek à Hong Sang-soo (par Claire Denis), le cinéma allemand (Henner Winckler, Jan Krüger, Angela Schanelec), Aviator, Million dollar baby, Broken flowers, Les amants réguliers, A history of violence et Le petit lieutenant (Xavier Beauvois) et s'interrogent sur les films de l'après 11 septembre que sont Batman begins (Christopher Nolan), L'interprète (Sydney Pollack) et La guerre des mondes (Steven Spielberg). Ils vont à la rencontre d'Amos Gitai (Terre promise), Peter Watkins, Frédéric Sojcher (Cinéastes à tout prix), Nicolas Klotz, Katsuhito Ishii (The taste of tea), Edward Yang, Abbas Kiarostami, Jia Zhangke, Lodge Kerrigan (Keane), Philippe Colin (Aux abois), Wim Wenders (Don't come knocking), Hou Hsiao-hsien, Abel Ferrara (Mary), Jacques Rancière et André S. Labarthe. Ils s'intéressent à Michael Mann, Peter Lorre, Carmelo Bene, Raymond Depardon, Jean-Pierre Gorin, Virginia Mayo, Jean-Louis Comolli, Apichatpong Weerasethakul, Arnaud Desplechin, Leo McCarey, Chris Marker, Germaine Dulac, Monte Hellman, Werner Herzog, Yasujiro Ozu, Guy Debord, Harold Lloyd, David Perlov, Avi Mograbi et au cinéma israélien, au documentaire espagnol, au cinéma dada. Ils publient des ensembles sur Rainer Werner Fassbinder et les acteurs contemporains (d'Asia Argento à Mathieu Amalric). Ils proposent enfin deux numéros exceptionnels : le 600e avec un Ciné-manga imaginé par Takeshi Kitano et 14 autres cinéastes et le 607e pour lequel Michel Piccoli est promu rédacteur en chef.
2005 : Les Cahiers mettent en valeur cette année-là le cinéma coréen, d'Im Kwon-taek à Hong Sang-soo (par Claire Denis), le cinéma allemand (Henner Winckler, Jan Krüger, Angela Schanelec), Aviator, Million dollar baby, Broken flowers, Les amants réguliers, A history of violence et Le petit lieutenant (Xavier Beauvois) et s'interrogent sur les films de l'après 11 septembre que sont Batman begins (Christopher Nolan), L'interprète (Sydney Pollack) et La guerre des mondes (Steven Spielberg). Ils vont à la rencontre d'Amos Gitai (Terre promise), Peter Watkins, Frédéric Sojcher (Cinéastes à tout prix), Nicolas Klotz, Katsuhito Ishii (The taste of tea), Edward Yang, Abbas Kiarostami, Jia Zhangke, Lodge Kerrigan (Keane), Philippe Colin (Aux abois), Wim Wenders (Don't come knocking), Hou Hsiao-hsien, Abel Ferrara (Mary), Jacques Rancière et André S. Labarthe. Ils s'intéressent à Michael Mann, Peter Lorre, Carmelo Bene, Raymond Depardon, Jean-Pierre Gorin, Virginia Mayo, Jean-Louis Comolli, Apichatpong Weerasethakul, Arnaud Desplechin, Leo McCarey, Chris Marker, Germaine Dulac, Monte Hellman, Werner Herzog, Yasujiro Ozu, Guy Debord, Harold Lloyd, David Perlov, Avi Mograbi et au cinéma israélien, au documentaire espagnol, au cinéma dada. Ils publient des ensembles sur Rainer Werner Fassbinder et les acteurs contemporains (d'Asia Argento à Mathieu Amalric). Ils proposent enfin deux numéros exceptionnels : le 600e avec un Ciné-manga imaginé par Takeshi Kitano et 14 autres cinéastes et le 607e pour lequel Michel Piccoli est promu rédacteur en chef.
Du côté de Positif, les numéros s'ouvrent sur les œuvres et les propos de Woody Allen, Martin Scorsese, Mike Leigh, Jacques Audiard, Clint Eastwood, Jia Zhangke, Sydney Pollack, Brigitte Roüan, Patrice Chéreau, Lodge Kerrigan, Wim Wenders, Michael Haneke, David Cronenberg, Hou Hsiao-hsien, Tommy Lee Jones, Oliver Stone (Alexandre), Ermanno Olmi (En chantant derrière les paravents), Lucile Hadzihalilovic (Innocence), Robert Guédiguian (Le promeneur du Champ de Mars), Paolo Sorrentino (Les conséquences de l'amour), Raphaël Nadjari (Avanim), Todd Solondz (Palindromes), Johnnie To (Breaking news), Pirjo Honkasalo (Les trois chambres de la mélancolie), Bill Plympton (Hair high), Pawel Pawlikowski (My summer of love), Tim Burton (Charlie et la chocolaterie), Eric Khoo (Be with me), Vincenzo Marra (Vento di terra), Ira Sachs (Forty shades of blue). Sylvie Testud et Eva Marie Saint sont également rencontrées. Des articles sont consacrés à Michelangelo Antonioni, João César Monteiro, René Clair, Kim Ki-duk, Sergueï M. Eisenstein, Thorold Dickinson, Michael Cimino, Stanley Kubrick, Peter Watkins, Roman Polanski, Guy Debord, Yves Allégret, Bollywood et la comédie cantonaise et des dossiers à Anthony Mann, Michael Powell, Orson Welles, Jean Renoir, Louis Malle, Marlon Brando et son héritage, aux "exotismes" (de Lang à Iosseliani), au documentaire (Volker Koepp, Bruno Muel, Jonathan Nossiter, Ross McElwee, Haskell Wexler, Jorgen Leth...), à la comédie française (Jean-Paul Rappeneau, Pascal Thomas, Pierre Salvadori, Fabrice Lucchini), au montage (Kevin Brownlow, Dede Allen, Pietro Scalia, Yann Dedet...) et aux Européens à Hollywood.
Janvier : Aviator (Martin Scorsese, Cahiers du Cinéma n°597) /vs/ Melinda et Melinda (Woody Allen, Positif n°527)
Février : Edvard Munch, la danse de la vie (Peter Watkins, C598) /vs/ Vera Drake (Mike Leigh, P528)
Mars : Clint Eastwood (Million dollar baby) (C599) /vs/ De battre mon cœur s'est arrêté (Jacques Audiard, P529)
Avril : La blessure (Nicolas Klotz, C600) /vs/ Million dollar baby (Clint Eastwood, P530)
Mai : Sharon Stone (Broken flowers, Jim Jarmusch, C601) /vs/ The World (Jia Zhangke, P531)
Juin : The World (Jia Zhangke, C602) /vs/ Travaux (Brigitte Roüan, P532)
Eté : Acteurs (Asia Argento, C603) /vs/ Marlon Brando (P533-534)
Septembre : Broken flowers (Jim Jarmusch), Le parfum de la dame en noir (Bruno Podalydès) & Une aventure (Xavier Giannoli) (C604) /vs/ Gabrielle (Patrice Chéreau, P535)
Octobre : Les amants réguliers (Philippe Garrel, C605) /vs/ Caché (Michael Haneke, P536, là)
Novembre : A history of violence (David Cronenberg, C606) /vs/ Three times (Hou Hsiao-hsien, P537)
Décembre : Michel Piccoli (C607) /vs/ Trois enterrements (Tommy Lee Jones, P538)
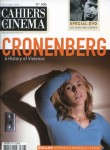
 Quitte à choisir : Les années se suivent et ne se ressemblent pas, celle-ci n'étant, à mon sens, pratiquement entâchée d'aucune anomalie, d'un côté comme de l'autre (à l'exception toutefois du film de Chéreau). S'il existe de meilleurs Jia Zhangke, Scorsese, Allen, Leigh ou Jarmusch, je n'en défends pas moins leurs opus 2005. Le Roüan fut pour moi une excellente surprise, tout comme le Tommy Lee Jones, mais plus marquants encore furent les films d'Eastwood, Audiard, Garrel, Haneke et Cronenberg. Enfin, ayant eu l'occasion d'apprécier d'autres titres de leur auteur respectif, je suis très curieux de découvrir Edvard Munch et La blessure. Allez, pour 2005 : Match nul.
Quitte à choisir : Les années se suivent et ne se ressemblent pas, celle-ci n'étant, à mon sens, pratiquement entâchée d'aucune anomalie, d'un côté comme de l'autre (à l'exception toutefois du film de Chéreau). S'il existe de meilleurs Jia Zhangke, Scorsese, Allen, Leigh ou Jarmusch, je n'en défends pas moins leurs opus 2005. Le Roüan fut pour moi une excellente surprise, tout comme le Tommy Lee Jones, mais plus marquants encore furent les films d'Eastwood, Audiard, Garrel, Haneke et Cronenberg. Enfin, ayant eu l'occasion d'apprécier d'autres titres de leur auteur respectif, je suis très curieux de découvrir Edvard Munch et La blessure. Allez, pour 2005 : Match nul.
A suivre...
Sources : Calindex & Cahiers du Cinéma


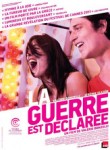 LA GUERRE EST DÉCLARÉE
LA GUERRE EST DÉCLARÉE








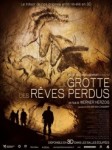 LA GROTTE DES RÊVES PERDUS (Cave of forgotten dreams)
LA GROTTE DES RÊVES PERDUS (Cave of forgotten dreams)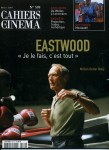
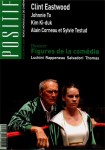 2005 : Les Cahiers mettent en valeur cette année-là le cinéma coréen, d'Im Kwon-taek à Hong Sang-soo (par Claire Denis), le cinéma allemand (Henner Winckler, Jan Krüger, Angela Schanelec), Aviator, Million dollar baby, Broken flowers, Les amants réguliers, A history of violence et Le petit lieutenant (Xavier Beauvois) et s'interrogent sur les films de l'après 11 septembre que sont Batman begins (Christopher Nolan), L'interprète (Sydney Pollack) et La guerre des mondes (Steven Spielberg). Ils vont à la rencontre d'Amos Gitai (Terre promise), Peter Watkins, Frédéric Sojcher (Cinéastes à tout prix), Nicolas Klotz, Katsuhito Ishii (The taste of tea), Edward Yang, Abbas Kiarostami, Jia Zhangke, Lodge Kerrigan (Keane), Philippe Colin (Aux abois), Wim Wenders (Don't come knocking), Hou Hsiao-hsien, Abel Ferrara (Mary), Jacques Rancière et André S. Labarthe. Ils s'intéressent à Michael Mann, Peter Lorre, Carmelo Bene, Raymond Depardon, Jean-Pierre Gorin, Virginia Mayo, Jean-Louis Comolli, Apichatpong Weerasethakul, Arnaud Desplechin, Leo McCarey, Chris Marker, Germaine Dulac, Monte Hellman, Werner Herzog, Yasujiro Ozu, Guy Debord, Harold Lloyd, David Perlov, Avi Mograbi et au cinéma israélien, au documentaire espagnol, au cinéma dada. Ils publient des ensembles sur Rainer Werner Fassbinder et les acteurs contemporains (d'Asia Argento à Mathieu Amalric). Ils proposent enfin deux numéros exceptionnels : le 600e avec un Ciné-manga imaginé par Takeshi Kitano et 14 autres cinéastes et le 607e pour lequel Michel Piccoli est promu rédacteur en chef.
2005 : Les Cahiers mettent en valeur cette année-là le cinéma coréen, d'Im Kwon-taek à Hong Sang-soo (par Claire Denis), le cinéma allemand (Henner Winckler, Jan Krüger, Angela Schanelec), Aviator, Million dollar baby, Broken flowers, Les amants réguliers, A history of violence et Le petit lieutenant (Xavier Beauvois) et s'interrogent sur les films de l'après 11 septembre que sont Batman begins (Christopher Nolan), L'interprète (Sydney Pollack) et La guerre des mondes (Steven Spielberg). Ils vont à la rencontre d'Amos Gitai (Terre promise), Peter Watkins, Frédéric Sojcher (Cinéastes à tout prix), Nicolas Klotz, Katsuhito Ishii (The taste of tea), Edward Yang, Abbas Kiarostami, Jia Zhangke, Lodge Kerrigan (Keane), Philippe Colin (Aux abois), Wim Wenders (Don't come knocking), Hou Hsiao-hsien, Abel Ferrara (Mary), Jacques Rancière et André S. Labarthe. Ils s'intéressent à Michael Mann, Peter Lorre, Carmelo Bene, Raymond Depardon, Jean-Pierre Gorin, Virginia Mayo, Jean-Louis Comolli, Apichatpong Weerasethakul, Arnaud Desplechin, Leo McCarey, Chris Marker, Germaine Dulac, Monte Hellman, Werner Herzog, Yasujiro Ozu, Guy Debord, Harold Lloyd, David Perlov, Avi Mograbi et au cinéma israélien, au documentaire espagnol, au cinéma dada. Ils publient des ensembles sur Rainer Werner Fassbinder et les acteurs contemporains (d'Asia Argento à Mathieu Amalric). Ils proposent enfin deux numéros exceptionnels : le 600e avec un Ciné-manga imaginé par Takeshi Kitano et 14 autres cinéastes et le 607e pour lequel Michel Piccoli est promu rédacteur en chef.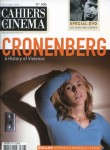
 Quitte à choisir : Les années se suivent et ne se ressemblent pas, celle-ci n'étant, à mon sens, pratiquement entâchée d'aucune anomalie, d'un côté comme de l'autre (à l'exception toutefois du film de Chéreau). S'il existe de meilleurs Jia Zhangke, Scorsese, Allen, Leigh ou Jarmusch, je n'en défends pas moins leurs opus 2005. Le Roüan fut pour moi une excellente surprise, tout comme le Tommy Lee Jones, mais plus marquants encore furent les films d'Eastwood, Audiard, Garrel, Haneke et Cronenberg. Enfin, ayant eu l'occasion d'apprécier d'autres titres de leur auteur respectif, je suis très curieux de découvrir Edvard Munch et La blessure. Allez, pour 2005 : Match nul.
Quitte à choisir : Les années se suivent et ne se ressemblent pas, celle-ci n'étant, à mon sens, pratiquement entâchée d'aucune anomalie, d'un côté comme de l'autre (à l'exception toutefois du film de Chéreau). S'il existe de meilleurs Jia Zhangke, Scorsese, Allen, Leigh ou Jarmusch, je n'en défends pas moins leurs opus 2005. Le Roüan fut pour moi une excellente surprise, tout comme le Tommy Lee Jones, mais plus marquants encore furent les films d'Eastwood, Audiard, Garrel, Haneke et Cronenberg. Enfin, ayant eu l'occasion d'apprécier d'autres titres de leur auteur respectif, je suis très curieux de découvrir Edvard Munch et La blessure. Allez, pour 2005 : Match nul.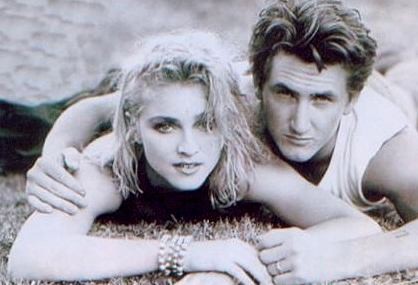
 THIS MUST BE THE PLACE
THIS MUST BE THE PLACE
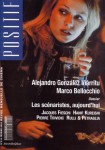 2004 : Pour les Cahiers, créent l'événement, successivement : le cinéma chinois de Tian Zhunangzhuang (Printemps dans une petite ville) à Wang Bing (A l'ouest des rails), S21, la machine de mort khmère rouge de Rithy Panh, Triple agent d'Eric Rohmer, Sarabande d'Ingmar Bergman, The Brown Bunny de Vincent Gallo et Shara de Naomi Kawase, Adieu d'Arnaud des Pallières et Clean d'Olivier Assayas, Le village de M. Night Shyamalan, Tropical malady d'Apichatpong Weerasethakul, Rois et reine d'Arnaud Desplechin (également à l'honneur pour Léo en jouant "Dans la compagnie des hommes"), Les temps qui changent d'André Téchiné et A tout de suite de Benoît Jacquot. Dans l'année sont publiés des entretiens avec Jafar Panahi (Sang et or), Kiyoshi Kurosawa (Séance), Lucrecia Martel (La niña santa), Wong Kar-wai (2046), Yousry Nasrallah (La porte du soleil) et Jonathan Caouette (Tarnation), ainsi que des textes de Jean-Louis Comolli et Arnaud Desplechin. Les rédacteurs se penchent sur les œuvres de Jacques Tourneur, Vincente Minnelli, Monte Hellman, Pier Paolo Pasolini, Jonas Mekas, Danièle Huillet et Jean-Marie Straub, Sergio Leone, Peter Weir, Jean Grémillon, Béla Tarr, Samuel Fuller, Paul Verhoeven, Alan Clarke, sur le cinéma allemand, l'enseignement du cinéma, le court métrage, le documentaire, sur L'hirondelle d'or de King Hu, Les idoles de Marc'O, La bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo, Les oliviers de la justice de James Blue, L'homme de la plaine d'Anthony Mann. François Truffaut est au cœur du numéro d'été, Mia Hansen-Love fait un éloge de Jacques Doillon et des hommages sont rendus à Jean Rouch et à Jean-Daniel Pollet.
2004 : Pour les Cahiers, créent l'événement, successivement : le cinéma chinois de Tian Zhunangzhuang (Printemps dans une petite ville) à Wang Bing (A l'ouest des rails), S21, la machine de mort khmère rouge de Rithy Panh, Triple agent d'Eric Rohmer, Sarabande d'Ingmar Bergman, The Brown Bunny de Vincent Gallo et Shara de Naomi Kawase, Adieu d'Arnaud des Pallières et Clean d'Olivier Assayas, Le village de M. Night Shyamalan, Tropical malady d'Apichatpong Weerasethakul, Rois et reine d'Arnaud Desplechin (également à l'honneur pour Léo en jouant "Dans la compagnie des hommes"), Les temps qui changent d'André Téchiné et A tout de suite de Benoît Jacquot. Dans l'année sont publiés des entretiens avec Jafar Panahi (Sang et or), Kiyoshi Kurosawa (Séance), Lucrecia Martel (La niña santa), Wong Kar-wai (2046), Yousry Nasrallah (La porte du soleil) et Jonathan Caouette (Tarnation), ainsi que des textes de Jean-Louis Comolli et Arnaud Desplechin. Les rédacteurs se penchent sur les œuvres de Jacques Tourneur, Vincente Minnelli, Monte Hellman, Pier Paolo Pasolini, Jonas Mekas, Danièle Huillet et Jean-Marie Straub, Sergio Leone, Peter Weir, Jean Grémillon, Béla Tarr, Samuel Fuller, Paul Verhoeven, Alan Clarke, sur le cinéma allemand, l'enseignement du cinéma, le court métrage, le documentaire, sur L'hirondelle d'or de King Hu, Les idoles de Marc'O, La bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo, Les oliviers de la justice de James Blue, L'homme de la plaine d'Anthony Mann. François Truffaut est au cœur du numéro d'été, Mia Hansen-Love fait un éloge de Jacques Doillon et des hommages sont rendus à Jean Rouch et à Jean-Daniel Pollet.
 Quitte à choisir : Deux listes avec quelques trous d'air. J'aime l'entrée en matière des Cahiers (Coppola/Panh/Rohmer) mais ensuite, je confesse plusieurs lacunes (Gallo, Weerasethakul, Mazuy). Pour le reste, le Jacquot me paraît intéressant mais bancal et surtout je déteste assez cordialement les deux films proposés conjointement en septembre. De l'autre côté, m'avaient beaucoup plu, à leur sortie, ces Iñarritu et Gondry-là. Les Kusturica, Wong Kar-wai et Desplechin de l'année, un cran en-dessous par rapport à leur régime habituel, me semblent tout de même bien figurer, tout comme Uzak. Les mentions de Murnau (comme de Truffaut en face) et de Lynch (pour ce qui ressemble tout de même à un "rattrapage" de l'oubli de
Quitte à choisir : Deux listes avec quelques trous d'air. J'aime l'entrée en matière des Cahiers (Coppola/Panh/Rohmer) mais ensuite, je confesse plusieurs lacunes (Gallo, Weerasethakul, Mazuy). Pour le reste, le Jacquot me paraît intéressant mais bancal et surtout je déteste assez cordialement les deux films proposés conjointement en septembre. De l'autre côté, m'avaient beaucoup plu, à leur sortie, ces Iñarritu et Gondry-là. Les Kusturica, Wong Kar-wai et Desplechin de l'année, un cran en-dessous par rapport à leur régime habituel, me semblent tout de même bien figurer, tout comme Uzak. Les mentions de Murnau (comme de Truffaut en face) et de Lynch (pour ce qui ressemble tout de même à un "rattrapage" de l'oubli de 
 LA PIEL QUE HABITO
LA PIEL QUE HABITO