Au pays des merveilles, plutôt Valérie qu'Alice...


(Jaroslava Schallerova dans Valérie au pays des merveilles de Jaromil Jires, 1970,
Mia Wasikowska dans Alice au pays des merveilles de Tim Burton, 2009)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
Au pays des merveilles, plutôt Valérie qu'Alice...


(Jaroslava Schallerova dans Valérie au pays des merveilles de Jaromil Jires, 1970,
Mia Wasikowska dans Alice au pays des merveilles de Tim Burton, 2009)

****
Enoch a perdu ses parents dans un accident de voiture, s'incruste aux enterrements ayant lieu dans sa ville et dialogue avec un fantôme. Annabel a une tumeur au cerveau et ses jours sont comptés. Ils sont jeunes et beaux. Ils se rencontrent, s'aiment et font leur petit bout de chemin ensemble.
Gus Van Sant a, jusqu'ici, si bien filmé la jeunesse, a si parfaitement réussi à transposer un état d'esprit, qu'il en est arrivé à tourner comme un ado. Avec Restless, il prend un plaisir infini à montrer des petits trucs de gamins, de la craie sur le bitume aux bonbons sur les tables, des bécots sur les lèvres aux histoires (très signifiantes) d'insectes se nourrissant de cadavres. Il voit le monde tel que ceux-ci peuvent le rêver, se met à leur niveau et se complaît dans la niaiserie.
La grande idée de Restless c'est d'aborder le grave sujet de la mort sans aucun pathos au point de prendre à chaque moment le contre-pied de la tristesse attendue, de faire passer avec délicatesse ce qui devrait s'avérer violent, de rendre naturel le surnaturel et d'accepter l'inacceptable. Or, si la mise en scène de Van Sant reste fluide, elle est ici dépourvue de la radicalité de ses grandes œuvres de la décennie précédente comme de l'énergie qui parcourait le plus classique Harvey Milk. Par conséquent, tout devient soudain lisse, sans aspérité, sans faille, sans éclat. Dans Restless, la violence s'évite facilement, les bons conseils sont aisés à recueillir (ils viennent du fantôme), un cadavre à la morgue a l'apparence d'une belle jeune fille, et un enterrement, c'est joli, surtout si on l'enrobe d'une chanson de Nico (artiste dont la musique, pourtant, me semble à l'opposé de la joliesse, du confort et du sourire). Enoch et Annabel font l'expérience de la mort comme d'autres font celle d'une sexualité tendre et apaisée. Leurs références aux kamikazes et au seppuku sont sources de gags (Nagasaki quand même pas, il ne faut pas abuser...) et probablement si la fille s'en va, sa sœur prendra le relai. Bref, dans Restless, la mort, c'est cool...
Si la question habituelle dans ces cas-là est bien posée (Combien de temps reste-t-il à vivre à la malade ?), jamais l'idée de compte à rebours ne prend forme ni ne donne quelque épaisseur aux instants vécus. L'histoire est d'ailleurs vaguement intemporelle mais le refuge dans le passé de ces adolescents n'est finalement prétexte qu'à un beau défilé de mode en vêtements vintage.
Auparavant, Gus Van Sant savait empaqueter ses cadeaux. Cette fois-ci, il n'a préparé que l'emballage, il n'a rien mis dedans. De toute façon, je crois qu'il ne m'était pas destiné.
 RESTLESS
RESTLESS
de Gus Van Sant
(Etats-Unis / 90 min / 2011)
Suite du flashback

 2007 : Les Cahiers organisent leurs numéros autour, successivement, de Johnnie To et du cinéma de Hong Kong, d'INLAND EMPIRE, du diptyque de Clint Eastwood sur Iwo Jima, de Ne touchez pas la hache et du cinéma de Jacques Rivette, de Quentin Tarantino, de l'élection présidentielle et des annonces des candidats en matière de politique pour le cinéma, des Correspondances Erice-Kiarostami à Beaubourg, de Francis Ford Coppola et de L'homme sans âge et de La graine et le mulet. Ils rencontrent Pedro Costa (En avant jeunesse), Albert Serra (Honor de cavalleria), Alexandre Sokourov (Alexandra), Jia Zhangke, Tsai Ming-liang (I don't want to sleep alone), Isild Le Besco (Charly), Quentin Dupieux, Eric et Ramzy (Steak), George Romero (Diary of the dead), Mia Hansen-Love (Tout est pardonné) et Eric Rohmer. Ils publient des écrits sur Jean Eustache, Etienne-Jules Marey, Kim Novak, Catherine Deneuve, Serguei Paradjanov, Luigi Comencini, Jean-Luc Godard, Twin Peaks de David Lynch, le cinéma et la photographie, le cinéma et l'histoire et l'année 1971. La revue présente dix films inédits (d'Arnaud Desplechin à Shinji Aoyama) et confie ses clés à Juliette Binoche le temps d'un numéro.
2007 : Les Cahiers organisent leurs numéros autour, successivement, de Johnnie To et du cinéma de Hong Kong, d'INLAND EMPIRE, du diptyque de Clint Eastwood sur Iwo Jima, de Ne touchez pas la hache et du cinéma de Jacques Rivette, de Quentin Tarantino, de l'élection présidentielle et des annonces des candidats en matière de politique pour le cinéma, des Correspondances Erice-Kiarostami à Beaubourg, de Francis Ford Coppola et de L'homme sans âge et de La graine et le mulet. Ils rencontrent Pedro Costa (En avant jeunesse), Albert Serra (Honor de cavalleria), Alexandre Sokourov (Alexandra), Jia Zhangke, Tsai Ming-liang (I don't want to sleep alone), Isild Le Besco (Charly), Quentin Dupieux, Eric et Ramzy (Steak), George Romero (Diary of the dead), Mia Hansen-Love (Tout est pardonné) et Eric Rohmer. Ils publient des écrits sur Jean Eustache, Etienne-Jules Marey, Kim Novak, Catherine Deneuve, Serguei Paradjanov, Luigi Comencini, Jean-Luc Godard, Twin Peaks de David Lynch, le cinéma et la photographie, le cinéma et l'histoire et l'année 1971. La revue présente dix films inédits (d'Arnaud Desplechin à Shinji Aoyama) et confie ses clés à Juliette Binoche le temps d'un numéro.
Dans Positif se lisent des entretiens avec Johnnie To, Nuri Bilge Ceylan, François Ozon, Jia Zhangke, Catherine Breillat, Cristian Mungiu, Lee Chang-dong, David Cronenberg, Abdellatif Kechiche, Corneliu Porumboiu (12h08 à l'est de Bucarest), Lucian Pintilie (Tertium non datur), Steven Soderbergh (The good german), Pierre Jolivet (Je crois que je l'aime), Gianni Amelio (L'étoile imaginaire), Stéphane Brizé (Entre adultes), Manoel de Oliveira (Belle toujours), Pascale Ferran (Lady Chatterley), Julian Schnabel (Le scaphandre et le papillon), Claude Chabrol (La fille coupée en deux), Wang Quan'an (Le mariage de Tuya), Claude Miller (Un secret), Fatih Akin (De l'autre côté), Alain Corneau (Le deuxième souffle), Todd Haynes (I'm not there), James Gray (La nuit nous appartient), Wong Kar-wai (My blueberry nights), Roy Andersson (Nous, les vivants), Audrey Tautou, Jeanne Balibar et Guillaume Depardieu, un hommage à Philippe Noiret et des textes sur Gong Li, Paradjanov, Lynch, Godard, Erice et Kiarostami, Louis Feuillade, Peter Whitehead, Bruno Dumont, Atom Egoyan, Sidney Lumet, Rouben Mamoulian, Joaquim Pedro de Andrade, Nagisa Oshima, le mélodrame mexicain, la Hammer Films, le cinéma allemand et les génériques de James Bond. Quant aux dossiers mensuels, ils concernent Eastwood, Rohmer, le trio Mizoguchi-Naruse-Ozu, Sam Peckinpah, Otto Preminger, Sacha Guitry, Robert Altman, le documentaire (Luciano Rigolini, Claudio Pazienza, Avi Mograbi, William Karel), les nouveaux comédiens français (Jamel Debbouze, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Romain Duris), la mélancolie au cinéma (de Ford à Angelopoulos) et la distribution et l'exploitation.
Janvier : Election (Johnnie To, Cahiers du Cinéma n°619) /vs/ Les climats (Nuri Bilge Ceylan, Positif n°551)
Mars : Ne touchez pas la hache (Jacques Rivette, C621) /vs/ Angel (François Ozon, P553)
Avril : 12 propositions pour le cinéma, Présidentielle 2007 (C622) /vs/ Ne touchez pas la hache (Jacques Rivette, P554)
Mai : Boulevard de la mort (Quentin Tarantino, C623) /vs/ Still life (Jia Zhangke, P555)
Juin : Zodiac (David Fincher, C624) /vs/ Une vieille maîtresse (Catherine Breillat, P556)
Eté : Juliette Binoche (C625) /vs/ Quand une femme monte l'escalier (Mikio Naruse, P557-558)
Septembre : Les amours d'Astrée et de Céladon (Eric Rohmer, C626) /vs/ 4 mois, 3 semaines et 2 jours (Cristian Mungiu, P559)
Octobre : Paranoid Park (Gus Van Sant, C627) /vs/ Secret sunshine (Lee Chang-dong, P560)
Novembre : L'homme sans âge (Francis Ford Coppola, C628) /vs/ Les promesses de l'ombre (David Cronenberg, P561)
Décembre : La graine et le mulet (Abdellatif Kechiche, C629) /vs/ La graine et le mulet (Abdellatif Kechiche, P562)

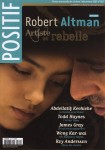 Quitte à choisir : Je retrouve huit de mes dix films préférés à l'époque et ceux-ci sont plus souvent du côté Cahiers (To, Lynch, Rivette, Tarantino, Fincher, Van Sant, Kechiche) que du côté Positif (Mungiu en plus de Rivette et Kechiche). Je peux y ajouter ensuite les titres d'Eastwood, Breillat et Cronenberg. En revanche, ceux de Ceylan, Jia et Lee avaient soulevé chez moi moins d'enthousiasme que prévu, tandis que j'avais totalement repoussé le film d'Ozon. Et comme je vois, dans la colonne de gauche, Juliette Binoche et un Rohmer que j'aimerai enfin découvrir... Allez, pour 2007 : Avantage Cahiers.
Quitte à choisir : Je retrouve huit de mes dix films préférés à l'époque et ceux-ci sont plus souvent du côté Cahiers (To, Lynch, Rivette, Tarantino, Fincher, Van Sant, Kechiche) que du côté Positif (Mungiu en plus de Rivette et Kechiche). Je peux y ajouter ensuite les titres d'Eastwood, Breillat et Cronenberg. En revanche, ceux de Ceylan, Jia et Lee avaient soulevé chez moi moins d'enthousiasme que prévu, tandis que j'avais totalement repoussé le film d'Ozon. Et comme je vois, dans la colonne de gauche, Juliette Binoche et un Rohmer que j'aimerai enfin découvrir... Allez, pour 2007 : Avantage Cahiers.
Note : Ce blog étant apparu en 2007, la plupart des films cités sur cette page, ainsi que ceux qui le seront pour les années suivantes, ont fait l'objet d'une note (voir Index des films).
A suivre...
Sources : Calindex & Cahiers du Cinéma

****
Présenter Le convoi comme un titre mineur mais s'intégrant parfaitement dans la filmographie de Sam Peckinpah cela a plus d'allure et plus d'attrait que de le qualifier de lourde comédie d'action relatant les aventures d'un groupe de routiers sympas. Pourtant, durant sa première partie, le film n'est rien d'autre que cela. Le cinéaste n'y va pas de main morte pour s'installer dans ce genre, osant notamment une bagarre de "saloon" résolument parodique à voir l'usage du ralenti qui est fait, tendant ici à déréaliser et à épaissir le trait. Cette course poursuite entre trois chauffeurs et un policier pervers n'est ni très glorieuse ni très intéressante, à l'image des conversations codées ayant cours entre les routiers à travers leur CB.
Ces échanges continus par ondes radio, si réalistes qu'ils soient, contribuent à une saturation des plans particulièrement éreintante. Car ce n'est pas tant le rythme qui fatigue mais l'accumulation à l'intérieur du cadre et d'une séquence à l'autre. Le film de Peckinpah nous saoule de messages, de sirènes de voiture de police, de klaxons de camions, d'une musique country que l'on apprécierait peut-être si elle était utilisée moins systématiquement, de défilés de poids lourds (un, puis deux, puis trois... jusqu'à cinquante, cent ?), de nuages de poussière et de fumées noires. Dans le même élan, le comique s'affiche grossièrement et nous empèche de prendre au sérieux tout ce qui se passe sur l'écran y compris lorsque la violence et le drame pointent leur nez (passage à tabac d'un Noir, lutte "à mort" entre le leader et le policier).
La dimension politique du Convoi a également du mal à s'affirmer clairement au milieu de ce cirque mais elle nous retient assez pour ne pas rendre le film totalement négligeable. Suite à un acte de rébellion contre l'ordre policier, Rubber Duck se retrouve en tête d'un groupe de routiers auquel se joignent tous les éléments contestataires de la société américaine croisés dans les régions traversées pour atteindre le Mexique. Des hippies aux femmes libérées, du Noir opprimé à l'individualiste réfractaire, l'échantillon représentatif n'est pas mis en évidence de manière très fine mais dans la partie centrale du film, la plus intéressante et la moins lourde, on sent très bien, au-delà d'une amusante tentative de récupération politique par les autorités, que les diverses espérances et revendications formulées ne fusionnent jamais véritablement et que la vision désenchantée, détachée et pessimiste de Duck prédomine (soit, par extension, celle de Peckinpah).
L'aventure se poursuit malheureusement dans un troisième acte au scénario toujours à la lisière de la bêtise (la crédibilité fut apparemment le moindre des soucis des auteurs), sacrifié, comme tout le reste, à la recherche de l'effet. L'évidence de la transposition dans l'univers du western éclate en plein jour mais celle-ci, d'une part, donne un tour plus attendu encore au récit (poursuite, vengeance, duel) et, d'autre part, pousse le cinéaste à composer des plans plutôt risibles, comme celui qui présente avant l'assaut un alignement de camions comme autant de cavaliers sur la colline. L'éclat de rire final, en plein chaos (comique), devient une figure "Peckinpahienne" inopérante car accusant la vanité non seulement du monde décrit mais surtout de sa représentation à travers ce film décevant, dont je garderai tout de même l'image d'Ali McGraw conduisant sa décapotable les jambes écartées et la jupe relevée sur les cuisses.
 LE CONVOI (Convoy)
LE CONVOI (Convoy)
de Sam Peckinpah
(Etats-Unis / 110 min / 1978)

****
L'Apollonide est un projet ambitieux et il faut au moins lui reconnaître cela. Ambitieux non pas par les moyens mis en œuvre pour embrasser toute une époque, ni par la confrontation à un grand sujet, mais par sa mise en récit. Bertrand Bonello cherche à raconter autrement et forcément, parfois, c'est son film lui-même qui semble se chercher, freiner, patiner, tourner en rond (dans son dernier tiers, notamment, avant les séquences de fin). Malgré de nombreux petits décrochages et sauts temporels, la progression de la narration reste globalement linéaire et chronologique, tendue qu'elle est vers la fin programmée de cette maison close où travaillent, au tournant du XXe siècle, une dizaine de prostituées. Ce qui est passionnant de ce point de vue, c'est d'observer comment Bonello parvient à avancer sans vraiment prendre d'appui dramatique, à l'opposée de la démarche classique, sa construction étant faite de larges blocs plutôt que de courtes séquences bien reliées les unes aux autres. Ce choix, prisé de nos jours par quelques cinéastes, et non des moindres (on pense assez régulièrement, devant L'Apollonide, au travail d'Abdellatif Kechiche), peut être à l'origine d'une certaine fascination mais peut aussi avoir comme inconvénient d'amener le spectateur à hiérarchiser, à soupeser chaque segment selon ses préférences. Le film de Bonello n'échappe pas totalement à cet écueil. Derrière le parti pris narratif, on découvre d'ailleurs que le tour d'horizon thématique est assez complet par rapport au sujet : nous avons de grandes séquences centrées successivement sur l'ivresse, l'initiation, l'intimité, l'hygiène etc. Finalement, peu d'impasses sont faites mais, fort heureusement, l'impression de feuilleter un catalogue ne nous effleure pas. Cela est certainement dû à la "contemporanéisation" effectuée par le cinéaste. La bande son n'a rien à voir avec ce qui s'entendait à la Belle Epoque et certains dialogues sonnent de manière tout à fait actuelle. Paradoxalement, ce détournement de la convention, qui pourrait s'avérer artificiel, insuffle beaucoup de vie, qualité se signalant notamment dans quelques phrases courtes prononcées par la tenancière du bordel (Noémie Lvovsky chaperonnant les autres, toutes mémorables, d'Hafsia Herzi à Céline Sallette en passant par Jasmine Trinca ou Alice Barnole).
Mais L'Apollonide est surtout un fantasme de bordel. L'idée de représentation, tout d'abord, y est prépondérante. Elle accompagne bien sûr, déjà, le travail des prostituées mais la mise en scène de Bonello redouble admirablement la leur au moment de montrer les jeux (ou les sévices) érotiques, le plus beau et le plus troublant étant celui où l'une des filles se transforme pour son client en poupée mécanique (la réussite sur ce terrain rend finalement le recrutement, pour jouer les rôles masculins, de collègues cinéastes très anecdotique, propice à faire parler dans la profession mais sans réel apport pour le simple spectateur, même le mieux informé). Ensuite, il y a cette horreur, sous-jacente (les avancées dans des couloirs sombres) et bientôt jaillissante (la mutilation au couteau). Une horreur qui renvoie certainement à une réalité mais qui est ici avant tout d'une grande puissance cinématographique. Enfin, à plusieurs endroits s'effectuent des dédoublements du point de vue, des passages de témoin qui s'accompagnent de répétitions. La sensation du rêve et celle de la claustration (même la sortie au lac, sous le soleil et dans la joie, place les filles à l'abri des regards et aucun plan n'est consacré au trajet) sont ainsi provoquées, comme elles le sont par l'organisation d'un espace fait de diverses frontières, à la fois très précises (dans le plan) et peu situées (dans l'architecture générale du lieu) : rideaux, portes, miroirs, vitres teintées. Assurément, et c'est sans doute là sa qualité principale, L'Apollonide est un film mental. Un film s'ouvrant et se refermant sur le rêve d'une fille. Une fille ou, en fait, une autre, car les ultimes secondes nous propulsent ailleurs, dans notre réalité, esquissant peut-être l'affichage d'un message de portée globale mais le désamorçant in extremis en laissant la fiction reprendre la main, la machine à fantasmer se relancer à nouveau.
 L'APOLLONIDE, SOUVENIRS DE LA MAISON CLOSE
L'APOLLONIDE, SOUVENIRS DE LA MAISON CLOSE
de Bertrand Bonello
(France / 122 min / 2011)

****
Dans les premières secondes de Delta, accompagnés par un fond musical obsédant, nous glissons majestueusement sur les eaux du fleuve. Soudain, un assourdissant bruit de bateau nous surprend. Ce procédé, Kornel Mundruczo l'affectionne et le reprend souvent, de façon sonore (un jeune homme entre dans le café et le silence se fait aussitôt dans la salle) ou visuelle (il n'est pas rare qu'un plan très sombre soit collé à un autre baigné d'une lumière aveuglante). Parler de sursaut serait excessif et impliquerait une notion de dynamique absente du film (la pénible indolence du personnage masculin est une des causes de ce manque). Qualifions donc cet effet de dissonance.
Dans le delta du Danube, un couple atypique se forme à l'écart de la communauté. L'homme et la femme construisent leur refuge au milieu des eaux, à peine relié à la terre ferme par une très longue passerelle. Ils sont frère et sœur et ils s'affirment donc dans la transgression. Celle-ci est symbolisée par cette maison sur pilotis qui n'est tenue au rivage (à la norme) que par un maigre fil. L'anéantissement des espoirs aura lieu bien sûr en cet endroit bien précis, là où se fait le passage, là où se trouve le lien que l'homme et la femme ont voulu garder malgré tout : sur ce pont étroit et interminable.
Cette approche est très théorique et c'est bien là le problème du film de Mundruczo. Si le cadre choisi, naturellement somptueux, a tout pour accueillir le frémissement, le trouble et la sensualité, la mise en scène ne semble s'intéresser qu'à elle-même, prenant régulièrement la pose. La représentation du viol de la jeune femme est caractéristique. Elle tient d'abord dans un plan-séquence très large, en extérieur, dans lequel les personnages sont réduits à des silhouettes dans un paysage de friche industrielle. Mais cette distance instaurée pendant l'acte est annulée par le brusque raccord sur le geste de la fille essuyant sur ses cuisses le sperme de son beau-père, sous le regard de celui-ci. Cette alternance entre la distance réflexive et le choc de la proximité se retrouve lors du final dramatique. Nous réalisons alors, de manière très désagréable, que ce qui intéresse le cinéaste avant tout ce n'est pas tant de s'interroger sur un mécanisme de violence que de filmer l'humiliation.
Lorsque Delta a été défendu, ce fut à l'ombre de Théo Angelopoulos et de Miklos Jancso. On y trouve pourtant ni la solennité (parfois) impressionnante du premier, ni le dynamisme interne des chorégraphies du second. Ni la complexité des strates temporelles ordonnées par le Grec, ni la mesure de l'espace arpenté par le Hongrois. En ne se focalisant pas uniquement sur l'usage du plan-séquence, il est possible d'évoquer également Scènes de chasse en Bavière. L'argument est en effet similaire à celui choisi par Peter Fleischmann : un jeune homme revient dans son village et réveille les pires instincts chez ses congénères. Ces trois noms sont liés à une autre époque mais le cinéma qu'ils faisaient avait notamment une force et une profondeur historique. L'œuvre, certes plastiquement superbe, de Kornel Mundruczo n'est pas traversée par l'Histoire, elle n'est que théorie, cherchant à créer du mythe moderne. Le regard de l'auteur est ici généralisant, contraignant, artiste, ivre de lui-même, ennuyeux.
 DELTA
DELTA
de Kornel Mundruczo
(Hongrie - Allemagne / 95 min / 2008)
Vous brûlez de savoir
quelle nouvelle version de La guerre des boutons est la meilleure ?
Et bien, elles se valent et vous en aurez la preuve en parcourant
le Panoptique du mois de septembre, qui se dévoile en cliquant sur le logo :

****
"Pénible histoire de fantômes asiatiques. Beaucoup de scènes effectivement effrayantes mais répétitives (4 ou 5 fois le coup de l'armoire, 4 ou 5 fois le plan de la main qui agrippe). Usant pour les nerfs, le tout n'est pas réhaussé par une exposition et des moments de transition statiques. Le mélange rêve dans le rêve - fantôme - transfert de personnalité est embrouillé, ce qui rend le récit et la psychologie absolument incompréhensibles. Il y a bien un éclaircissement final (encore une fois à la Sixième sens) mais il n'explique toujours pas certaines scènes rétrospectivement." Voilà ce que j'avais griffonné en mai 2006 après avoir découvert à la télévision Deux sœurs, un des succès précédents de Kim Jee-woon. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun souvenir de ce film, hormis l'image d'un inquiétant sac posé sur le sol d'un appartement.
Je ne sais si, malgré l'abondance de séquences-choc qu'il propose, je vais oublier aussi rapidement J'ai rencontré le diable. Ce thriller horrifique m'a semblé d'une autre qualité mais il subsiste tout de même dans ce cinéma-là une certaine confusion.
Un homme sans histoire se venge de l'assassin de sa fiancée non pas en le tuant mais en le harcelant sans relâche, en le torturant à plusieurs occasions, en lui promettant l'enfer pendant des jours et des jours. Ce sujet a de quoi nous faire glisser vers la plus grande, la plus périlleuse et la plus vertigineuse ambiguïté morale mais ce sont plutôt la confusion et les hésitations du style que l'on retient et qui, finalement, en atténuent les effets. Dans un premier temps, le récit ne semble suivre qu'une seule ligne droite, ne s'attaquer qu'à une obsession et n'obéir qu'à de la mécanique, ce qui a pour conséquence, assez surprenante mais pas désagréable, de repousser tout questionnement. La répétition improbable des actes de violence (extrême) et le jeu qui s'instaure entre le chat et la souris tirent tant vers l'absurde et la position du cinéaste semble si évidente que le besoin de s'interroger ne se fait pas sentir. Pourtant, cette dynamique est soudain ralentie, une fois, puis deux, puis trois, par un dialogue faisant intervenir des proches du "héros" ou les autorités et venant surligner ce que faisait déjà très bien sentir le film : l'inanité de la vengeance et la transformation de qui la commet en monstre.
Ces béquilles sont encombrantes, jusqu'à en gâcher assez sévèrement les dernières minutes, de l'ultime torture aux larmes du vengeur. Kim Jee-woon en rajoute souvent, il fonce tête baissée, sans trop de discernement. Il est notamment peu rigoureux sur la question du point de vue (par rapport, par exemple, à Park Chan-wook, auquel on ne peut que le comparer, rarement à son avantage, tant les points communs avec Old boy et quelques autres titres sont nombreux). Le basculement qui s'opère de temps à autre n'est pas assez affirmé à mon sens. Les mouvements de caméra destinés à nous placer littéralement au-dessus de l'un puis de l'autre, lorsque chasseur et proie changent de statut, inaugurent des segments clairs mais n'entraînent pas de changement de perspective aussi radical que l'on pourrait espérer. Pas aussi radical, en tout cas, que ne l'est la représentation de la violence, recourant allègrement aux effets gore les plus estomaquants.
Malgré tout cela, quelque chose résiste et fascinerait presque, par moments. D'une part, il y a, encore une fois, cette horrible vision, sans cesse réactivée par les auteurs de thrillers et de drames sud-coréens, d'une société perdue, incapable d'éradiquer le mal qu'elle cache en son sein. Un mal insaisissable, renaissant constamment sous de nouvelles formes. D'autre part, il aura rarement été montré aussi clairement comment la vengeance enclenche un mécanisme de violence incontrôlable et se propageant de manière centrifuge, soit parce que la surenchère s'installant entre les deux antagonistes provoque très tôt l'implication des proches, soit parce que la traque est à l'origine de dégats collatéraux perçus comme négligeables mais faisant des victimes bien réelles.
Ce but-là, Kim Jee-woon l'a atteint, malgré les quelques handicaps qui peuvent entraver sa mise en scène et sa conduite du (trop long) récit. Son film bénéficie également d'une interprétation solide, de brillants éclats (le combat au couteau dans le taxi) et de cette faculté, très partagée parmi ses collègues coréens, de passer dans une même scène d'un registre à l'autre sans mettre en péril l'équilibre de l'ensemble.
 J'AI RENCONTRÉ LE DIABLE (Akmareul boatda)
J'AI RENCONTRÉ LE DIABLE (Akmareul boatda)
de Kim Jee-woon
(Corée du Sud / 140 min / 2010)

****
L'intérêt de ce classique chinois est principalement historique et patrimonial. Il a pour lui une réalisation correcte et une interprétation de qualité (Shi Hui est le metteur en scène et l'acteur principal) mais il n'est pas très enthousiasmant pour qui garde par exemple le souvenir du contemporain Printemps dans une petite ville de Fei Mu, l'un des rares titres datant de cette période de la fin des années quarante à être connu par chez nous.
Au-delà du rythme des scènes et de leur organisation qui tentent de retrouver la vie mais en en passant plutôt vers la clarté artificielle du théâtre (dans la rue, au milieu des groupes, on passe d'un intervenant à l'autre très nettement, sans chevauchement de parole, ni mélange des gestes), c'est surtout le didactisme absolu de la démarche qui gêne. Dans Ma vie, récit de quarante années de l'existence d'un pauvre homme par lui-même, tout donne l'impression d'être expliqué plutôt que vécu. Compréhensible lorsqu'il s'agit d'aborder les questions sociales, politiques et historiques, cette position l'est moins lorsqu'elle gangrène l'expression des sentiments. Plus d'une fois le héros explique à un tiers, et donc à nous, ce qu'il ressent, sa parole se substituant alors avec trop de facilité au travail de la mise en scène.
L'originalité du film tient dans le choix de ce héros, un petit homme banal qui devient agent de police dans un quartier de Pékin et qui se trouve plongé dans une misère grandissante au fil des années. Ses souvenirs personnels se cognent à la représentation de la grande histoire, celle qui broie le peuple chinois à travers joug impérial, invasions et domination japonaises, montée en force des profiteurs et des nantis. Dans cette masse, quelques individus, essentiellement des étudiants, se lancent dans l'aventure de la Révolution communiste. Mais la majorité, celle qui est symbolisée par le héros, courbe l'échine, se plaint chaque jour sans se révolter, pas même lorsque des proches sont assassinés. Bons et méchants sont clairement identifiés mais l'homme, devenant vieux, répète de plus en plus souvent qu'il "ne comprend rien" à tout cela. On se dit que la violence ayant cours autour de lui devrait pourtant l'aider à y voir clair car, si celle-ci reste dans les limites autorisés par l'époque, elle n'en est pas moins appuyée dramatiquement et paraît presque complaisante à trop vouloir édifier le spectateur.
L'une des dernières séquences est difficilement supportable. Le héros, longuement torturé par les anciens alliés des Japonais, contre-révolutionnaires au pouvoir, est renvoyé dans une cellule de la prison. Il tombe alors sur son ami, un leader communiste, disparu depuis dix ans mais qui va, dans les instants qui suivent se faire fusiller. Bien qu'on le devine très éprouvé par les sévices, il va toutefois se lancer devant celui-ci, de manière tout à fait articulée, dans un monologue poignant sur le peuple martyrisé.
Ma vie est donc un film d'avant la proclamation de la République Populaire de Chine. Contrairement à ce que l'on pouvait attendre, il ne montre pas les révolutionnaires à l'action mais les nombreuses souffrances de ceux qu'ils sont supposés libérer. Malheureusement, ce regard plus réaliste et plus intime n'en est pas moins dépourvu de pesant didactisme, ce qui rend l'œuvre, malgré ses promesses et ses efforts, rigide et univoque.
 MA VIE (Wo zhe yi bei zi)
MA VIE (Wo zhe yi bei zi)
de Shi Hui
(Chine / 100 min / 1950)
Source photos : Chinese-shortstories

****
Bien sûr, Un été brûlant traite un sujet simplissime et rabattu (sous le soleil d'Italie, une femme quitte un homme qui ne s'en remet pas et un deuxième couple, "témoin", manque de peu d'être entraîné dans le naufrage), reprend des figures de style et des thèmes présents dans les films précédents de Garrel, convoque évidemment toute la famille du cinéaste, au sens généalogique comme au sens professionnel du terme... On aurait vite fait de considérer l'opus comme mineur dans la filmographie. Je ne sais pas si il l'est et cela m'est bien égal. Il se trouve que je m'y suis senti bien, comme dans la majorité des œuvres de Garrel que j'ai pu voir depuis vingt ans, en premier lieu J'entends plus la guitare, Le vent de la nuit, Sauvage innocence, Les amants réguliers. De chacun de ces titres, il ne me reste que quelques bribes, des images, des sons, quelque chose de diffus, pas beaucoup plus, mais ils gardent mon affection. Un été brûlant suivra sans doute le même parcours dans ma mémoire.
Le léger voile recouvrant ces films me fit écrire au moment de ma découverte des Amants réguliers quelques lignes à propos de la longueur des plans filmés par Garrel peut-être valables pour ce titre-là mais sans doute pas pour les autres, contrairement à ce que ma formulation trop générale pouvait laisser penser. Dans Un été brûlant, certains plans s'étirent ainsi "gratuitement" mais ils n'en perdent pas pour autant leur force. Ils y puisent même parfois la leur. L'introduction, assez godardienne, est magnifique : le piano de John Cale, la route défilant sous les phares, la femme nue qui tend le bras, l'homme qui pleure, se prend un poteau et se meurt. Son agonie dure en ne laissant entendre que les bruits de ferraille, de flammèche et de court-circuit électrique. Survenant plus tard, la longue séquence de la danse de Monica Bellucci, passant d'un homme à un autre, est suffisamment commentée ailleurs pour que j'y revienne ici. Profitons tout de même du rapprochement de ces deux moments pour apprécier le rapport particulier de Garrel à la musique. Il est vraiment plaisant de retrouver de temps à autre un cinéaste qui ne se serve pas de celle-ci comme simple illustration et facile attrape-spectateur.
Pour certains, le film passera peut-être pour une succession de clichés. Ce qui m'a intéressé pour ma part, sur ce plan-là, c'est la manière dont Garrel part effectivement de l'énonciation, par les personnages, de ces clichés pour mieux les faire broder autour, pour mieux asseoir et affiner le propos au fil des dialogues. On se dit alors qu'en creusant encore et toujours ce sujet, on finit par trouver régulièrement des choses nouvelles (ou, la mémoire étant ce qu'elle est, qui paraissent nouvelles). C'est ainsi que cette étude de couple échappe malgré tout à la futilité et parvient à dire (et à montrer) quelques vérités, à émouvoir, même, assez souvent, notamment lorsqu'est illustrée l'idée que s'occuper vraiment de quelqu'un c'est en délaisser un autre.
Si le point de départ et celui d'arrivée sont clairs (le récit est en fait un flash back), la séduction qu'exerce le film tient aussi à la façon dont est suivi le chemin qui les relie : la progression dramatique ne se fait jamais en donnant l'impression de s'appuyer sur des chevilles de scénario, comme dans un quelconque marivaudage d'un Doillon des mauvais jours. Cette fluidité et ce flottement, auquel concourt pareillement la bande son, sont des plus agréables.
Enfin, j'aime Un été brûlant pour l'honnêteté qui me semble le traverser. Garrel y fait le point sur son cinéma, sa situation personnelle, sa position morale et idéologique, et son statut d'artiste. Peut-être y a-t-il ici un certain confort (pour le cinéaste comme pour moi en tant que spectateur), mais Garrel ne se planque pas, ne fait pas le malin, ne triche pas.
 UN ÉTÉ BRÛLANT
UN ÉTÉ BRÛLANT
de Philippe Garrel
(France - Italie - Suisse / 95 min / 2011)