


****/****/****

(Chronique dvd parue sur Kinok)
Avouons-le, la découverte des "primitifs" - à l'exception, peut-être, des burlesques - demande une disposition particulière sinon un travail au spectateur, qui doit, sous peine de manquer d'apprécier à sa juste valeur l'objet retrouvé, se mettre les idées assez claires par rapport à l'histoire du cinéma et à l'évolution de ses formes. Les bouleversements qui apparaissent dans la pratique de cet art au cours des années 10 du vingtième siècle sont d'une telle ampleur que l'on peut avancer sans trop de provocation que l'on trouve moins de similitudes entre un Méliès de 1906 et un Fritz Lang de 1922 qu'entre ce dernier et un Lynch ou un Coen d'aujourd'hui. Ainsi, pour voir et commenter une série de films telle que le coffret Albert Capellani édité par Pathé nous le propose, mieux vaut-il sans doute s'en tenir à une approche chronologique.
Il faut donc commencer par le quatrième et dernier disque, sur lequel ont été regroupés plusieurs courts métrages du cinéaste. Drame passionnel, Mortelle idylle, La femme du lutteur, L'âge du cœur : ces bandes, toutes réalisées à ses débuts, en 1906, sont d'une durée équivalente (autour de cinq minutes), sont écrites par le même scénariste (André Heuzé) et proposent la même progression dramatique. Bâties sur la figure du trio, elles démarrent avec une rencontre amoureuse ou une vie de couple sans nuage pour instiller ensuite la suspicion et la trahison avant de se terminer sur une vengeance, par balle ou lame, ou par un suicide. Le reste n'est que variations, dont la plus notable concerne les statuts sociaux des personnages, assez divers. Nous sommes là dans la production de série et dans la spécialisation des réalisateurs-maison : chez Pathé-Frères, Albert Capellani se charge, aux côtés de Ferdinand Zecca, des films dramatiques. La mise en scène se fait "à plat", dans des échelles de plans bien définies, proches de celles que procure la vision d'un spectacle théâtral. La pantomime est de rigueur et un hiatus naît de chaque collage entre les plans tournés en extérieur et ceux tournés en intérieur.
Dans cette série de courts de 1906, quelques uns se distinguent toutefois, à divers titres. On remarque dans La fille du sonneur de timides panoramiques accompagnant des promeneurs avant qu'un mouvement de caméra plus affirmé balaie les toits de Paris. Un peu plus long que les autres, ce film ne résout cependant pas la délicate question de la gestion du temps cinématographique qui se pose devant ces œuvres. Pauvre mère est à la fois le mélodrame le plus simple et le plus complexe techniquement de cet échantillon. Des surimpressions et l'insertion sans heurt d'un plan plus rapproché dans une séquence sont les signes d'une recherche certaine. Sur toute la (courte) durée, l'organisation de l'espace semble plus inventive. Le fond est aussi plus dense et cette histoire de mère devenue folle à la suite de la mort de sa petite fille est une trame qui accueille plus facilement les excès de l'interprétation. Avec Aladin ou la lampe merveilleuse, Albert Capellani change de registre et marche dans les pas de Méliès. Il en reprend les trucages et l'idée d'un final en apothéose sous forme de petit ballet mais la fable orientalisante n'est déjà pas la veine la plus passionnante de l'œuvre du créateur du Voyage dans la lune... La tentative de Capellani n'est donc guère stimulante, sauf si l'on considère qu'elle lui ouvre la voie des films de prestige. L'aspect documentaire de ses mélodrames disparaît ici fâcheusement derrière les décors artificiels.
Trois ans (et une bonne vingtaine de titres) séparent ces courts du moyen métrage L'assommoir, soit à l'échelle du cinéma des premiers temps, un gouffre. Un récit plus purement cinématographique se met en place avec cette adaptation du roman de Zola. Les transitions se font plus souples entre les plans qui se délestent quelque peu de leur apparence de tableaux, y compris lorsqu'il s'agit de passer du dedans au dehors, et inversement. De même, dorénavant, la séquence n'équivaut pas toujours au plan, des inserts trouvant leur place. La gestuelle des comédiens est aussi plus mesurée et l'acquisition de cette maîtrise permet d'une part, une organisation plus claire de scènes de groupe et d'autre part l'émergence, en quelques endroits, du naturel. Bien sûr, la durée encore réduite, ainsi que le caractère primitif du déroulement des séquences, provoquent souvent d'étonnantes condensations du temps nécessaire aux actions. Dans le meilleur des cas, cela donne un morceau de bravoure, comme lorsque Alexandre Arquillière (du "Théâtre du Vaudeville de Paris", comme précisé au générique), dans le rôle de Coupeau, joue en une poignée de secondes le réveil, la tentation de l'alcool, le dilemme moral, l'abandon, l'ivresse, la folie furieuse et la mort...
Un nouveau saut temporel nous propulse en 1913-1914, à la découverte des trois longs métrages présents dans ce coffret. Ces dates ne sont pas anodines, le cinéma étant à ce moment-là en train de quitter l'âge primitif. Rappelons-nous qu'entre 1913 et 1916 sont réalisés Quo Vadis ? d'Enrico Guazzoni, Cabiria de Giovanni Pastrone, Forfaiture de Cecil B. DeMille, Naissance d'une nation et Intolérance de D.W. Griffith. Les durées de projection changent totalement, approchant parfois les trois heures, les moyens mis en œuvre ne sont plus les mêmes, le langage utilisé évolue forcément et le regard des spectateurs s'adapte. Les réalisateurs français ont pris leur part dans cette évolution, depuis le début des années 10, Capellani en tête.
Germinal, Le Chevalier de Maison Rouge et Quatre-vingt-treize ont bien des points communs mais, malgré leur proximité dans le temps, ils n'ont pas, à nos yeux, la même valeur et, étrangement, celle-ci n'est pas conditionnée par l'ordre dans lequel ces films ont été réalisés. Alors que les deux autres titres, sur plusieurs plans, constituent une avancée certaine par rapport aux exemples précédents de l'œuvre de Capellani, Le Chevalier de Maison Rouge marque un recul. Cette adaptation assez barbante d'Alexandre Dumas offre tout d'abord un festival de gestes déclamatoires. La Reine Marie-Antoinette, souffrante, implore constamment le ciel, le révolutionnaire enragé regarde toujours par en-dessous, le jeune officier amoureux garde en toute circonstance sa vivacité... La raison de ce retour à la pantomime s'explique peut-être par le choix du genre de la fantaisie historique. Un autre public que celui auquel était destiné les autres œuvres de prestige de Capellani était peut-être visé. Ou bien la trame rocambolesque a-t-elle poussé à cela ? Toujours est-il que le cinéaste autorise le jeu excessif de ses acteurs, la naïveté des comportements et la lourdeur des émotions exprimées.
L'agitation au sein des groupes est la règle, trop de monde s'évertuant à bouger dans un trop petit espace, ce qui a pour effet d'accentuer encore le statisme de la mise en scène. Les dispositions en demi-cercles ouverts vers nous et les visages tournés franchement vers la caméra pour émouvoir sont des effets ici bien artificiels. De même, les décors construits, notamment tous ceux de prison, jurent franchement avec les quelques rares extérieurs, soudain lestés d'un poids de réalité, d'une épaisseur grisâtre sans pareil. Dans un registre qui en demande, Capellani n'a pas la précision ni la vigueur d'un Feuillade. Il faut de plus noter le respect d'une morale très conventionnelle. Farouches royalistes et fervents révolutionnaires : les deux extrêmes n'ont pas les faveurs du cinéaste-adaptateur qui, au mépris du dénouement tragique du roman, choisit de sauver un couple d'amoureux loyaux envers leur famille politique sans être des acharnés.
La Révolution est également bien sûr au centre de Quatre-vingt-treize. La Terreur, plus exactement. Les enjeux et les tensions incroyables qui ont traversés cette période historique sont évidemment simplifiés (jusqu'à l'image d'Epinal quand est imaginée une réunion, dans l'arrière-salle d'un club, entre Marat, Danton et Robespierre), mais il arrive qu'une conversion comme celle du jeune aristocrate aux idées des Lumières émeuve par le bel enchaînement des évènements et la justesse des déplacements dans les décors. Si l'interprétation des comédiens est beaucoup plus supportable que dans Le Chevalier de Maison Rouge, il est vrai que brasser de grandes idées semble donner le droit de faire de grands gestes. Mais sans doute est-ce là le résultat de la tentative de transcription du lyrisme des mots de Victor Hugo dans les images de Capellani. On sent d'ailleurs que des moyens considérables sont à la disposition de celui-ci, qui donne la priorité au tournage en extérieurs. Cela ne va pas sans le paralyser quelque peu : le film est impressionnant, monumental, souvent figé. Les intertitres sont nombreux et longs, reprenant souvent des passages entiers du livre. Ainsi, la scène du débarquement de l'envoyé des royalistes, pourtant forte, souffre d'être abusivement découpée par le texte.
La variété des échelles de plans est sensible. La caméra se rapproche plus près des corps, rendant ainsi plus aisée l'identification du spectateur aux personnages. Quelques panoramiques et deux travellings se remarquent, ainsi que des raccords dans le mouvement par-delà le découpage. Très long métrage humaniste, Quatre-vingt-treize n'est donc pas seulement un fastueux et laborieux livre d'art, mais il reste aujourd'hui difficile à juger. Son histoire est effectivement chaotique. Le tournage en a été arrêté en 1914 par la déclaration de la guerre. Incomplet, il fut de toute façon bloqué par la censure de l'époque qui ne voulait pas sortir une œuvre rendant compte d'une guerre civile. La maison Pathé finit tout de même par le reprendre et André Antoine fut chargé de tourner les scènes manquantes et d'effectuer le montage définitif, en accord avec Capellani qui travaillait alors, et cela depuis le début des hostilités, aux Etats-Unis. La sortie effective eut donc lieu en 1921. Se posent alors les questions de datation (sept années, une éternité) et de paternité des différentes séquences (toute la dernière partie, pas la plus passionnante, est, semble-t-il, à mettre sur le compte d'Antoine).
C'est donc dans Germinal, le plus ancien des trois longs proposés dans ce coffret, que le cinéma de Capellani se montre sous son meilleur jour. Voici la première adaptation d'ampleur du roman de Zola, avant celles d'Yves Allégret en 1962 et de Claude Berri en 1993. Le tournage en décors réels semble s'imposer pour obtenir une correcte transposition, mais qu'en était-il en 1913 ? Et bien Capellani relève le défi de la même façon, s'installant sur les lieux où travaillent encore les mineurs de l'époque et allant jusqu'à mêler ses acteurs à la population lors de la fête locale, dans un geste documentaire assez surprenant. De plus, les transitions sont fluides entre intérieurs et extérieurs. La continuité n'est pas brisée et malgré leur longueur, les plans s'articulent dans une narration véritablement cinématographique.
Les acteurs, eux, apprennent à gérer leurs effets, y compris dans les scènes les plus physiques, comme la bagarre opposant Lantier à Chaval. Il suffit généralement d'un intertitre pour poser la situation, l'éloquence des gestes traduisant ensuite les échanges. L'alliance de cette retenue et de l'usage du plan séquence donne l'impression d'un jeu d'acteur pertinent. Elle permet aussi l'émotion, comme si le retrait la décuplait, à l'image de la scène où Lantier découvre, au fond de la mine, que son accompagnateur, qu'il pensait être le fils Maheu est en fait la fille Maheu (la révélation se fait par la libération de la longue chevelure cachée sous le bonnet, cette vision étant, à l'heure du dénouement, douloureusement redoublée, les cheveux de Catherine tombant vers le sol alors qu'elle est transportée sur un brancard). Le naturalisme de Zola appelle sans doute, plus que le lyrisme d'Hugo, un réalisme du geste.
Germinal se signale également par le dépassement de l'organisation "plate" des scènes. Les marches des mineurs se rendant à leur travail ou le quittant, l'alignement de leurs maisons, toutes similaires, et la profondeur des boyaux miniers sont autant de percées à la surface des décors. Le champ de la caméra est travaillé en strates : lorsque Lantier est sorti du puits, il est visible au premier plan ; au deuxième, la foule des mineurs se presse ; au troisième se distinguent les sauveteurs qui s'activent toujours au dessus du trou. La gestion des groupes est également assez remarquable, les placements en "cène" étant justifiés tant que possible, par exemple par la présence d'un poêle au premier plan. Mais c'est surtout la constante tenue à l'écart d'un personnage en particulier, le fascinant anarchiste russe Souvarine, qui donne sa valeur à ce type d'organisation dans l'espace : l'homme est toujours face à nous lorsque les autres nous tournent le dos et sur le bord du cadre lorsque la masse est au milieu. La caractérisation est ici extrêmement efficace.
Le message politique véhiculé par le roman est sans doute atténué dans le film. La violence et le désespoir sont forcément moins marqués. Il s'agissait de ménager la censure en ne montrant que ce qui était alors représentable, mais aussi de préserver l'honneur des mineurs (lors d'un tournage qui avait lieu seulement vingt-cinq ans après l'écriture du livre). Cela dit, la construction dramatique n'en souffre guère. Les scènes de couples ou de trio se répondent habilement entre l'univers des mineurs et celui des propriétaires et ces échos préparent le final sous forme de double deuil. Après une longue partie descriptive, le film entame un crescendo auquel il est difficile de résister. Capellani offre dans la dernière partie une série de séquences très fortes et des images inoubliables comme celles de la tuerie provoquée par l'armée ou celle d'un cadavre flottant au fond de la mine. Jamais l'ennui ne pointe pendant ces deux heures et vingt-huit minutes.
Ainsi, cette édition DVD d'œuvres qui n'étaient guère visibles depuis près d'un siècle et signées d'un réalisateur qui eut son heure de gloire avant de tomber dans l'oubli ne provoque pas de véritable choc. Mais elle permet au moins de profiter de la meilleure adaptation de Germinal et elle donne à voir les mutations considérables qu'a pu connaître l'art cinématographique dans sa prime jeunesse. Elle n'est donc aucunement destinée à l'usage exclusif des historiens.
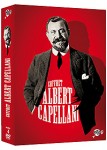 GERMINAL
GERMINAL
LE CHEVALIER DE MAISON ROUGE
QUATRE-VINGT-TREIZE
d'Albert Capellani
(France / 148 mn, 108 mn, 165 mn / 1913, 1914, 1921)
+ 7 courts métrages de 1906 (5 à 13 mn) : DRAME PASSIONNEL / MORTELLE IDYLLE / PAUVRE MÈRE / LA FILLE DU SONNEUR / LA FEMME DU LUTTEUR / L'ÂGE DU CŒUR / ALADIN OU LA LAMPE MERVEILLEUSE
+ 1 moyen métrage de 1909 (35 mn) : L'ASSOMMOIR

 YOYO
YOYO
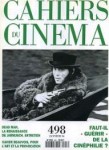
 1996 : Serge Toubiana retrouve son titre de rédacteur en chef des Cahiers, qu'il laisse toutefois à Martin Scorsese le temps de fêter le cinq centième numéro. Au fil de l'année, des entretiens sont réalisés avec Jarmusch, Monteiro, von Trier, Desplechin, Cronenberg et Téchiné, à propos de leurs films respectifs placés en couverture, ainsi qu'avec Xavier Beauvois (N'oublie pas que tu vas mourir), Danièle Dubroux (Le journal du séducteur), Eric Rohmer (Conte d'été), Michael Cimino (Sunchaser), les frères Coen (Fargo), Pascal Bonitzer (Encore), Catherine Breillat (Parfait amour !) et Sandrine Veysset (Y aura-t-il de la neige à Noël ?). Par-delà les nuages, Mission : Impossible, For ever Mozart et La promesse des frères Dardenne ont également les faveurs de la revue. Alain Delon, Alain Cavalier, Caroline Champetier, J.G. Ballard et un trio d'actrices composé de Valeria Bruni Tedeschi, Laurence Côte et Emmanuelle Devos sont rencontrés par les rédacteurs, qui publient parallèlement des ensembles sur la cinéphilie, sur les courts métrages et sur le cinéma indépendant, des études sur Mizoguchi, Siodmak, Frederick Wiseman et Gérard Blain, des hommages à Marguerite Duras, Saul Bass et Christine Pascal, des dossiers sur l'avenir du cinéma (du numérique à l'économie), sur Youssef Chahine et sur Jean-Pierre Melville.
1996 : Serge Toubiana retrouve son titre de rédacteur en chef des Cahiers, qu'il laisse toutefois à Martin Scorsese le temps de fêter le cinq centième numéro. Au fil de l'année, des entretiens sont réalisés avec Jarmusch, Monteiro, von Trier, Desplechin, Cronenberg et Téchiné, à propos de leurs films respectifs placés en couverture, ainsi qu'avec Xavier Beauvois (N'oublie pas que tu vas mourir), Danièle Dubroux (Le journal du séducteur), Eric Rohmer (Conte d'été), Michael Cimino (Sunchaser), les frères Coen (Fargo), Pascal Bonitzer (Encore), Catherine Breillat (Parfait amour !) et Sandrine Veysset (Y aura-t-il de la neige à Noël ?). Par-delà les nuages, Mission : Impossible, For ever Mozart et La promesse des frères Dardenne ont également les faveurs de la revue. Alain Delon, Alain Cavalier, Caroline Champetier, J.G. Ballard et un trio d'actrices composé de Valeria Bruni Tedeschi, Laurence Côte et Emmanuelle Devos sont rencontrés par les rédacteurs, qui publient parallèlement des ensembles sur la cinéphilie, sur les courts métrages et sur le cinéma indépendant, des études sur Mizoguchi, Siodmak, Frederick Wiseman et Gérard Blain, des hommages à Marguerite Duras, Saul Bass et Christine Pascal, des dossiers sur l'avenir du cinéma (du numérique à l'économie), sur Youssef Chahine et sur Jean-Pierre Melville.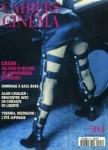
 Quitte à choisir : Je n'aime pas beaucoup Les voleurs, ni For ever Mozart, et à peine Par-delà les nuages et Jude, mais les autres titres me conviennent tout à fait. A l'époque, je plaçais, malgré certaines réserves, le Mike Leigh devant le Jarmusch, alors qu'aujourd'hui, me restent en tête beaucoup plus d'images du second que du premier. Si j'ajoute que le De Palma m'est inconnu et que Positif a, à mon goût, un peu trop tergiversé dans sa défense du Desplechin et du (sublime) Cronenberg, je signerai bien pour une nouvelle égalité parfaite, symbolisée par les couvertures jumelles de mars et d'octobre. Allez, pour 1996 : Match nul.
Quitte à choisir : Je n'aime pas beaucoup Les voleurs, ni For ever Mozart, et à peine Par-delà les nuages et Jude, mais les autres titres me conviennent tout à fait. A l'époque, je plaçais, malgré certaines réserves, le Mike Leigh devant le Jarmusch, alors qu'aujourd'hui, me restent en tête beaucoup plus d'images du second que du premier. Si j'ajoute que le De Palma m'est inconnu et que Positif a, à mon goût, un peu trop tergiversé dans sa défense du Desplechin et du (sublime) Cronenberg, je signerai bien pour une nouvelle égalité parfaite, symbolisée par les couvertures jumelles de mars et d'octobre. Allez, pour 1996 : Match nul.
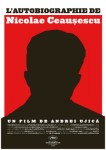 L'AUTOBIOGRAPHIE DE NICOLAE CEAUSESCU (Autobiografia lui Nicolae Ceausescu)
L'AUTOBIOGRAPHIE DE NICOLAE CEAUSESCU (Autobiografia lui Nicolae Ceausescu)



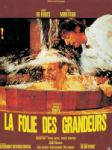
 CHANTONS SOUS LA PLUIE (Singin' in the rain)
CHANTONS SOUS LA PLUIE (Singin' in the rain)
 LE FOSSÉ (Jiabiangou)
LE FOSSÉ (Jiabiangou)
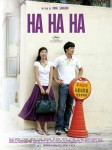 HA HA HA (Hahaha)
HA HA HA (Hahaha)
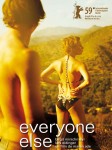 EVERYONE ELSE (Alle anderen)
EVERYONE ELSE (Alle anderen)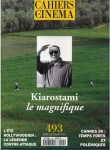
 1995 : "Deux révélations chinoises" : en avril, Cahiers et Positif présentent de la même façon à leurs lecteurs les noms de Wong Kar-wai et Tsai Ming-liang. Et les deux revues effectuent le même choix pour la couverture : ce sera Chungking express plutôt que Vive l'amour. Comme souvent, les points communs entre les sommaires sont nombreux au fil de l'année puisque l'on s'intéresse des deux côtés à Noémie Lvovsky, Chabrol, Pialat, Kusturica, Kiarostami, Burton, Kassovitz, Carpenter (L'antre de la folie) et Robert Aldrich (en rétrospective).
1995 : "Deux révélations chinoises" : en avril, Cahiers et Positif présentent de la même façon à leurs lecteurs les noms de Wong Kar-wai et Tsai Ming-liang. Et les deux revues effectuent le même choix pour la couverture : ce sera Chungking express plutôt que Vive l'amour. Comme souvent, les points communs entre les sommaires sont nombreux au fil de l'année puisque l'on s'intéresse des deux côtés à Noémie Lvovsky, Chabrol, Pialat, Kusturica, Kiarostami, Burton, Kassovitz, Carpenter (L'antre de la folie) et Robert Aldrich (en rétrospective).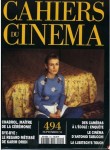
 Quitte à choisir : Deux consistantes séries de couvertures que, chacune, je vois à peine entâchée d'un ratage, et cela le même mois (les très faibles Rivette et Boorman). Le seul titre qui me soit inconnu est celui de Chahine mais comme je ne peux guère dire si je défendrai encore aujourd'hui L'appât de Tavernier, un score de parité semble s'imposer. Allez, pour 1995 : Match nul.
Quitte à choisir : Deux consistantes séries de couvertures que, chacune, je vois à peine entâchée d'un ratage, et cela le même mois (les très faibles Rivette et Boorman). Le seul titre qui me soit inconnu est celui de Chahine mais comme je ne peux guère dire si je défendrai encore aujourd'hui L'appât de Tavernier, un score de parité semble s'imposer. Allez, pour 1995 : Match nul.