(Jacques Panijel / France / 1962)
■■■□
 Octobre à Paris est un film maudit mais relativement connu, au moins par son titre et son sujet (*). C'est une suite de témoignages rendant compte des violences policières envers les Algériens résidant dans la région parisienne, avec en point d'orgue le récit de la nuit du 17 octobre 1961.
Octobre à Paris est un film maudit mais relativement connu, au moins par son titre et son sujet (*). C'est une suite de témoignages rendant compte des violences policières envers les Algériens résidant dans la région parisienne, avec en point d'orgue le récit de la nuit du 17 octobre 1961.
Il a été réalisé juste après les événements, tout le long de l'hiver 61. Ce n'est donc pas un document direct sur la manifestation et sa répression mais une contextualisation de celles-ci. Toutefois, le réalisateur, Jacques Panijel, monte son film en gommant ce petit décalage temporel pour donner l'illusion d'un travail au présent. Pas plus que de précisions sur le moment réel du tournage, il ne fournit de détails sur les sources qu'il utilise pour montrer des images de la manifestation (des photographies et quelques secondes filmées). Il donne également à voir les préparatifs de celle-ci dans l'un des bidonvilles de la capitale : une réunion dans une cabane entre deux responsables politiques (si je n'ai pas fait de faute d'inattention, le FLN n'est jamais cité dans le film) et trois habitants au cours de laquelle sont exposées les raisons de cet appel à manifester et l'organisation souhaitée, puis le départ, au petit matin, de plusieurs groupes vers les transports en commun pour Paris. Ces scènes sont évidemment des reconstitutions, une différence se faisant sentir dans la façon de s'exprimer, moins naturelle que celle que l'on perçoit dans les témoignages, et dans la manière de filmer, plus soignée que ne peut l'être un enregistrement sur le vif.
Cela peut gêner, mais bien des documentaristes de l'époque utilisaient le procédé et Octobre à Paris est un film militant, réactif, tout entier tendu vers la dénonciation d'un massacre et d'une situation révoltante. De plus, on imagine fort bien qu'organiser clandestinement, quelques jours après le 17 octobre, sur les lieux mêmes, cette amorce de manifestation, n'avait rien d'anodin ni de confortable.
En fait, plutôt que ces quelques minutes de reconstitution et d'illustration par des photographies, ce sont les témoignages qui les précèdent et qui les suivent qui frappent les esprits. Panijel va à la rencontre des Algériens, les filme au bidonville ou dans les petits appartements et surtout les écoute parler. Leurs témoignages sont ahurissants, avant même d'aborder la journée du 17 octobre. Le délit de faciès, le couvre-feu imposé qui permet alors les arrestations les plus arbitraires, les brutalités policières, les passages en centres de détention concentrationnaires, les tortures dans les caves par les Harkis...
Presque sans commentaire ajouté, Octobre à Paris est très bien réalisé et monté, et permet de libérer une parole alors rarement (sinon jamais) entendue, surtout venant de ces endroits-là (que l'on retrouvera dans le même état, dix ans plus tard, devant la caméra de Marcel Trillat et Frédéric Variot). Sa construction (avant, pendant, après la manifestation) est implacable et fait partager avec force la colère de ses auteurs à l'encontre d'un État français aux tendances fascistes.
(*) : Sur l'histoire d'Octobre à Paris, on peut lire cet entretien, paru en 2000 dans la revue Vacarme. Jacques Panijel, qui n'aura réalisé que cet unique film, est décédé en septembre dernier, à l'âge de 88 ans.

 Victime en 1976 d'une censure qui ne dit pas son nom (des bombes posées dans des cinémas parisiens le projetant provoquèrent l'arrêt de son exploitation au bout de quelques jours seulement) et malgré une resortie en salles en 2005, Gloria mundi reste un film rare, souvent inconnu (personnellement, ayant pourtant vu et apprécié, de Papatakis, La photo et Les équilibristes, j'ignorais son existence). A le découvrir aujourd'hui, on comprend vite les raisons de cet ostracisme. Œuvre furieuse, Gloria mundi, faisait tout pour déplaire à tout le monde.
Victime en 1976 d'une censure qui ne dit pas son nom (des bombes posées dans des cinémas parisiens le projetant provoquèrent l'arrêt de son exploitation au bout de quelques jours seulement) et malgré une resortie en salles en 2005, Gloria mundi reste un film rare, souvent inconnu (personnellement, ayant pourtant vu et apprécié, de Papatakis, La photo et Les équilibristes, j'ignorais son existence). A le découvrir aujourd'hui, on comprend vite les raisons de cet ostracisme. Œuvre furieuse, Gloria mundi, faisait tout pour déplaire à tout le monde. Dans le Chili du début des années 70, Mario traîne sa solitude entre son pavillon d'où il épie sa belle voisine Nancy et la morgue de la ville où il tape les rapports d'autopsie du médecin légiste. Sa voisine, il finit par l'aborder, l'inviter et coucher avec. La morgue, il y est consigné par l'armée pendant plusieurs heures : un coup d'état est en cours et les corps commencent à s'entasser dans les couloirs. Avec le médecin et son assistante, il se retrouve devant le cadavre de Salvador Allende. La voisine, elle, disparaît pour un temps.
Dans le Chili du début des années 70, Mario traîne sa solitude entre son pavillon d'où il épie sa belle voisine Nancy et la morgue de la ville où il tape les rapports d'autopsie du médecin légiste. Sa voisine, il finit par l'aborder, l'inviter et coucher avec. La morgue, il y est consigné par l'armée pendant plusieurs heures : un coup d'état est en cours et les corps commencent à s'entasser dans les couloirs. Avec le médecin et son assistante, il se retrouve devant le cadavre de Salvador Allende. La voisine, elle, disparaît pour un temps. En 84/85, La route des Indes (A passage to India) devait déjà apparaître comme un film déphasé, hors de son temps. David Lean sortait d'un silence de 14 ans (La fille de Ryan, 1970) sans se soucier le moins du monde des fluctuations de la mode au moment de livrer un ultime grand spectacle romanesque. La route des Indes, film classique, forcément. Film académique si vous y tenez. Mais si c'est cela l'académisme...
En 84/85, La route des Indes (A passage to India) devait déjà apparaître comme un film déphasé, hors de son temps. David Lean sortait d'un silence de 14 ans (La fille de Ryan, 1970) sans se soucier le moins du monde des fluctuations de la mode au moment de livrer un ultime grand spectacle romanesque. La route des Indes, film classique, forcément. Film académique si vous y tenez. Mais si c'est cela l'académisme... Comme Guillaume Canet, l'Argentin Martin Rejtman fait un cinéma "générationnel" et cela à plus d'un titre. Tout d'abord, les deux œuvres réunies dans ce coffret semblent adressées prioritairement à une génération précise, celle des gens qui avaient la vingtaine en 92 et la trentaine en 2003. Ensuite, leurs récits sont exclusivement consacrés à des personnages appartenant à celle-ci. Enfin, le premier des deux films proposés, Rapado, est lui-même à l'origine d'une naissance, celle du jeune cinéma argentin de la fin des années 90 dont les principaux représentants se nomment Pablo Trapero, Lucrecia Martel et Lisandro Alonso. Comme il arrive parfois, la reconnaissance rapide des talentueux chefs de file du mouvement a eu pour effet de laisser quelque peu dans l'ombre le réel initiateur - reconnu comme tel par ses cadets. Ainsi, ni Rapado ni Les gants magiques n'ont eu l'honneur d'être distribués dans les salles françaises (le second a tout de même été diffusé en 2006 sur Arte, chaîne coproductrice du film, ce qui avait alors permis à certains d'entre nous de le découvrir avec bonheur), à l'inverse de Silvia Prieto, deuxième long métrage de Rejtman datant de 1999 et sorti ici en... 2004. Depuis, plus rien ou presque (les filmographies indiquent seulement deux titres d'œuvres courtes et énigmatiques, réalisées après Les gants magiques). Cette livraison des Editions Epicentre est donc précieuse, imposant à nos yeux un auteur des plus attachants.
Comme Guillaume Canet, l'Argentin Martin Rejtman fait un cinéma "générationnel" et cela à plus d'un titre. Tout d'abord, les deux œuvres réunies dans ce coffret semblent adressées prioritairement à une génération précise, celle des gens qui avaient la vingtaine en 92 et la trentaine en 2003. Ensuite, leurs récits sont exclusivement consacrés à des personnages appartenant à celle-ci. Enfin, le premier des deux films proposés, Rapado, est lui-même à l'origine d'une naissance, celle du jeune cinéma argentin de la fin des années 90 dont les principaux représentants se nomment Pablo Trapero, Lucrecia Martel et Lisandro Alonso. Comme il arrive parfois, la reconnaissance rapide des talentueux chefs de file du mouvement a eu pour effet de laisser quelque peu dans l'ombre le réel initiateur - reconnu comme tel par ses cadets. Ainsi, ni Rapado ni Les gants magiques n'ont eu l'honneur d'être distribués dans les salles françaises (le second a tout de même été diffusé en 2006 sur Arte, chaîne coproductrice du film, ce qui avait alors permis à certains d'entre nous de le découvrir avec bonheur), à l'inverse de Silvia Prieto, deuxième long métrage de Rejtman datant de 1999 et sorti ici en... 2004. Depuis, plus rien ou presque (les filmographies indiquent seulement deux titres d'œuvres courtes et énigmatiques, réalisées après Les gants magiques). Cette livraison des Editions Epicentre est donc précieuse, imposant à nos yeux un auteur des plus attachants. Les films de Martin Rejtman se tiennent en équilibre entre l'ironie et la tendresse, donnant l'étrange sentiment d'une sincérité et d'une vérité qui se verraient légèrement distanciées. L'humour y est permanent mais léger et empreint de mélancolie. Il nait surtout d'un brillant montage. Ce qui arrive aux personnages est loin d'être drôle, ce n'est que l'assemblage de leurs déboires qui l'est. L'art du cinéaste est un art de la rime visuelle délicate, du running gag offert comme en passant, de la subtile variation des motifs, de l'ellipse souriante et de la concision (1h10 pour l'un, 1h25 pour l'autre).
Les films de Martin Rejtman se tiennent en équilibre entre l'ironie et la tendresse, donnant l'étrange sentiment d'une sincérité et d'une vérité qui se verraient légèrement distanciées. L'humour y est permanent mais léger et empreint de mélancolie. Il nait surtout d'un brillant montage. Ce qui arrive aux personnages est loin d'être drôle, ce n'est que l'assemblage de leurs déboires qui l'est. L'art du cinéaste est un art de la rime visuelle délicate, du running gag offert comme en passant, de la subtile variation des motifs, de l'ellipse souriante et de la concision (1h10 pour l'un, 1h25 pour l'autre).
 Un jeune homme et sa mère, craignant l'arrivée de soldats dans leur ville, se réfugient dans la jungle. Ils s'installent dans une cabane, élèvent des poules et font pousser des légumes. Le fils recueille un jour une femme laissée pour morte par des militaires dans la fôret. Les mois passent, la mère meurt, la femme accouche d'un garçon. Des années plus tard, nous retrouvons le couple et leur enfant, toujours installés dans leur refuge.
Un jeune homme et sa mère, craignant l'arrivée de soldats dans leur ville, se réfugient dans la jungle. Ils s'installent dans une cabane, élèvent des poules et font pousser des légumes. Le fils recueille un jour une femme laissée pour morte par des militaires dans la fôret. Les mois passent, la mère meurt, la femme accouche d'un garçon. Des années plus tard, nous retrouvons le couple et leur enfant, toujours installés dans leur refuge. Yang Ik-june, jeune réalisateur-scénariste-producteur-acteur principal, n'est pas Jean-Luc Godard. Il ne s'en réclame d'ailleurs aucunement. Mais son Breathless affiche le même air frondeur qu'A bout de souffle et les points communs entre les deux films ne sont pas rares. Ces deux premiers longs métrages réalisés comme en contrebande et lancés sans ménagement à la figure des spectateurs partagent notamment, au-delà d'une entrée en matière fracassante, une envie d'en découdre avec le monde environnant, une figure centrale de petite frappe, une rencontre décisive avec une jeune femme, une vulgarité provocatrice dans les dialogues, une prédilection pour la cigarette et une fin tragique...
Yang Ik-june, jeune réalisateur-scénariste-producteur-acteur principal, n'est pas Jean-Luc Godard. Il ne s'en réclame d'ailleurs aucunement. Mais son Breathless affiche le même air frondeur qu'A bout de souffle et les points communs entre les deux films ne sont pas rares. Ces deux premiers longs métrages réalisés comme en contrebande et lancés sans ménagement à la figure des spectateurs partagent notamment, au-delà d'une entrée en matière fracassante, une envie d'en découdre avec le monde environnant, une figure centrale de petite frappe, une rencontre décisive avec une jeune femme, une vulgarité provocatrice dans les dialogues, une prédilection pour la cigarette et une fin tragique...
 Puissant. Sans doute trop. Et aussi trop chargé, trop long, trop large serait-on tenté d'ajouter à la suite. Je me demande toutefois s'il n'est pas un peu vain de se plaindre ainsi car cela revient en fait à regretter qu'Iñarritu n'aille pas assez contre sa nature. Or, il faut bien reconnaître que, sur bien des points, il a mis la pédale douce par rapport à son précédent film, Babel, et que sa décision de se passer dorénavant de son encombrant scénariste Guillermo Arriaga lui a été bénéfique et lui ouvre de nouveaux horizons, cette collaboration, après deux réussites spectaculaires, ayant montré crûment ses limites au troisième essai.
Puissant. Sans doute trop. Et aussi trop chargé, trop long, trop large serait-on tenté d'ajouter à la suite. Je me demande toutefois s'il n'est pas un peu vain de se plaindre ainsi car cela revient en fait à regretter qu'Iñarritu n'aille pas assez contre sa nature. Or, il faut bien reconnaître que, sur bien des points, il a mis la pédale douce par rapport à son précédent film, Babel, et que sa décision de se passer dorénavant de son encombrant scénariste Guillermo Arriaga lui a été bénéfique et lui ouvre de nouveaux horizons, cette collaboration, après deux réussites spectaculaires, ayant montré crûment ses limites au troisième essai.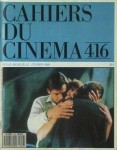
 1989 : La fin de l'année voit les Cahiers changer de formule et modifier légèrement leur comité de rédaction, dans lequel entre notamment Nicolas Saada, tandis que Thierry Jousse en devient le rédacteur en chef adjoint. Au niveau des auteurs, Coppola (Tucker), Cronenberg (Faux-semblants), Moretti (Palombella rossa), Rivette (La bande des quatre) semblent, pour la revue, se détacher mais d'autres cinéastes sont rencontrés au fil des mois : Claude Zidi (pour Deux), Bertrand Blier (Trop belle pour toi), Spike Lee (Do the right thing), Idrissa Ouedraogo (Yaaba), Philippe Garrel (Les baisers de secours), Emir Kusturica (Le temps des gitans). Ganashatru de Satyajit Ray, La fille de quinze ans de Jacques Doillon, Batman de Tim Burton, Abyss de James Cameron et Route One / USA de Robert Kramer font partie des films mis en avant, à côté de textes sur les "films-rock", sur le bicentenaire de la Révolution française ou sur les cinémas hongrois et soviétique, de rencontres avec Tsui Hark, Daniel Auteuil, Rob Reiner, Robby Müller et Adolph Green, d'un spécial cinéma français en mai, d'un retour sur Pasolini, d'hommages à John Cassavetes, Sergio Leone et Jacques Doniol-Valcroze et de deux tables rondes, l'une à propos de Pickpocket de Robert Bresson, l'autre du cinéma français.
1989 : La fin de l'année voit les Cahiers changer de formule et modifier légèrement leur comité de rédaction, dans lequel entre notamment Nicolas Saada, tandis que Thierry Jousse en devient le rédacteur en chef adjoint. Au niveau des auteurs, Coppola (Tucker), Cronenberg (Faux-semblants), Moretti (Palombella rossa), Rivette (La bande des quatre) semblent, pour la revue, se détacher mais d'autres cinéastes sont rencontrés au fil des mois : Claude Zidi (pour Deux), Bertrand Blier (Trop belle pour toi), Spike Lee (Do the right thing), Idrissa Ouedraogo (Yaaba), Philippe Garrel (Les baisers de secours), Emir Kusturica (Le temps des gitans). Ganashatru de Satyajit Ray, La fille de quinze ans de Jacques Doillon, Batman de Tim Burton, Abyss de James Cameron et Route One / USA de Robert Kramer font partie des films mis en avant, à côté de textes sur les "films-rock", sur le bicentenaire de la Révolution française ou sur les cinémas hongrois et soviétique, de rencontres avec Tsui Hark, Daniel Auteuil, Rob Reiner, Robby Müller et Adolph Green, d'un spécial cinéma français en mai, d'un retour sur Pasolini, d'hommages à John Cassavetes, Sergio Leone et Jacques Doniol-Valcroze et de deux tables rondes, l'une à propos de Pickpocket de Robert Bresson, l'autre du cinéma français.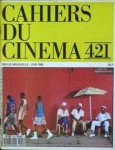
 Quitte à choisir : Un seul film partagé (et toujours inconnu de mes services, tout comme ceux d'Assayas et Schatzberg, de Sturges et Walsh) mais un bilan finalement équilibré. De chaque côté, la liste paraît cohérente et sans réelle anomalie, même si l'on peut ergoter en quelques endroits (l'accrocheur doublé automnal des Cahiers, les choix positivistes de février et d'octobre...). Allez, pour 1989 : Match nul.
Quitte à choisir : Un seul film partagé (et toujours inconnu de mes services, tout comme ceux d'Assayas et Schatzberg, de Sturges et Walsh) mais un bilan finalement équilibré. De chaque côté, la liste paraît cohérente et sans réelle anomalie, même si l'on peut ergoter en quelques endroits (l'accrocheur doublé automnal des Cahiers, les choix positivistes de février et d'octobre...). Allez, pour 1989 : Match nul.