(Robert Kramer / Etats-Unis / 1969 & Robert Kramer et John Douglas / Etats-Unis / 1975)
■■■□ / ■■■□
Ice et Milestones : ces titres étaient connus mais les films si peu vus. Les éditions Capricci les regroupent dans un coffret et redonnent ainsi vie à deux œuvres mythiques du cinéma indépendant et de la contestation américaine des années 70. Cette livraison DVD ne s'accompagne d'aucun bonus, ce qui peut paraître surprenant eu égard à la richesse sociale et politique du propos, à la complexité du fond et de la forme, à la multiplicité des pistes explorées. Pour mieux accepter cette absence, nous pouvons toutefois avancer que Robert Kramer a réalisé là, de son propre aveu, des films "ouverts", auxquels le spectateur doit se confronter "seul". Et, en un certain sens, ceux-ci n'ont guère besoin d'étude complémentaire puisqu'ils partagent cette étonnante caractéristique de proposer leur propre analyse au fur et à mesure de leur déroulement - argument qui, je l'espère, ne vous empêchera pas de poursuivre la lecture de la présente critique.
 En 1969, le fer est encore chaud et les mouvements révolutionnaires et contestataires ne sont pas encore plongés dans leur crise du début des années 70 (aux origines diverses : fin de la guerre du Vietnam, radicalisation terroriste, repli communautaire...), crise dont Milestones tentera de tirer les leçons le moment venu. Le double mouvement qui propulse Ice, activisme et auto-critique, en est d'autant plus remarquable. Le statut des images qui le compose est ambigu : la fiction est évidente, ne serait-ce que par le point de départ du récit - la guerre déclarée par les Etats-Unis au Mexique -, mais l'esthétique s'apparente le plus souvent à celle du reportage (un reportage qui serait toutefois redevable à Cassavetes et au Godard d'Alphaville). De plus, le nombre de protagonistes est élevé, autorisant ainsi une multiplicité des points de vue, et de nombreux cartons de propagande révolutionnaire sont insérés, sans que nous soyons sûr de devoir les prendre au premier degré, leur présence pouvant véhiculer, plutôt que ceux des auteurs, les messages du "comité central révolutionnaire" censé dirigé les actions décrites.
En 1969, le fer est encore chaud et les mouvements révolutionnaires et contestataires ne sont pas encore plongés dans leur crise du début des années 70 (aux origines diverses : fin de la guerre du Vietnam, radicalisation terroriste, repli communautaire...), crise dont Milestones tentera de tirer les leçons le moment venu. Le double mouvement qui propulse Ice, activisme et auto-critique, en est d'autant plus remarquable. Le statut des images qui le compose est ambigu : la fiction est évidente, ne serait-ce que par le point de départ du récit - la guerre déclarée par les Etats-Unis au Mexique -, mais l'esthétique s'apparente le plus souvent à celle du reportage (un reportage qui serait toutefois redevable à Cassavetes et au Godard d'Alphaville). De plus, le nombre de protagonistes est élevé, autorisant ainsi une multiplicité des points de vue, et de nombreux cartons de propagande révolutionnaire sont insérés, sans que nous soyons sûr de devoir les prendre au premier degré, leur présence pouvant véhiculer, plutôt que ceux des auteurs, les messages du "comité central révolutionnaire" censé dirigé les actions décrites.
Ces actions menées, au cours d'une seule nuit, contre un état oppresseur, apparaissent nécessaires mais sont constamment interrogées. Elles se préparent au cours de longues discussions de groupe, desquelles émergent, autant que la ferveur, les doutes et les peurs. Toute la première partie du film est consacré à ces échanges. La parole est laissée à tous, y compris à ceux les plus en marge des groupes clandestins et à ceux qui restent intégrés à la société. Cette parole supporte donc la contradiction. De façon assez surprenante, Ice, tout porté vers l'action qu'il soit, décrit ainsi une révolution qui serait la somme de parties imprégnées de doute.
Par conséquent, il apparaît logique que l'idée de cette révolution se structure à partir de l'intime. Nous assistons, entre les réunions et les rendez-vous clandestins, à plusieurs scènes de couple, scènes de drague ou scènes d'amour, et c'est bien à ce niveau-là que commencent à se déceler les possibles trahisons et compromissions. L'oppresseur lui-même en est conscient et sait où frapper : les tortures infligées aux activistes arrêtés sont d'ordre sexuel. Il s'agit apparemment de s'en prendre à la virilité des rebelles, ce que montre une séquence violente au début du film.
Celle-ci nous saisit d'autant plus que l'explication n'en est pas donnée sur l'instant. Par ailleurs, nous notons que la victime est interprétée par Robert Kramer lui-même. Plus tard, avant qu'il ne soit tué, nous le verrons, bien que plus au calme, dans une position peu agréable, obligé de partager un appartement avec un couple d'amis peu enclin à lui faciliter son travail de traducteur pour le compte de son organisation. Ice multiplie ainsi les outils de distanciation, s'appuyant sur les slogans, le théâtre, le cinéma, l'improvisation. Il se termine sur une satire de la politique impérialiste, réalisée à l'aide de jouets d'enfants mais son véritable final a lieu dans une cabine téléphonique, autour de laquelle tourne la caméra, entre ténèbres et espoir. Tout du long, cette politique-fiction de Kramer bénéficie de l'adéquation évidente entre le propos, les moyens et l'esthétique.
 Tout prospectif qu'il soit, Ice renvoie constamment à son époque. Milestones, que Kramer coréalisa avec John Douglas, a tissé lui aussi un lien si fort avec la réalité de son temps qu'il est aussitôt devenu un film-phare de la décennie 70. A le découvrir aujourd'hui, avant ce qu'il montre, c'est la façon de le faire qui interpelle en premier lieu. Le film démarre comme un documentaire relativement traditionnel, construit à partir d'images prises dans la rue, au domicile ou au travail et de discussions longues et naturelles. Le montage plutôt serré, les champs-contrechamps, le déroulement même des échanges commencent cependant à donner l'impression de dialogues répondant à une incitation sur un thème donné. Puis surviennent la visualisation de rêves, une scène d'agression réaliste mais évidemment fictive, une scène de ménage, un cambriolage raté... La fiction est démasquée, envahit le film, bouscule nos repères. Un accouchement ne peut certes pas être "joué" mais la quasi-totalité de ce que l'on voit et entend dans Milestones a été écrit à l'avance.
Tout prospectif qu'il soit, Ice renvoie constamment à son époque. Milestones, que Kramer coréalisa avec John Douglas, a tissé lui aussi un lien si fort avec la réalité de son temps qu'il est aussitôt devenu un film-phare de la décennie 70. A le découvrir aujourd'hui, avant ce qu'il montre, c'est la façon de le faire qui interpelle en premier lieu. Le film démarre comme un documentaire relativement traditionnel, construit à partir d'images prises dans la rue, au domicile ou au travail et de discussions longues et naturelles. Le montage plutôt serré, les champs-contrechamps, le déroulement même des échanges commencent cependant à donner l'impression de dialogues répondant à une incitation sur un thème donné. Puis surviennent la visualisation de rêves, une scène d'agression réaliste mais évidemment fictive, une scène de ménage, un cambriolage raté... La fiction est démasquée, envahit le film, bouscule nos repères. Un accouchement ne peut certes pas être "joué" mais la quasi-totalité de ce que l'on voit et entend dans Milestones a été écrit à l'avance.
Il ne faut pas voir dans cette construction une manipulation déplaisante du spectateur. Tout d'abord, le fait de croire autant et si longtemps à une vérité documentaire absolue prouve la qualité du travail. Surtout, ce glissement et cette révélation ajoutent encore à la complexité et à la richesse d'une œuvre déjà "objectivement" monstrueuse. Sa durée de trois heures et vingt minutes confine au vertige. Elle permet de laisser une large place aux discussions et aux débats qui libèrent à nouveau une masse de contradictions, les personnes/personnages que filment Kramer et Douglas essayant de se repositionner après les désenchantements de la période post-68. Dilemmes et décalages ne cessent donc d'affleurer chez ces gens ayant cherché, à un moment ou un autre, à vivre leur vie autrement : les tiraillements se font entre désir de solitude et vie en communauté, nomadisme et sédentarisation, affranchissement familial et besoin de lien filial. Le tableau est riche et si les cinéastes ont suivi essentiellement des individus appartenant, au sens large, à un groupe dont ils faisaient partie, Milestones ne se réduit nullement à la description de la vie quotidienne "hippie".
En effet, c'est bien l'histoire des Etats-Unis, pas moins, que convoque le film, puisque le récit est entrecoupé de souvenirs et de références photographiques ou cinématographiques renvoyant à l'esclavage, au génocide indien, à l'entre-deux guerres ou, bien sûr, au Vietnam. Ce récit, dont on pense qu'il va aboutir, à force de croisements entre les divers personnages, à la (re)constitution d'une communauté, éclate au contraire en mille morceaux, dans le temps, dans le paysage américain (le nombre de lieux arpentés est impressionnant) et dans l'espace mental des protagonistes (et donc des auteurs). Si le film paraît tout de même, en bout de course, se "boucler", il reste particulièrement ouvert (et ouvert aux quatre vents, ce qui provoque d'inévitables courants d'air : certains passages, certaines expériences humaines ne sont pas, prises séparément, d'un immense intérêt). L'accouchement final auquel nous assistons peut être pris pour une métaphore du film entier. De la façon directe, impudique et tenace dont il est présenté au spectateur, il paraît long et difficile mais au bout du compte honnête et libérateur. Là aussi, donc, l'espoir subsiste. Que Milestones intègre aussi intelligemment sa propre dimension réflexive et que les doutes qui s'y expriment permettent d'avancer, cela démontre que la grande œuvre polyphonique de Kramer et Douglas n'est pas une chronique du fourvoiement post-soixante-huitard mais bien un essai cinématographique chaotique et passionnant sur un moment-clé de l'histoire de la gauche américaine.
Chronique dvd pour 

 La caméra gigote ou se colle, les intermèdes ont l'allure de la confession télévisée mal assurée, les scènes de lit sont maniéristes et monochromes, rouges, puis vertes, puis bleues. Les réminiscences cinématographiques se succédent toutes les cinq minutes et chacun peut en faire une moisson, suivant ses goûts et ses connaissances : Godard, Wong Kar-wai, Eustache, Arcand, Edwards, Demy, Truffaut... Les musiques sont mises bout à bout : sur une corde à linge sont accrochés Bach et Dalida, Indochine et House of Pain, Police et France Gall. Et Xavier Dolan veut tout faire : metteur en scène, acteur, dialoguiste, scénariste, monteur, costumier, décorateur...
La caméra gigote ou se colle, les intermèdes ont l'allure de la confession télévisée mal assurée, les scènes de lit sont maniéristes et monochromes, rouges, puis vertes, puis bleues. Les réminiscences cinématographiques se succédent toutes les cinq minutes et chacun peut en faire une moisson, suivant ses goûts et ses connaissances : Godard, Wong Kar-wai, Eustache, Arcand, Edwards, Demy, Truffaut... Les musiques sont mises bout à bout : sur une corde à linge sont accrochés Bach et Dalida, Indochine et House of Pain, Police et France Gall. Et Xavier Dolan veut tout faire : metteur en scène, acteur, dialoguiste, scénariste, monteur, costumier, décorateur... Concernant la majeure partie des films que j'ai pu effectivement voir en ce temps là, ma mémoire me trahit. Mais autant vous dire que cela m'arrange bien... Ainsi, de Hold-up, la comédie policière d'Alexandre Arcady supposée relancer de plus belle la carrière de Jean-Paul Belmondo, il ne me reste que les images de journal télévisé montrant l'accident de dépanneuse de Bébel sur le tournage. Le mariage du siècle, de Philippe Galland, satire des moeurs princières avec Anémone et Lhermitte, ne m'est pas mieux resté en tête. Je peux toutefois avancer, sans prendre de risque, que, aussi faible qu'elle soit, cette comédie reste moins affligeante que le
Concernant la majeure partie des films que j'ai pu effectivement voir en ce temps là, ma mémoire me trahit. Mais autant vous dire que cela m'arrange bien... Ainsi, de Hold-up, la comédie policière d'Alexandre Arcady supposée relancer de plus belle la carrière de Jean-Paul Belmondo, il ne me reste que les images de journal télévisé montrant l'accident de dépanneuse de Bébel sur le tournage. Le mariage du siècle, de Philippe Galland, satire des moeurs princières avec Anémone et Lhermitte, ne m'est pas mieux resté en tête. Je peux toutefois avancer, sans prendre de risque, que, aussi faible qu'elle soit, cette comédie reste moins affligeante que le  Dernier titre connu de mes services dans le listing du mois : Papa est en voyage d'affaires, le deuxième long-métrage et la première Palme d'or d'Emir Kusturica. La récompense, attribuée par Milos Forman et son jury, était inattendue mais s'avéra méritée, le film, quoique moins irrésistiblement débridé que les suivants, constituant la première œuvre majeure du cinéaste. Notre souvenir n'en est pas très précis mais chaleureux.
Dernier titre connu de mes services dans le listing du mois : Papa est en voyage d'affaires, le deuxième long-métrage et la première Palme d'or d'Emir Kusturica. La récompense, attribuée par Milos Forman et son jury, était inattendue mais s'avéra méritée, le film, quoique moins irrésistiblement débridé que les suivants, constituant la première œuvre majeure du cinéaste. Notre souvenir n'en est pas très précis mais chaleureux.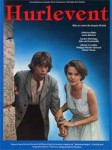 On sent que l'on commence peut-être à basculer du bon côté avec Le Roi David (péplum de Bruce Beresford avec Richard Gere), Le dernier jour d'un condamné (de Jean-Michel Mongrédien d'après Victor Hugo) et Que la vérité est amère (documentaire sur l'arrestation de Jean Moulin, réalisé par Alain Brunet et Claude Bal). Puis viennent à nous trois propositions singulières d'auteurs confidentiels mais reconnus. Elle a passé tant d'heures sous les sunlights est un austère essai d'auto-analyse effectué par Philippe Garrel (j'avoue avoir toujours trouvé nul ce titre de film, qui aurait tendance à susciter finalement autant de ricanements que le Rambo II précité...). Hurlevent n'est pas le Rivette le plus aguichant ni le plus convoqué par les admirateurs du cinéaste, mais son sujet (d'après Emily Brontë, bien sûr) et son casting (Fabienne Babe, Lucas Belvaux...) intriguent. De ce petit groupe, peut-être faut-il en fait détacher Trous de mémoire, de et avec Paul Vecchiali, expérience minimaliste à base d'improvisations développées avec Françoise Lebrun.
On sent que l'on commence peut-être à basculer du bon côté avec Le Roi David (péplum de Bruce Beresford avec Richard Gere), Le dernier jour d'un condamné (de Jean-Michel Mongrédien d'après Victor Hugo) et Que la vérité est amère (documentaire sur l'arrestation de Jean Moulin, réalisé par Alain Brunet et Claude Bal). Puis viennent à nous trois propositions singulières d'auteurs confidentiels mais reconnus. Elle a passé tant d'heures sous les sunlights est un austère essai d'auto-analyse effectué par Philippe Garrel (j'avoue avoir toujours trouvé nul ce titre de film, qui aurait tendance à susciter finalement autant de ricanements que le Rambo II précité...). Hurlevent n'est pas le Rivette le plus aguichant ni le plus convoqué par les admirateurs du cinéaste, mais son sujet (d'après Emily Brontë, bien sûr) et son casting (Fabienne Babe, Lucas Belvaux...) intriguent. De ce petit groupe, peut-être faut-il en fait détacher Trous de mémoire, de et avec Paul Vecchiali, expérience minimaliste à base d'improvisations développées avec Françoise Lebrun.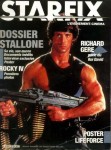 En octobre 85, dans la Maison de la presse à côté de chez vous, vous avez alors pu voir avec dépit que Sylvester Stallone s'affichait un peu partout, notamment en une de Starfix (29) et de L'Ecran Fantastique (61). La Revue du Cinéma (409) vous proposait, elle, mais un peu trop tard, de revenir sur le troisième épisode de Mad Max et Positif (296) sur le Ran de Kurosawa (deux films sortis en septembre). Vous avez croisé le regard de Jean-Paul Belmondo en couverture de Premiere (103) et vous avez hésité à acheter les Cahiers du Cinéma (376) qui parlaient de Rivette et de son Hurlevent. Comme vous sortiez d'une séance de Retour vers le futur, vous avez cherché en vain Studio-CinéLive, oubliant que ni l'un ni l'autre n'existaient encore. Et puis finalement, vous avez pris L'Equipe, un paquet de Lucky et une grille de loto...
En octobre 85, dans la Maison de la presse à côté de chez vous, vous avez alors pu voir avec dépit que Sylvester Stallone s'affichait un peu partout, notamment en une de Starfix (29) et de L'Ecran Fantastique (61). La Revue du Cinéma (409) vous proposait, elle, mais un peu trop tard, de revenir sur le troisième épisode de Mad Max et Positif (296) sur le Ran de Kurosawa (deux films sortis en septembre). Vous avez croisé le regard de Jean-Paul Belmondo en couverture de Premiere (103) et vous avez hésité à acheter les Cahiers du Cinéma (376) qui parlaient de Rivette et de son Hurlevent. Comme vous sortiez d'une séance de Retour vers le futur, vous avez cherché en vain Studio-CinéLive, oubliant que ni l'un ni l'autre n'existaient encore. Et puis finalement, vous avez pris L'Equipe, un paquet de Lucky et une grille de loto...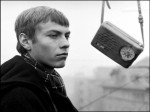 Comme la plupart des titres composant le catalogue de Malavida, éditeur s'étant donné pour noble tâche de sortir les films des nouveaux cinémas nord et est-européens des années 60 de l'ombre dans laquelle ils se sont progressivement vus rejetés, Le soleil dans le filet (Slnko v sieti) est alléchant. A l'origine de la seconde naissance d'un cinéma slovaque quasi-inexistant jusque-là, le film de Stefan Uher est également auréolé d'une réputation de précurseur de la nouvelle vague ayant porté ses voisins de la région tchèque, Milos Forman en tête.
Comme la plupart des titres composant le catalogue de Malavida, éditeur s'étant donné pour noble tâche de sortir les films des nouveaux cinémas nord et est-européens des années 60 de l'ombre dans laquelle ils se sont progressivement vus rejetés, Le soleil dans le filet (Slnko v sieti) est alléchant. A l'origine de la seconde naissance d'un cinéma slovaque quasi-inexistant jusque-là, le film de Stefan Uher est également auréolé d'une réputation de précurseur de la nouvelle vague ayant porté ses voisins de la région tchèque, Milos Forman en tête.
 En 1969, le fer est encore chaud et les mouvements révolutionnaires et contestataires ne sont pas encore plongés dans leur crise du début des années 70 (aux origines diverses : fin de la guerre du Vietnam, radicalisation terroriste, repli communautaire...), crise dont Milestones tentera de tirer les leçons le moment venu. Le double mouvement qui propulse Ice, activisme et auto-critique, en est d'autant plus remarquable. Le statut des images qui le compose est ambigu : la fiction est évidente, ne serait-ce que par le point de départ du récit - la guerre déclarée par les Etats-Unis au Mexique -, mais l'esthétique s'apparente le plus souvent à celle du reportage (un reportage qui serait toutefois redevable à Cassavetes et au Godard d'Alphaville). De plus, le nombre de protagonistes est élevé, autorisant ainsi une multiplicité des points de vue, et de nombreux cartons de propagande révolutionnaire sont insérés, sans que nous soyons sûr de devoir les prendre au premier degré, leur présence pouvant véhiculer, plutôt que ceux des auteurs, les messages du "comité central révolutionnaire" censé dirigé les actions décrites.
En 1969, le fer est encore chaud et les mouvements révolutionnaires et contestataires ne sont pas encore plongés dans leur crise du début des années 70 (aux origines diverses : fin de la guerre du Vietnam, radicalisation terroriste, repli communautaire...), crise dont Milestones tentera de tirer les leçons le moment venu. Le double mouvement qui propulse Ice, activisme et auto-critique, en est d'autant plus remarquable. Le statut des images qui le compose est ambigu : la fiction est évidente, ne serait-ce que par le point de départ du récit - la guerre déclarée par les Etats-Unis au Mexique -, mais l'esthétique s'apparente le plus souvent à celle du reportage (un reportage qui serait toutefois redevable à Cassavetes et au Godard d'Alphaville). De plus, le nombre de protagonistes est élevé, autorisant ainsi une multiplicité des points de vue, et de nombreux cartons de propagande révolutionnaire sont insérés, sans que nous soyons sûr de devoir les prendre au premier degré, leur présence pouvant véhiculer, plutôt que ceux des auteurs, les messages du "comité central révolutionnaire" censé dirigé les actions décrites. Tout prospectif qu'il soit, Ice renvoie constamment à son époque. Milestones, que Kramer coréalisa avec John Douglas, a tissé lui aussi un lien si fort avec la réalité de son temps qu'il est aussitôt devenu un film-phare de la décennie 70. A le découvrir aujourd'hui, avant ce qu'il montre, c'est la façon de le faire qui interpelle en premier lieu. Le film démarre comme un documentaire relativement traditionnel, construit à partir d'images prises dans la rue, au domicile ou au travail et de discussions longues et naturelles. Le montage plutôt serré, les champs-contrechamps, le déroulement même des échanges commencent cependant à donner l'impression de dialogues répondant à une incitation sur un thème donné. Puis surviennent la visualisation de rêves, une scène d'agression réaliste mais évidemment fictive, une scène de ménage, un cambriolage raté... La fiction est démasquée, envahit le film, bouscule nos repères. Un accouchement ne peut certes pas être "joué" mais la quasi-totalité de ce que l'on voit et entend dans Milestones a été écrit à l'avance.
Tout prospectif qu'il soit, Ice renvoie constamment à son époque. Milestones, que Kramer coréalisa avec John Douglas, a tissé lui aussi un lien si fort avec la réalité de son temps qu'il est aussitôt devenu un film-phare de la décennie 70. A le découvrir aujourd'hui, avant ce qu'il montre, c'est la façon de le faire qui interpelle en premier lieu. Le film démarre comme un documentaire relativement traditionnel, construit à partir d'images prises dans la rue, au domicile ou au travail et de discussions longues et naturelles. Le montage plutôt serré, les champs-contrechamps, le déroulement même des échanges commencent cependant à donner l'impression de dialogues répondant à une incitation sur un thème donné. Puis surviennent la visualisation de rêves, une scène d'agression réaliste mais évidemment fictive, une scène de ménage, un cambriolage raté... La fiction est démasquée, envahit le film, bouscule nos repères. Un accouchement ne peut certes pas être "joué" mais la quasi-totalité de ce que l'on voit et entend dans Milestones a été écrit à l'avance. Une douceur après le désagréable
Une douceur après le désagréable 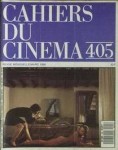
 1988 : Cinq couvertures en commun (Erice, Kaufman, Polanski, Eastwood, Scorsese) et six autres qui auraient pu l'être (Huston, Depardon, Varda, Brisseau, Kieslowski, Angelopoulos) : ce ne sont pas vraiment les différences entre les deux revues que l'on retiendra de cette année-là (d'autant moins qu'elle résident dans des prises de position bien connues, autour de Godard, Truffaut, Sautet ou Demy). Les sommaires s'accordent également sur bien des sujets : le cinéma soviétique "libéré" (dont celui de Kira Muratova), le cinéma du réel (en plus de Varda, Depardon, et Ophuls pour son Hôtel Terminus, Positif rencontre Les Blank et Juris Podnieks et les Cahiers Frederick Wiseman), les muets de Dreyer et Lang, Chen Kaige, Chris Menges (Un monde à part), Robert Zemeckis (Qui veut la peau de Roger Rabbit) et même Rossellini !
1988 : Cinq couvertures en commun (Erice, Kaufman, Polanski, Eastwood, Scorsese) et six autres qui auraient pu l'être (Huston, Depardon, Varda, Brisseau, Kieslowski, Angelopoulos) : ce ne sont pas vraiment les différences entre les deux revues que l'on retiendra de cette année-là (d'autant moins qu'elle résident dans des prises de position bien connues, autour de Godard, Truffaut, Sautet ou Demy). Les sommaires s'accordent également sur bien des sujets : le cinéma soviétique "libéré" (dont celui de Kira Muratova), le cinéma du réel (en plus de Varda, Depardon, et Ophuls pour son Hôtel Terminus, Positif rencontre Les Blank et Juris Podnieks et les Cahiers Frederick Wiseman), les muets de Dreyer et Lang, Chen Kaige, Chris Menges (Un monde à part), Robert Zemeckis (Qui veut la peau de Roger Rabbit) et même Rossellini !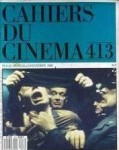
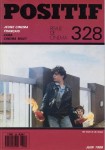 Quitte à choisir : Cherchons donc parmi les différences...
Quitte à choisir : Cherchons donc parmi les différences...

 Revoir sur grand écran Les Vikings (The Vikings) c'est apprécier le savoir-faire technique de Richard Fleischer et son emploi efficace du Scope (des panoramiques sur les fjords aux gros plans sur les visages), c'est baigner dans les belles images de Jack Cardiff (en particulier lors des remarquables scènes de navigation dans la brume), c'est relever par endroits un louable souci d'authenticité (et un tournage en décors réels), c'est être saisi par quelques fulgurances stylistiques (les vigoureuses entrées dans le champ, les contre-plongées du duel final) et plusieurs pointes de sauvagerie (l'attaque du faucon, le jeu de la hache, la fosse aux loups, la main tranchée), c'est profiter des bonnes interprétations de Tony Curtis, d'Ernest Borgnine, de Janet Leigh et de Kirk Douglas, star et producteur, dont le personnage d'Einar, nous dit-on, refuse de se laisser pousser la barbe, à l'inverse de tous ses camarades vikings, mais se voit dans la foulée à moitié défiguré...
Revoir sur grand écran Les Vikings (The Vikings) c'est apprécier le savoir-faire technique de Richard Fleischer et son emploi efficace du Scope (des panoramiques sur les fjords aux gros plans sur les visages), c'est baigner dans les belles images de Jack Cardiff (en particulier lors des remarquables scènes de navigation dans la brume), c'est relever par endroits un louable souci d'authenticité (et un tournage en décors réels), c'est être saisi par quelques fulgurances stylistiques (les vigoureuses entrées dans le champ, les contre-plongées du duel final) et plusieurs pointes de sauvagerie (l'attaque du faucon, le jeu de la hache, la fosse aux loups, la main tranchée), c'est profiter des bonnes interprétations de Tony Curtis, d'Ernest Borgnine, de Janet Leigh et de Kirk Douglas, star et producteur, dont le personnage d'Einar, nous dit-on, refuse de se laisser pousser la barbe, à l'inverse de tous ses camarades vikings, mais se voit dans la foulée à moitié défiguré... En décembre 1937, dans la guerre qui l'oppose à la Chine, l'armée impériale japonaise remporte la bataille de Nankin. Après avoir massacré les soldats chinois fait prisonniers, elle commet pendant des semaines des atrocités sur les civils : viols collectifs, tortures, exécutions de masse... Le nombre de 300 000 morts est celui qui est le plus souvent avancé.
En décembre 1937, dans la guerre qui l'oppose à la Chine, l'armée impériale japonaise remporte la bataille de Nankin. Après avoir massacré les soldats chinois fait prisonniers, elle commet pendant des semaines des atrocités sur les civils : viols collectifs, tortures, exécutions de masse... Le nombre de 300 000 morts est celui qui est le plus souvent avancé.