Mes notes précédentes sur le sujet m'ont laissé insatisfait, je reprends tout. Puisque ma volonté était de retracer deux parcours parallèles, autant me placer résolument au point de départ afin de ne pas donner l'impression que quelque chose manque.
Il s'agit donc de déterminer crânement qui, des deux principales revues françaises de cinéma, avait raison, en confrontant leurs choix respectifs de films ou de cinéastes mis en couverture. J'en suis conscient, la démarche est contestable, voire totalement idiote. Elle n'est de toute manière, soyez-en sûr, qu'un prétexte à remettre en mémoire ou à faire découvrir de belles unes.
Nous sommes tous d'accord avec Bo Diddley et les Yardbirds : You can't judge a book by looking at the cover. Il est évident que cette partie émergée de l'iceberg, quelque soit l'intégrité morale et l'honnêteté esthétique des responsables successifs des deux revues, ne dit pas tout de Positif et des Cahiers. D'une part, un choix de couverture pour un mensuel de cinéma est évidemment tributaire de l'actualité. D'autre part, tel film mis en avant à un moment précis pour sa séduction immédiate et pour sa valeur emblématique d'un air du temps, paraîtra de nos jours bien anodin, masquant parfois de surcroît un texte ou un ensemble sur une oeuvre d'une toute autre ampleur parue dans le même numéro. Une fois admis cela, on se rend compte toutefois que, sur la durée, le puzzle prend forme et l'image qui s'en dégage traduit fidèlement l'identité de la revue. Chacune puise d'ailleurs à l'occasion dans l'histoire de ses couvertures, jouant ainsi sur ce lien entre elle et le lecteur : pour fêter son quarantième anniversaire, l'équipe de Positif avait choisi pour chaque année passée une de ses couvertures et programmé le film correspondant lors d'une rétrospective; à l'occasion de leurs 50 ans, les Cahiers avaient reproduit en bas de pages du numéro d'avril 2001 toutes les leurs.
Enfin, en ces temps où beaucoup de cinéphiles, blogueurs ou non, font la moue devant l'état du cinéma et celui de la critique (je ne suis d'ailleurs pas toujours le dernier à la faire), chacun pourra peut-être mesurer l'importance (ou l'absence) de l'écart entre hier et aujourd'hui et, parallèlement, ceux qui se sont entichés à un moment ou à un autre de l'un des deux titres pourront voir si leur préférence se visualise nettement à travers cette série de couvertures historiques.
*****
1951 : Naissance des Cahiers du Cinéma, sous-titrés "Revue du cinéma et du télécinéma". Les parents officiels (rédacteurs en chef fondateurs) sont au nombre de trois : Jacques Doniol-Valcroze, Lo Duca et André Bazin. La première couverture consacre un Wilder mais c'est plutôt Edward Dmytryk et son Donnez-nous aujourd'hui qui se retrouve au centre de ce numéro. Ensuite, ce sont Mankiewicz, Bresson, DeMille, Sternberg, McLaren et Buñuel qui se voient célébrés. Maurice Schérer (Eric Rohmer) écrit son texte "Vanité que la peinture" et l'on se penche sur le nouveau cinéma allemand.


Avril : Boulevard du crépuscule (Billy Wilder, Cahiers du Cinéma n°1)
Mai : Eve (Joseph L. Mankiewicz, C2)
Juin : Tabou (F.W. Murnau et Robert Flaherty, C3)
Juillet : Mademoiselle Julie (Alf Sjöberg, C4)
Septembre : Samson et Dalila (Cecil B. DeMille, C5)
Octobre : L'auberge rouge (Claude Autant-Lara, C6)
Décembre : Los olvidados (Luis Bunuel, C7)
Difficile de trouver mieux que ce film-là et cette photographie pour orner le premier numéro d'une revue cinéphile. Comme Wilder plaçait Gloria Swanson dans l'axe de la lumière du projecteur, les Cahiers voulaient-ils déjà nous montrer le chemin ? Toujours est-il que dans cette année, "blanche" si l'on se place dans l'optique de notre confrontation, ils proposaient pour commencer un sacré tiercé, d'avril à juin.
*****
1952 : Pour les Cahiers, l'année commence sous les auspices de Jean Renoir (entretien à l'appui) pour se poursuivre en compagnie de Billy Wilder, John Huston (avec un texte de Gilles Jacob), Orson Welles, Gene Kelly, Charlie Chaplin (par André Bazin puis, entre autres, par Jean Renoir), le producteur Stanley Kramer et le cinéaste d'animation Jiri Trnka. Sont églement proposées des études sur le western, sur l'avant-garde et le cinéma anglais. Une enquête sur la critique est (déjà) publiée, de même que les impressions de quelques rédacteurs revenant des festivals de Cannes et Venise. Après Autant-Lara, Clément, Allégret et Clair sont en couverture : les "jeunes turcs" n'avaient pas encore mordu à pleines dents le cinéma français.
En mai 52, Bernard Chardère fonde à Lyon la "revue mensuelle de cinéma" Positif. La promesse de periodicité ne pourra guère être tenue que durant les sept premiers mois et il faudra attendre le milieu des années 60 pour que le rythme voulu soit définitivement assuré. Au milieu de la présentation du numéro 1, on peut lire ceci : "Nous voudrions enfin ne pas démériter de la critique de cinéma. Saluons ici nos aînés : les Cahiers du Cinéma, en bonne place dans le haut sillage du regretté Jean-Georges Auriol, Sight and sound, Bianco e nero." Pendant quatre ou cinq ans, la cohabitation fut effectivement cordiale. Le n°1 s'ouvre sur les films d'Autant-Lara et de Buñuel, deux cinéastes destinés à accompagner longtemps (surtout le second) l'histoire de la revue. Le n°3 est presque entièrement consacré à John Huston, intégrant tout de même la première partie d'un long texte de Chardère consacré à Robert Bresson.
Note : Jusqu'en 1954, les couvertures de Positif étaient vierges de photographies. J'ajoute donc entre parenthèses les films défendus et les thèmes abordés dans ces premiers numéros.
Janvier : Le fleuve (Jean Renoir, C8)
Février : Jeux interdits (René Clément, C9)
Mars : Une place au soleil (George Stevens, C10)
Avril : Le gouffre aux chimères (Billy Wilder, C11)
Mai : La charge victorieuse (John Huston, C12) /vs/ Positif n°1 (L'auberge rouge, Los olvidados)
Juin : Deux sous d'espoir (Renato Castellani, C13) /vs/ Positif n°2 (Le fleuve, Rashomon)
Juillet : Un américain à Paris (Vincente Minnelli, C14) /vs/ Positif n°3 (John Huston)
Septembre : L'homme tranquille (John Ford, C15) /vs/---
Octobre : La jeune folle (Yves Allégret, C16) /vs/---
Novembre : Les feux de la rampe (Charlie Chaplin, C17) /vs/ Positif n°4 (cinéma ibérique, La montée au ciel, La grande vie)
Décembre : Belles de nuit (René Clair, C18) /vs/ Positif n°5 (cinéma soviétique, Deux sous d'espoir, Giuseppe de Santis, Marc Donskoï)

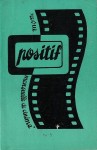
Quitte à choisir : Trois premiers numéros de haute volée pour Positif donc et trois couves marquantes des Cahiers, celles consacrées à Renoir, Huston et Chaplin. Jeux interdits ne me bouleverse pas et il y a quand même de bien meilleurs Ford que celui-ci (sous réserve de le revoir). Enfin, sans vouloir négliger le film, je préfère au moins quatre ou cinq autres comédies musicales de Minnelli à cet Américain bien connu. Je ne connais pas les autres. Allez, pour 1952 : Match nul.
A suivre...
Sources : Calindex & Cahiers du Cinéma
 Dans la brume électrique (In the electric mist), directed byBertrand Tavernier, est un polar d'ambiance, estimable et soigné, mais trop classique pour que l'on ne s'étonne pas d'un accueil critique aussi enthousiaste (jusque dans feu-Les Inrockuptibles et dans les Cahiers !, si j'en crois allociné).
Dans la brume électrique (In the electric mist), directed byBertrand Tavernier, est un polar d'ambiance, estimable et soigné, mais trop classique pour que l'on ne s'étonne pas d'un accueil critique aussi enthousiaste (jusque dans feu-Les Inrockuptibles et dans les Cahiers !, si j'en crois allociné). Fred, surnommé Chéri, est un jeune homme nageant dans les eaux d'un demi-monde aisé, celui des courtisanes vieillissantes de la fin de la Belle Époque, dont fait partie sa mère et sa protectrice favorite, Léa. Cette dernière passe bientôt du statut de "marraine" de Chéri à celui de maîtresse. Malgré la différence d'âge, la liaison est passionnée et semble indestructible, jusqu'à l'annonce d'un mariage arrangé qui sépare les deux amants avant des retrouvailles douloureuses. Christopher Hampton adapte Colette pour Stephen Frears et Michelle Pfeiffer joue Léa. Le trio des Liaisons dangereuses est ainsi reformé. J'ai eu beau chercher, je n'ai trouvé à Chéri absolument aucune des qualités du beau film d'il y a vingt ans...
Fred, surnommé Chéri, est un jeune homme nageant dans les eaux d'un demi-monde aisé, celui des courtisanes vieillissantes de la fin de la Belle Époque, dont fait partie sa mère et sa protectrice favorite, Léa. Cette dernière passe bientôt du statut de "marraine" de Chéri à celui de maîtresse. Malgré la différence d'âge, la liaison est passionnée et semble indestructible, jusqu'à l'annonce d'un mariage arrangé qui sépare les deux amants avant des retrouvailles douloureuses. Christopher Hampton adapte Colette pour Stephen Frears et Michelle Pfeiffer joue Léa. Le trio des Liaisons dangereuses est ainsi reformé. J'ai eu beau chercher, je n'ai trouvé à Chéri absolument aucune des qualités du beau film d'il y a vingt ans... Le rude quotidien d'une famille d'éleveurs kazakhs, en pleine steppe, et les espoirs d'Asa, le jeune frère de la mère. Le sujet du film appelle la captation de paysages grandioses et la méditation devant les grands espaces mais par sa mise en scène, Sergey Dvortsevoy refuse d'un bout à l'autre cette posture. Tulpan s'ouvre par un plan dont la surface est envahie, brutalisée, agressée. Ce qui s'avère être un troupeau de moutons met un certain temps à évacuer le cadre et à laisser enfin le lieu du récit être indentifié (la yourte plantée au milieu de nulle part). Poussière ou bruit, tout fait écran, du début à la fin (comme Tulpan, la fille que convoite Asa, restera cachée jusqu'au bout, derrière un rideau ou une porte). Ce ne sont pas seulement les objets qui font obstruction : les corps prennent toute la place, cadrés à la poitrine ou traversant incessamment le champ, à l'image du petit dernier de la famille, intenable.
Le rude quotidien d'une famille d'éleveurs kazakhs, en pleine steppe, et les espoirs d'Asa, le jeune frère de la mère. Le sujet du film appelle la captation de paysages grandioses et la méditation devant les grands espaces mais par sa mise en scène, Sergey Dvortsevoy refuse d'un bout à l'autre cette posture. Tulpan s'ouvre par un plan dont la surface est envahie, brutalisée, agressée. Ce qui s'avère être un troupeau de moutons met un certain temps à évacuer le cadre et à laisser enfin le lieu du récit être indentifié (la yourte plantée au milieu de nulle part). Poussière ou bruit, tout fait écran, du début à la fin (comme Tulpan, la fille que convoite Asa, restera cachée jusqu'au bout, derrière un rideau ou une porte). Ce ne sont pas seulement les objets qui font obstruction : les corps prennent toute la place, cadrés à la poitrine ou traversant incessamment le champ, à l'image du petit dernier de la famille, intenable. S'il est bien un segment de l'histoire du septième art qui n'est pas facile à aborder les mains dans les poches, c'est bien le cinéma révolutionnaire soviétique des années 20. Un certain Cuirassé a beau garder son aura mythique, décennie après décennie, se confronter à lui de nos jours demande un effort particulier devant la singularité narrative, esthétique et idéologique de l'objet. Autre pilier de l'édifice, Arsenal d'Alexandre Dovjenko (ou Dovzhenko) ne se laisse pas appréhender plus aisément.
S'il est bien un segment de l'histoire du septième art qui n'est pas facile à aborder les mains dans les poches, c'est bien le cinéma révolutionnaire soviétique des années 20. Un certain Cuirassé a beau garder son aura mythique, décennie après décennie, se confronter à lui de nos jours demande un effort particulier devant la singularité narrative, esthétique et idéologique de l'objet. Autre pilier de l'édifice, Arsenal d'Alexandre Dovjenko (ou Dovzhenko) ne se laisse pas appréhender plus aisément.
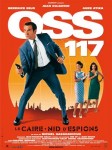



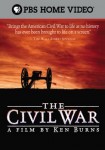






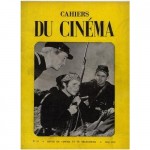


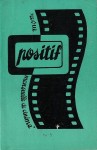
 L'étoffe des héros de Philip Kaufman n'eut guère de mal à voler à cent coudées au-dessus du reste des sorties de ce mois-là. Il me semble l'avoir découvert en vhs plutôt qu'en salles et je ne pense pas l'avoir revu depuis mais son souvenir est resté assez vivace : celui d'une formidable épopée américaine, portée par une sacrée distribution (Sam Shepard, Scott Glenn, Dennis Quaid, Ed Harris, Fred Ward et Barbara Hershey).
L'étoffe des héros de Philip Kaufman n'eut guère de mal à voler à cent coudées au-dessus du reste des sorties de ce mois-là. Il me semble l'avoir découvert en vhs plutôt qu'en salles et je ne pense pas l'avoir revu depuis mais son souvenir est resté assez vivace : celui d'une formidable épopée américaine, portée par une sacrée distribution (Sam Shepard, Scott Glenn, Dennis Quaid, Ed Harris, Fred Ward et Barbara Hershey). A peu près dans le même panier, on trouvait Les fauves, de Jean-Louis Daniel avec Daniel Auteuil et Philippe Léotard. Il me semble l'avoir vu lui aussi à l'époque, mais rien ne m'en est resté. Idem pour Osterman Weekend du grand Sam (Peckinpah), film d'espionnage confus et généralement peu aimé, y compris par les admirateurs du cinéaste, dans lequel Rutger Hauer se débattait sous les yeux de la CIA. Idem pour Retour vers l'enfer (celui du Vietnam évidemment) de Ted Kotcheff.
A peu près dans le même panier, on trouvait Les fauves, de Jean-Louis Daniel avec Daniel Auteuil et Philippe Léotard. Il me semble l'avoir vu lui aussi à l'époque, mais rien ne m'en est resté. Idem pour Osterman Weekend du grand Sam (Peckinpah), film d'espionnage confus et généralement peu aimé, y compris par les admirateurs du cinéaste, dans lequel Rutger Hauer se débattait sous les yeux de la CIA. Idem pour Retour vers l'enfer (celui du Vietnam évidemment) de Ted Kotcheff.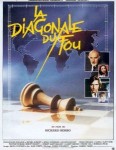 Moins réputés, parfois complètement oubliés, d'autres pourraient réserver, pourquoi pas, des surprises : Guerres froides (britannique de Richard Eyre), Peppermint frieden (film historique et personnel, signé par l'Allemande Marianne Rosenbaum), L'ange (un trip de Patrick Bokanowski), Un homme parmi les loups (une production Disney apparemment très regardable de Carroll Ballard), Clin d'oeil (un délire bunuelien de Jorge Amat), Le juge (de Philippe Lefebvre avec Jacques Perrin dans le rôle du juge Michel, assassiné à Marseille alors qui enquêtait sur un trafic de drogue), Panique (du fantastique à l'Espagnole par Anthony Richmond), Cent jours à Palerme (de Giuseppe Ferrara avec Lino Ventura menacé par la mafia, huit ans après Cadavres exquis, l'un des meilleurs Rosi), Vent de sable (de Mohammed Lakhdar-Amina, spécialiste des fresques historiques algériennes), Naïtou (du Guinéen Moussa Kémoko Diakité), La diagonale du fou (dans lequel Richard Dembo fait jouer Piccoli aux échecs), Forbidden Zone (collage absurde par Richard Elfman).
Moins réputés, parfois complètement oubliés, d'autres pourraient réserver, pourquoi pas, des surprises : Guerres froides (britannique de Richard Eyre), Peppermint frieden (film historique et personnel, signé par l'Allemande Marianne Rosenbaum), L'ange (un trip de Patrick Bokanowski), Un homme parmi les loups (une production Disney apparemment très regardable de Carroll Ballard), Clin d'oeil (un délire bunuelien de Jorge Amat), Le juge (de Philippe Lefebvre avec Jacques Perrin dans le rôle du juge Michel, assassiné à Marseille alors qui enquêtait sur un trafic de drogue), Panique (du fantastique à l'Espagnole par Anthony Richmond), Cent jours à Palerme (de Giuseppe Ferrara avec Lino Ventura menacé par la mafia, huit ans après Cadavres exquis, l'un des meilleurs Rosi), Vent de sable (de Mohammed Lakhdar-Amina, spécialiste des fresques historiques algériennes), Naïtou (du Guinéen Moussa Kémoko Diakité), La diagonale du fou (dans lequel Richard Dembo fait jouer Piccoli aux échecs), Forbidden Zone (collage absurde par Richard Elfman).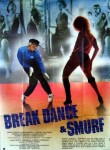 Notons encore trois documentaires-portraits : Ecoutez Bizeau et Ecoutez Mary Picqueray de Bernard Baissat (entretiens avec deux figures de l'anarchisme) et William Burroughs (de Howard Brookner). Et pour les plus courageux (ou les plus pervers) : Break dance and smurf ou comment concilier eau de rose et hip-hop naissant (Vittorio de Sisti), Aldo et Junior (Patrick Schulmann d'après Wolinski), New York nights (porno soft à sketches de Romano Vanderbes) et le croquignolet Sahara (d'Andrew McLaglen avec Brooke Shields et notre Lambert Wilson national). Enfin, ce tour d'horizon, pas très brillant, serait incomplet sans l'évocation des productions de Hong-Kong qui déboulaient en masse en ce temps-là : L'espionne qui venait du soleil levant (Ting Shan-hsi), La fureur des maîtres de Shaolin (Sammy Li), L'incroyable coup de tonnerre de Shaolin (Godfrey Ho), L'Aigle ne pardonne pas (Ho Chung Ty), Shao Lin contre Ninja (Robert Tai).
Notons encore trois documentaires-portraits : Ecoutez Bizeau et Ecoutez Mary Picqueray de Bernard Baissat (entretiens avec deux figures de l'anarchisme) et William Burroughs (de Howard Brookner). Et pour les plus courageux (ou les plus pervers) : Break dance and smurf ou comment concilier eau de rose et hip-hop naissant (Vittorio de Sisti), Aldo et Junior (Patrick Schulmann d'après Wolinski), New York nights (porno soft à sketches de Romano Vanderbes) et le croquignolet Sahara (d'Andrew McLaglen avec Brooke Shields et notre Lambert Wilson national). Enfin, ce tour d'horizon, pas très brillant, serait incomplet sans l'évocation des productions de Hong-Kong qui déboulaient en masse en ce temps-là : L'espionne qui venait du soleil levant (Ting Shan-hsi), La fureur des maîtres de Shaolin (Sammy Li), L'incroyable coup de tonnerre de Shaolin (Godfrey Ho), L'Aigle ne pardonne pas (Ho Chung Ty), Shao Lin contre Ninja (Robert Tai). Dans les kiosques (mais pas encore dans les supermarchés), nous pouvions voir que Cinématographe (99) osait un drôle de télescopage sur sa une en annonçant un dossier sur Le cinéma adolescent : de Gérard Philipe au vidéo-clip. Cinéma 84 (304) poursuivait son étude du cinéma allemand entamé le mois précédent et mettait Ingrid Caven en couverture. Positif (278) choisissait Carmen de Rosi (voir le mois de mars), La Revue du Cinéma (393) le film de Tavernier et Première (85) s'entretenait avec Ventura. Pour le meilleur film du mois (celui de Kaufman donc), il restait les couves de Starfix (14) et des Cahiers du Cinéma (358).
Dans les kiosques (mais pas encore dans les supermarchés), nous pouvions voir que Cinématographe (99) osait un drôle de télescopage sur sa une en annonçant un dossier sur Le cinéma adolescent : de Gérard Philipe au vidéo-clip. Cinéma 84 (304) poursuivait son étude du cinéma allemand entamé le mois précédent et mettait Ingrid Caven en couverture. Positif (278) choisissait Carmen de Rosi (voir le mois de mars), La Revue du Cinéma (393) le film de Tavernier et Première (85) s'entretenait avec Ventura. Pour le meilleur film du mois (celui de Kaufman donc), il restait les couves de Starfix (14) et des Cahiers du Cinéma (358).