


****/****/****
Le génie de Kelly, la maîtrise de Donen, la pertinence de Comden et Green (au scénario)... Inutile d'insister sur tout cela. Mais en revoyant Chantons sous la pluie pour là énième fois, je me suis surtout dit que ce qui le rendait décidément inaltérable, c'était son double statut d'œuvre divertissante et réflexive. Le rêve hollywoodien est ici réalisé dans le sens où le spectateur, quelque soit son âge, sa culture, son humeur et son niveau de lecture, est accueilli avec la même grâce. Car ce film porte en lui son propre commentaire, tout en nous laissant libres de le lire ou pas. Gene Kelly cherche d'emblée la connivence, entrant dans le champ avec un sourire ostensiblement affiché et nous réservant, à nous seul, la vérité sur le parcours de son personnage, grâce à l'insertion d'images contredisant les propos tenus face à ses fans. Comme ils le font de l'opposition entre bons et mauvais acteurs, les auteurs s'amusent de celle existant entre "culture de masse" et "haute culture", l'intégrant à une écriture du comique qui repose notamment sur la gêne (ressort classique dans la comédie hollywoodienne, qui, ici, n'est jamais activé contre les personnages puisque le dépassement de cette gêne est aussi donné à voir, comme le montre la séquence de la fête dans laquelle Debbie Reynolds sort du gâteau et découvre dans l'assistance Gene Kelly, qu'elle vient de rencontrer et de rabrouer pour la vulgarité de son art : désarçonnée, elle se donne pourtant à fond jusqu'au terme de son numéro de music hall un peu nunuche).
Quand nous pouvons savourer la réflexion sur le genre et l'approche historique précise, d'autres, les plus jeunes par exemple, peuvent profiter du caractère instructif du spectacle. Derrière les frasques des stars, se discerne l'hommage aux artistes et techniciens de l'ombre (dans le duo Don Lockwood - Cosmo Brown, soit Gene Kelly - Donald O'Connor, c'est bien le moins célèbre des deux, le compositeur, qui trouve généralement les solutions aux problèmes artistiques). De même, toute la machinerie du septième art est exposée, à l'occasion bien sûr de la déclaration d'amour chantée dans le studio désert mais figurant bientôt un extérieur au clair de lune magique ou encore de la balade des deux amis qui les fait passer devant plusieurs plateaux où se tournent des films de série. Par conséquent, un peu plus tard, lorsque se fait le numéro Good morning dans la maison de Don Lockwood, celle-ci apparaît comme un pur décor, avec ce faux mur de cuisine à travers lequel passe la caméra et une chute finale sur un canapé, accessoire utilisé peu de temps auparavant pour le Make 'em laugh d'O'Connor dans le studio de cinéma.
La dernière partie du film est toujours aussi éblouissante. Peu après le fameux numéro-titre (quelles admirables variations de rythme !), vient le morceau de bravoure Broadway melody, merveilleusement détaché du reste du récit, illustration d'une idée que Don Lockwood explique à son producteur (celui-ci ayant du mal à la "visualiser" et décidant probablement de ne pas en tenir compte pour le film en cours de réalisation). La (seconde) première du film dans le film est l'occasion de dénouer l'intrigue. Kelly et Donen tirent alors un parti admirable du lieu tout en rendant un nouvel hommage au music hall. Et enfin, Don Lockwood rattrape Kathy Selden, le chant et la musique reviennent, le spectacle descend dans la salle, le cinéma est partout. Debbie Reynolds se retourne brusquement vers Gene Kelly et son visage en larmes bouleverse, que l'on soit n'importe quel type de spectateur...
De Donen à Oury et de Kelly à Montand, la chute s'annonçait rude, mais elle fut quelque peu amortie. Le corniaud était, dans mon souvenir, meilleur que ce qu'il est réellement. Avec La folie des grandeurs, la modification de mon jugement se fait dans le sens inverse. Alors que je m'attendais à revoir une œuvre médiocre, je me suis retrouvé devant une comédie assez agréable, pas loin d'être une vraie réussite.
Inspiré du Ruy Blas de Victor Hugo, le scénario fait preuve de consistance et ménage de plaisants rebondissements. Ainsi, bien campés sur leurs jambes, les auteurs du film peuvent glisser des anachronismes de langage ou de comportement, des pointes d'absurde, du comique plus distancié que d'ordinaire (les apartés que nous réserve Montand, la lecture de la lettre qui se transforme en dialogue avec une voix off, les clins d'œil au western italien). Les gags sont nombreux et atteignent souvent leur but.
Le film a, de plus, une vivacité certaine. Le soin apporté à l'ensemble (décors, costumes, photographie, interprétation de qualité égale) fait que le rythme est tenu sans réel fléchissement. Les scènes d'action, souvent pathétiques dans ce genre de production, sont réalisées avec vigueur (la capture de César par Salluste, l'évasion du bagne dans le désert) et même lorsqu'elles gardent un pied dans le pastiche, elles ne tombent pas dans le ridicule. Il y a certes quelques facilités ici ou là et une musique bien faible, signée de Polnareff, mais le refuge dans un passé lointain et le relatif éloignement géographique autorise mieux les fantaisies. La mise en scène d'Oury n'a rien d'exceptionnel, les différents mouvements s'effectuant de manière assez rigide, mais tel raccord ou telle plongée ont leur efficacité.
Le dynamisme provient de l'histoire, de l'équipe de réalisation, mais aussi et surtout, du remplacement de Bourvil par Montand. Alors que le premier restait toujours en-dessous de De Funès, encombrait parfois ses avancées, le second lui tient parfaitement tête et parvient à se caler sur son rythme effréné. Montand apporte sa verve et, par rapport à son prédécesseur, rend infiniment moins gnan-gnan les épisodes romantiques (qui sont de plus, ici, accompagnés d'une légère ironie, via le décorum ou le regard de De Funès).
De Montand à Hallyday, la chute s'annonçait encore plus tragique que la précédente, mais elle fut en fait, elle aussi, assez peu douloureuse. D'ailleurs, j'exagère un peu. La présence de Johnny Hallyday dans Titeuf, le film est limitée, en terme de durée et bien sûr parce que nous nous retrouvons ici uniquement face à son "avatar" dessiné. Toutefois, il faut dire que ces quelques minutes du film de Zep constituent sans aucun doute le meilleur clip vidéo que nous ait jamais offert l'ex-idole des jeunes. La chose a échappé au journaliste de Télérama en charge de la critique de ce Titeuf. Dans l'hebdo, le film est descendu sous le prétexte qu'il marcherait à l'esbroufe. Trois éléments prouveraient, selon l'auteur du texte, la réalité de l'arnaque : la bande originale, l'inadéquation entre le coût du projet et son résultat et enfin le choix de la 3D. La musique est effectivement inégale (le fond étant touché avec un morceau réunissant quatre tocards de la chanson française) mais... relativement en accord avec le sujet et les personnages. Et Zep réussit quand même à placer ces vieux punks des Toy Dolls (pas n'importe où de surcroît). Le fric dépensé et la publicité accompagnant la sortie, à vrai dire, je m'en tape. Reste le problème de la 3D, à propos duquel... je ne peux me prononcer, ayant vu le film en 2D. Cela reste le seul point sur lequel je pourrai m'accorder avec Télérama car je ne vois en effet pas très bien ce que la technique peut apporter dans ce cas précis.
Ceci étant précisé, je dois dire que, de mon côté, c'est au contraire la modestie du film qui m'a plu. Pas de voix people pour de nouveaux personnages (les aficionados, dont je ne suis pas, peuvent éventuellement se plaindre de ce manque de nouveauté), pas de translation spectaculaire du monde de Titeuf (l'amusante introduction préhistorique est une fausse piste) : on reste au ras de la rue, au niveau de la cour de récré. Le fait que Zep ait obtenu le contrôle total de sa création était sans doute, déjà, un gage de fidélité sinon de qualité. L'esprit cracra et bébête de la série et de la BD est heureusement préservé, ce qui nous vaut un festival de gros mots, de blagues pipi-caca et de pensées sexuelles idiotes. L'histoire est toute simple, ancrée dans le quotidien, juste réhaussée visuellement par les illustrations des délires de Titeuf et de ses copains. L'esthétique du film n'est pas transcendante mais quelques idées se remarquent, ainsi que plusieurs micro-gags à l'arrière-plan. La thématique abordée est celle d'un passage d'un âge à l'autre draînant ses inquiétudes. Si l'issue ne fait guère de doute (happy end pour les parents, plus en demie-teinte pour Titeuf qui doit encore avancer...), cette structure classique donne l'assise nécessaire pour un passage réussi au format long.


 CHANTONS SOUS LA PLUIE (Singin' in the rain)
CHANTONS SOUS LA PLUIE (Singin' in the rain)
de Gene Kelly et Stanley Donen
(Etats-Unis / 103 mn / 1952)
LA FOLIE DES GRANDEURS
de Gérard Oury
(France / 108 mn / 1971)
TITEUF, LE FILM
de Zep
(France / 87 mn / 2011)

 AFFREUX, SALES ET MÉCHANTS (Brutti, sporchi e cattivi)
AFFREUX, SALES ET MÉCHANTS (Brutti, sporchi e cattivi)
 LE NOM DES GENS
LE NOM DES GENS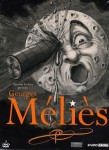 Ce coffret Studio Canal, sorti en 2008, s'il ne donne accès qu'à 1/18ème de la production de Georges Méliès (qui s'élèverait à 520 films), semble toutefois proposer un panel assez représentatif de l'œuvre du cinéaste-inventeur de Montreuil. Son travail est en effet présenté dans sa diversité, non réduit aux seuls appels de la magie et de la féérie.
Ce coffret Studio Canal, sorti en 2008, s'il ne donne accès qu'à 1/18ème de la production de Georges Méliès (qui s'élèverait à 520 films), semble toutefois proposer un panel assez représentatif de l'œuvre du cinéaste-inventeur de Montreuil. Son travail est en effet présenté dans sa diversité, non réduit aux seuls appels de la magie et de la féérie. Certains dépassent ce stade en trouvant une forme et un rythme plus remarquables. Ainsi dans Sorcellerie culinaire (1904, 4'08''), le crescendo organisé par le montage fait accéder la succession de farces théâtrales et gymnastiques réalisées par quelques diablotins au détriment d'un cuisinier au rang d'objet cinématographique singulier (semblant annoncer notamment, dans son accumulation irrépressible, le célèbre Tango de Zbigniew Rybczynski). Méliès en reprendra d'ailleurs l'idée, avec moins de bonheur, pour une séquence de ses Quatre cent farces du Diable (1906, 17'17''), pantomime plutôt inoffensive et gesticulante, plus laborieuse dans son ensemble. Le Diable l'inspire pourtant souvent, comme l'atteste Le chaudron infernal (1903, 1'44'') court récit coloré et morbide donnant à voir de très beaux fantômes en surimpression. Dans ce genre inquiétant, Une nuit terrible (1896, 1'05'') est en revanche anecdotique.
Certains dépassent ce stade en trouvant une forme et un rythme plus remarquables. Ainsi dans Sorcellerie culinaire (1904, 4'08''), le crescendo organisé par le montage fait accéder la succession de farces théâtrales et gymnastiques réalisées par quelques diablotins au détriment d'un cuisinier au rang d'objet cinématographique singulier (semblant annoncer notamment, dans son accumulation irrépressible, le célèbre Tango de Zbigniew Rybczynski). Méliès en reprendra d'ailleurs l'idée, avec moins de bonheur, pour une séquence de ses Quatre cent farces du Diable (1906, 17'17''), pantomime plutôt inoffensive et gesticulante, plus laborieuse dans son ensemble. Le Diable l'inspire pourtant souvent, comme l'atteste Le chaudron infernal (1903, 1'44'') court récit coloré et morbide donnant à voir de très beaux fantômes en surimpression. Dans ce genre inquiétant, Une nuit terrible (1896, 1'05'') est en revanche anecdotique. L'illustration de contes est un autre courant important. De Cendrillon (1899, 5'40'') et son remake Cendrillon ou la pantoufle merveilleuse (1912, 27'43''), nous ne retenons pas grand chose. Le premier n'est qu'une suite de tableaux. Le second, plus long et plus lent, est un peu plus intéressant. On y décèle un plan rapproché à l'intérieur d'une séquence, le déroulement de deux actions parallèles, une procession presque absurde par sa durée excessive. Barbe Bleue (1901, 10'18'') apparaît beaucoup plus vif et plus inventif visuellement. Le conte est également plus cruel, captant ainsi plus rapidement notre attention. Cerise sur le gâteau : le film semble assumer de plus en plus nettement au fil de son déroulement son caractère de représentation jusqu'à un baisser de rideau final.
L'illustration de contes est un autre courant important. De Cendrillon (1899, 5'40'') et son remake Cendrillon ou la pantoufle merveilleuse (1912, 27'43''), nous ne retenons pas grand chose. Le premier n'est qu'une suite de tableaux. Le second, plus long et plus lent, est un peu plus intéressant. On y décèle un plan rapproché à l'intérieur d'une séquence, le déroulement de deux actions parallèles, une procession presque absurde par sa durée excessive. Barbe Bleue (1901, 10'18'') apparaît beaucoup plus vif et plus inventif visuellement. Le conte est également plus cruel, captant ainsi plus rapidement notre attention. Cerise sur le gâteau : le film semble assumer de plus en plus nettement au fil de son déroulement son caractère de représentation jusqu'à un baisser de rideau final. Le premier film de Méliès est Une Partie de cartes (1896, 1'06''). Celle-ci répond bien sûr à celle des Frères Lumière mais elle ouvre aussi une piste que l'on ne pensait pas explorer, celle du documentaire et du film social. Avec Le sacre d'Edouard VII (1902, 5'18'') Méliès effectue la reconstitution d'un événement contemporain, qui s'avèrera finalement une anticipation et une amélioration (la véritable cérémonie ayant été reportée et écourtée). Avec Il y a un dieu pour les ivrognes (1908, 3'54''), en deux plans seulement, un extérieur, l'autre intérieur, il construit un récit édifiant sur les ravages de l'alcoolisme. Mais le film le plus surprenant du lot est titré Les incendiaires (1906, 7'21''). Loin de la féérie, Georges Méliès met en scène successivement un incendie criminel, une riposte policière, un coup de hache sur une tête, une course poursuite en décors réels (les seuls que j'ai remarqué dans ces œuvres). Il enchaîne par une ellipse très cinématographique en passant d'un plan du bandit entre les gendarmes à un autre montrant le même tourmenté dans sa cellule. Puis nous nous retrouvons dans la cour où trône la guillotine. Le plan est d'une longueur étonnante et d'une froideur glaçante: il détaille la préparation, les essais, l'arrivée du condamné, son exécution, sa bascule dans le cercueil, la récupération de sa tête et le nettoyage de la machine. Fin.
Le premier film de Méliès est Une Partie de cartes (1896, 1'06''). Celle-ci répond bien sûr à celle des Frères Lumière mais elle ouvre aussi une piste que l'on ne pensait pas explorer, celle du documentaire et du film social. Avec Le sacre d'Edouard VII (1902, 5'18'') Méliès effectue la reconstitution d'un événement contemporain, qui s'avèrera finalement une anticipation et une amélioration (la véritable cérémonie ayant été reportée et écourtée). Avec Il y a un dieu pour les ivrognes (1908, 3'54''), en deux plans seulement, un extérieur, l'autre intérieur, il construit un récit édifiant sur les ravages de l'alcoolisme. Mais le film le plus surprenant du lot est titré Les incendiaires (1906, 7'21''). Loin de la féérie, Georges Méliès met en scène successivement un incendie criminel, une riposte policière, un coup de hache sur une tête, une course poursuite en décors réels (les seuls que j'ai remarqué dans ces œuvres). Il enchaîne par une ellipse très cinématographique en passant d'un plan du bandit entre les gendarmes à un autre montrant le même tourmenté dans sa cellule. Puis nous nous retrouvons dans la cour où trône la guillotine. Le plan est d'une longueur étonnante et d'une froideur glaçante: il détaille la préparation, les essais, l'arrivée du condamné, son exécution, sa bascule dans le cercueil, la récupération de sa tête et le nettoyage de la machine. Fin. Potiche est à peine moins mauvais que sa bande annonce ne le laisse penser. Post-moderne en diable, le dernier film de François Ozon apparaît sans enjeu ni point de vue. Quel intérêt à filmer aujourd'hui une vieille pièce de théâtre de boulevard si c'est pour se contenter d'imiter de manière nostalgico-fétichiste le style cinématographique des années 70 ? Au bout d'une heure trois quarts de projection, nous ne trouvons toujours pas la réponse à la question.
Potiche est à peine moins mauvais que sa bande annonce ne le laisse penser. Post-moderne en diable, le dernier film de François Ozon apparaît sans enjeu ni point de vue. Quel intérêt à filmer aujourd'hui une vieille pièce de théâtre de boulevard si c'est pour se contenter d'imiter de manière nostalgico-fétichiste le style cinématographique des années 70 ? Au bout d'une heure trois quarts de projection, nous ne trouvons toujours pas la réponse à la question. Comme Guillaume Canet, l'Argentin Martin Rejtman fait un cinéma "générationnel" et cela à plus d'un titre. Tout d'abord, les deux œuvres réunies dans ce coffret semblent adressées prioritairement à une génération précise, celle des gens qui avaient la vingtaine en 92 et la trentaine en 2003. Ensuite, leurs récits sont exclusivement consacrés à des personnages appartenant à celle-ci. Enfin, le premier des deux films proposés, Rapado, est lui-même à l'origine d'une naissance, celle du jeune cinéma argentin de la fin des années 90 dont les principaux représentants se nomment Pablo Trapero, Lucrecia Martel et Lisandro Alonso. Comme il arrive parfois, la reconnaissance rapide des talentueux chefs de file du mouvement a eu pour effet de laisser quelque peu dans l'ombre le réel initiateur - reconnu comme tel par ses cadets. Ainsi, ni Rapado ni Les gants magiques n'ont eu l'honneur d'être distribués dans les salles françaises (le second a tout de même été diffusé en 2006 sur Arte, chaîne coproductrice du film, ce qui avait alors permis à certains d'entre nous de le découvrir avec bonheur), à l'inverse de Silvia Prieto, deuxième long métrage de Rejtman datant de 1999 et sorti ici en... 2004. Depuis, plus rien ou presque (les filmographies indiquent seulement deux titres d'œuvres courtes et énigmatiques, réalisées après Les gants magiques). Cette livraison des Editions Epicentre est donc précieuse, imposant à nos yeux un auteur des plus attachants.
Comme Guillaume Canet, l'Argentin Martin Rejtman fait un cinéma "générationnel" et cela à plus d'un titre. Tout d'abord, les deux œuvres réunies dans ce coffret semblent adressées prioritairement à une génération précise, celle des gens qui avaient la vingtaine en 92 et la trentaine en 2003. Ensuite, leurs récits sont exclusivement consacrés à des personnages appartenant à celle-ci. Enfin, le premier des deux films proposés, Rapado, est lui-même à l'origine d'une naissance, celle du jeune cinéma argentin de la fin des années 90 dont les principaux représentants se nomment Pablo Trapero, Lucrecia Martel et Lisandro Alonso. Comme il arrive parfois, la reconnaissance rapide des talentueux chefs de file du mouvement a eu pour effet de laisser quelque peu dans l'ombre le réel initiateur - reconnu comme tel par ses cadets. Ainsi, ni Rapado ni Les gants magiques n'ont eu l'honneur d'être distribués dans les salles françaises (le second a tout de même été diffusé en 2006 sur Arte, chaîne coproductrice du film, ce qui avait alors permis à certains d'entre nous de le découvrir avec bonheur), à l'inverse de Silvia Prieto, deuxième long métrage de Rejtman datant de 1999 et sorti ici en... 2004. Depuis, plus rien ou presque (les filmographies indiquent seulement deux titres d'œuvres courtes et énigmatiques, réalisées après Les gants magiques). Cette livraison des Editions Epicentre est donc précieuse, imposant à nos yeux un auteur des plus attachants. Les films de Martin Rejtman se tiennent en équilibre entre l'ironie et la tendresse, donnant l'étrange sentiment d'une sincérité et d'une vérité qui se verraient légèrement distanciées. L'humour y est permanent mais léger et empreint de mélancolie. Il nait surtout d'un brillant montage. Ce qui arrive aux personnages est loin d'être drôle, ce n'est que l'assemblage de leurs déboires qui l'est. L'art du cinéaste est un art de la rime visuelle délicate, du running gag offert comme en passant, de la subtile variation des motifs, de l'ellipse souriante et de la concision (1h10 pour l'un, 1h25 pour l'autre).
Les films de Martin Rejtman se tiennent en équilibre entre l'ironie et la tendresse, donnant l'étrange sentiment d'une sincérité et d'une vérité qui se verraient légèrement distanciées. L'humour y est permanent mais léger et empreint de mélancolie. Il nait surtout d'un brillant montage. Ce qui arrive aux personnages est loin d'être drôle, ce n'est que l'assemblage de leurs déboires qui l'est. L'art du cinéaste est un art de la rime visuelle délicate, du running gag offert comme en passant, de la subtile variation des motifs, de l'ellipse souriante et de la concision (1h10 pour l'un, 1h25 pour l'autre).
 Une douceur après le désagréable
Une douceur après le désagréable  Inutile de perdre du temps à évoquer les deux derniers Gendarmes, suivis du coin de l'œil, toujours aussi minables. Mais pour rester avec De Funès, on peut dire quelques mots d'Oscar. Si il est moins catastrophique dans sa réalisation et moins idiot dans son registre comique que les pitreries baclées par Jean Girault sous le soleil de Saint-Tropez, le film de Molinaro ne satisfait guère plus et rarement spectacle comique m'aura autant épuisé. Partant d'une pièce de théâtre de boulevard (adaptée pour l'occasion, entre autres, par De Funès lui-même, qui la joua plusieurs fois sur scène), le scénario accumule, en une seule journée et en un seul lieu, des surprises, des révélations, des tromperies et des méprises toutes plus improbables les unes que les autres. Cette succession effrénée (à chaque séquence son ou ses rebondissements) est rendue plus sensible encore par des choix de mise en scène visant à augmenter la vitesse du récit : claquements de portes, déplacements continus des personnages d'une pièce à l'autre, montage très sérré des actions, donnant l'impression que les acteurs déboulent dans le champ, voire qu'ils sont en avance sur le plan (on se demande par exemple, parfois, si Claude Rich quitte vraiment les lieux comme il est censé le faire en plusieurs occasions, avant de revenir). Cet emballement mécanique serait à la limite supportable si le fond n'était si déplaisant (médiocrité générale des caractères, misogynie et cupidité utilisés comme ressorts comiques essentiels) et surtout si il n'était pas ponctué toutes les dix secondes d'éclats de voix crispants dûs à De Funès, à Rich ou à la jeune Agathe Natanson qui, bien que légèrement vêtue, a l'hystérie horripilante. Le premier cité, attraction de tous les plans ou presque, est en colère de la première à la dernière scène. En caracolant ainsi, sans jamais atteindre une dimension absurde qui réhausserait le vaudeville de base, le film laisse les rares bons mots et les sympathiques trouvailles se faire oublier aussitôt, emportés qu'ils sont par le courant de ces échanges-mitraillette, de ces cris et de ces grimaces incessantes. Épuisant, vraiment.
Inutile de perdre du temps à évoquer les deux derniers Gendarmes, suivis du coin de l'œil, toujours aussi minables. Mais pour rester avec De Funès, on peut dire quelques mots d'Oscar. Si il est moins catastrophique dans sa réalisation et moins idiot dans son registre comique que les pitreries baclées par Jean Girault sous le soleil de Saint-Tropez, le film de Molinaro ne satisfait guère plus et rarement spectacle comique m'aura autant épuisé. Partant d'une pièce de théâtre de boulevard (adaptée pour l'occasion, entre autres, par De Funès lui-même, qui la joua plusieurs fois sur scène), le scénario accumule, en une seule journée et en un seul lieu, des surprises, des révélations, des tromperies et des méprises toutes plus improbables les unes que les autres. Cette succession effrénée (à chaque séquence son ou ses rebondissements) est rendue plus sensible encore par des choix de mise en scène visant à augmenter la vitesse du récit : claquements de portes, déplacements continus des personnages d'une pièce à l'autre, montage très sérré des actions, donnant l'impression que les acteurs déboulent dans le champ, voire qu'ils sont en avance sur le plan (on se demande par exemple, parfois, si Claude Rich quitte vraiment les lieux comme il est censé le faire en plusieurs occasions, avant de revenir). Cet emballement mécanique serait à la limite supportable si le fond n'était si déplaisant (médiocrité générale des caractères, misogynie et cupidité utilisés comme ressorts comiques essentiels) et surtout si il n'était pas ponctué toutes les dix secondes d'éclats de voix crispants dûs à De Funès, à Rich ou à la jeune Agathe Natanson qui, bien que légèrement vêtue, a l'hystérie horripilante. Le premier cité, attraction de tous les plans ou presque, est en colère de la première à la dernière scène. En caracolant ainsi, sans jamais atteindre une dimension absurde qui réhausserait le vaudeville de base, le film laisse les rares bons mots et les sympathiques trouvailles se faire oublier aussitôt, emportés qu'ils sont par le courant de ces échanges-mitraillette, de ces cris et de ces grimaces incessantes. Épuisant, vraiment.

 Le grand retour de Blier ? Mon cul, oui !
Le grand retour de Blier ? Mon cul, oui ! La Tamara de Stephen Frears étant plus charmante et moins horripilante que la Poppy de Mike Leigh, Tamara Drewe est plus supportable que
La Tamara de Stephen Frears étant plus charmante et moins horripilante que la Poppy de Mike Leigh, Tamara Drewe est plus supportable que