(Benoit Jacquot / France / 2004)
■■□□
 Le sentiment que procure le film de Benoit Jacquot est assez opposé à l'urgence et la tension que prédisent son titre qui claque, son esthétique en noir et blanc et son économie. Relatant la cavale de quatre jeunes gens de Paris à Athènes, via l'Espagne et le Maroc, A tout de suite est moins chargé de la tension du film de genre que du sentiment cotonneux de la chronique.
Le sentiment que procure le film de Benoit Jacquot est assez opposé à l'urgence et la tension que prédisent son titre qui claque, son esthétique en noir et blanc et son économie. Relatant la cavale de quatre jeunes gens de Paris à Athènes, via l'Espagne et le Maroc, A tout de suite est moins chargé de la tension du film de genre que du sentiment cotonneux de la chronique.
Il faut un certain temps pour que le film capte l'attention. La partie parisienne pose la situation (une fille bourgeoise se lie avec un jeune homme qui bientôt braque une banque), mais usant de l'ellipse et refusant toute concession au genre, elle a du mal à nous passionner. C'est bien lorsque la fuite se fait indispensable pour les personnages que le film peut offrir de beaux moments, par la liberté que leur laisse alors le cinéaste. Certes, les multiples détours que prend l'intrigue dans la foulée des égarements de son héroïne, dont on épouse le point de vue tout du long, sont d'un intérêt très variable, mais le voyage a du charme. Les seuls moments de tension, rendue de façon assez originale, sont liés aux passages des différentes douanes. Entre ceux-ci, comme il est dit en voix-off, c'est un peu les vacances, le temps de poser un regard sur une ville, un paysage. Traitant d'une histoire vraie se déroulant dans les années 70, Benoit Jacquot fait l'étrange choix de montrer les villes traversées par des images d'archives d'époque, qui raccordent assez mal avec le reste. On en vient à préférer les vues documentaires sur les pas d'Isild Le Besco, même si elles se soucient peu, pour ce qui est des pays du Sud, de masquer les traits de modernité.
Lunatique : l'actrice principale, quasiment présente à chaque plan, nous paraît tantôt attachante, tantôt énervante (étonnemment amorphe lorsqu'elle se retrouve seule à Athènes), parfaitement à l'image du film. La chose la plus étrange est sans doute qu'alors que nous assistons aux conséquences d'un coup de foudre et à la cavale de deux couples, ce qui nous touche ce sont les rapports entre les femmes. Tout d'abord ceux qui se tissent entre les deux filles (ces deux "bourges" s'encanaillant avec leurs voyous respectifs). Une fois arrivés en Grèce, l'amoureux est évacué et aucun homme ne parvient à tenir sa place. Tous se font éjecter du cadre plus ou moins rapidement. La seule personne de qui l'héroïne accepte durablement la tendresse est sa collègue de travail. De retour au point de départ, elle se liera fortement à la femme qui les aida dans leur fuite, retrouvera sa famille mais choisira de vivre du côté maternel, et, rencontrant les parents de son amant, n'arrivera ici aussi à ne communiquer qu'avec la mère. Benoit Jacquot a ainsi poussé jusqu'au bout son désir de ne filmer, sous le prétexte du fait divers, que son actrice fétiche et quelques femmes.
 Figure de proue de l'avant-garde française des années 20 aux côtés de Louis Delluc, Marcel L'Herbier ou Jean Epstein, Germaine Dulac signe en 1927 L'invitation au voyage, film d'une quarantaine de minutes, prenant comme point de départ un poème de Baudelaire. Une femme délaissée par son mari se rend un soir seule dans un cabaret. Repoussant les avances d'un premier homme, elle accepte ensuite celles d'un officier de la marine et, entre deux verres et deux pas de danse, laisse ses pensées voguer vers des fantasmes d'adultère et d'aventures exotiques.
Figure de proue de l'avant-garde française des années 20 aux côtés de Louis Delluc, Marcel L'Herbier ou Jean Epstein, Germaine Dulac signe en 1927 L'invitation au voyage, film d'une quarantaine de minutes, prenant comme point de départ un poème de Baudelaire. Une femme délaissée par son mari se rend un soir seule dans un cabaret. Repoussant les avances d'un premier homme, elle accepte ensuite celles d'un officier de la marine et, entre deux verres et deux pas de danse, laisse ses pensées voguer vers des fantasmes d'adultère et d'aventures exotiques.
 "La rue est entrée dans la chambre". Vers la fin d'Innocents (The dreamers), Isabelle explique ainsi le bris de glace, provoqué par un pavé, à Matthew et Theo, réveillés en sursaut. L'incident semble n'exister que comme tour scénaristique un peu forcé. Mais il y a le rythme que Bertolucci donne à sa scène, l'affairement d'Isabelle occupée à cacher quelque chose aux deux autres et surtout cette phrase, qui sonne comme une belle trouvaille, appropriée à la fois à l'instant et à l'heure et demie que nous venons de passer avec ces trois personnes. Tout le charme fragile du film est résumé dans cette scène.
"La rue est entrée dans la chambre". Vers la fin d'Innocents (The dreamers), Isabelle explique ainsi le bris de glace, provoqué par un pavé, à Matthew et Theo, réveillés en sursaut. L'incident semble n'exister que comme tour scénaristique un peu forcé. Mais il y a le rythme que Bertolucci donne à sa scène, l'affairement d'Isabelle occupée à cacher quelque chose aux deux autres et surtout cette phrase, qui sonne comme une belle trouvaille, appropriée à la fois à l'instant et à l'heure et demie que nous venons de passer avec ces trois personnes. Tout le charme fragile du film est résumé dans cette scène. Peau d'Âne vieillit bien. Ou plutôt, Peau d'Âne a arrêté de vieillir, depuis la dernière fois. La fantaisie de Demy capte toujours l'attention des gamins, ce qui, après tout, est le principal.
Peau d'Âne vieillit bien. Ou plutôt, Peau d'Âne a arrêté de vieillir, depuis la dernière fois. La fantaisie de Demy capte toujours l'attention des gamins, ce qui, après tout, est le principal. Ce n'est pas de gaieté de coeur que je m'apprête à dire du mal de Julia. J'avais beaucoup apprécié, à la fin du siècle dernier, La vie rêvée des anges et Le petit voleur. Ce retour était donc attendu et intriguait d'autant plus avec ce projet : tourner aux Etats-Unis l'histoire d'une femme sous influence (celle de l'alcool principalement) qui a cette idée folle de kidnapper un enfant de 8 ans afin d'extorquer à sa famille deux millions de dollars.
Ce n'est pas de gaieté de coeur que je m'apprête à dire du mal de Julia. J'avais beaucoup apprécié, à la fin du siècle dernier, La vie rêvée des anges et Le petit voleur. Ce retour était donc attendu et intriguait d'autant plus avec ce projet : tourner aux Etats-Unis l'histoire d'une femme sous influence (celle de l'alcool principalement) qui a cette idée folle de kidnapper un enfant de 8 ans afin d'extorquer à sa famille deux millions de dollars.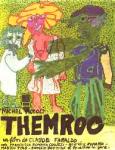 Entre L'an 01 de Gébé et Doillon et les Ferreri de l'époque, voici Themroc, autre fable politique post-68. Un homme refuse un jour l'abrutissant métro-boulot-dodo que la société lui impose. Quittant l'usine, il rejoint son immeuble, se mure dans sa chambre avec sa soeur et détruit à coup de masse la façade donnant sur la cour. De cette caverne, il ne bouge plus que pour partir chasser la nuit un gibier bien particulier : le CRS. Cette révolte animale se propage au voisinage et culmine dans une orgie dont l'ampleur sonore semble faire vaciller la ville entière et donc la société.
Entre L'an 01 de Gébé et Doillon et les Ferreri de l'époque, voici Themroc, autre fable politique post-68. Un homme refuse un jour l'abrutissant métro-boulot-dodo que la société lui impose. Quittant l'usine, il rejoint son immeuble, se mure dans sa chambre avec sa soeur et détruit à coup de masse la façade donnant sur la cour. De cette caverne, il ne bouge plus que pour partir chasser la nuit un gibier bien particulier : le CRS. Cette révolte animale se propage au voisinage et culmine dans une orgie dont l'ampleur sonore semble faire vaciller la ville entière et donc la société. Philippe Ramos, ambitieux, a donné à Moby Dick un prologue. En laissant courir son imagination autant qu'en s'inspirant de la biographie d'Herman Melville et de la sienne, il a inventé une enfance au Capitaine Achab. Cinq chapitres égrènent des épisodes de la vie du chasseur de baleine. Seul le dernier recoupe le roman. Capitaine Achab est un film singulier, fragile et rageant.
Philippe Ramos, ambitieux, a donné à Moby Dick un prologue. En laissant courir son imagination autant qu'en s'inspirant de la biographie d'Herman Melville et de la sienne, il a inventé une enfance au Capitaine Achab. Cinq chapitres égrènent des épisodes de la vie du chasseur de baleine. Seul le dernier recoupe le roman. Capitaine Achab est un film singulier, fragile et rageant. Séance télé familiale pour finir ce week-end pascal, avec le "sommet" du divertissement de cape et d'épée à la française : Le bossu, très mauvais film d'André Hunebelle. Inutile d'en appeller à la nostalgie de l'enfance et au plaisir de retrouvailles avec des acteurs populaires, l'ensemble est aussi plat que le dos de Lagardère est bombé. La trame du roman de Paul Féval en vaut bien d'autres. Encore faut-il donner du rythme, une forme ou une profondeur, toutes choses dont est incapable Hunebelle. Le cinéma français ne parvient pratiquement jamais à filmer correctement l'action et la vitesse nécessaires au genre, cela crève les yeux ici, encore une fois. Le choix des angles, des cadrages et des coupes donne des chevauchées à deux à l'heure. Les séquences de combat trichent grossièrement avec les distances physiques et la vitesse d'exécution. Bourvil doit se charger de gags paresseux et Jean Marais ne s'en sort pas mieux, lui qui est censé vieillir de vingt ans et qui ne change pas d'un cheveu. Les méchants sont empâtés et transparents. Au contraire des productions hollywoodiennes équivalentes, celle-ci a pu bénéficier de décors réels, mais rien n'accroche l'oeil. La comparaison avec, au hasard, l'agréable Trois mousquetaires de George Sidney (on ne veut même pas parler de Scaramouche) est écrasante. Je suis persuadé que le remake de Philippe de Broca avec Daniel Auteuil, sorti en 97, est meilleur que la version de Hunebelle, contrairement à ce qui a été dit à l'époque. C'est pas possible autrement.
Séance télé familiale pour finir ce week-end pascal, avec le "sommet" du divertissement de cape et d'épée à la française : Le bossu, très mauvais film d'André Hunebelle. Inutile d'en appeller à la nostalgie de l'enfance et au plaisir de retrouvailles avec des acteurs populaires, l'ensemble est aussi plat que le dos de Lagardère est bombé. La trame du roman de Paul Féval en vaut bien d'autres. Encore faut-il donner du rythme, une forme ou une profondeur, toutes choses dont est incapable Hunebelle. Le cinéma français ne parvient pratiquement jamais à filmer correctement l'action et la vitesse nécessaires au genre, cela crève les yeux ici, encore une fois. Le choix des angles, des cadrages et des coupes donne des chevauchées à deux à l'heure. Les séquences de combat trichent grossièrement avec les distances physiques et la vitesse d'exécution. Bourvil doit se charger de gags paresseux et Jean Marais ne s'en sort pas mieux, lui qui est censé vieillir de vingt ans et qui ne change pas d'un cheveu. Les méchants sont empâtés et transparents. Au contraire des productions hollywoodiennes équivalentes, celle-ci a pu bénéficier de décors réels, mais rien n'accroche l'oeil. La comparaison avec, au hasard, l'agréable Trois mousquetaires de George Sidney (on ne veut même pas parler de Scaramouche) est écrasante. Je suis persuadé que le remake de Philippe de Broca avec Daniel Auteuil, sorti en 97, est meilleur que la version de Hunebelle, contrairement à ce qui a été dit à l'époque. C'est pas possible autrement.


