Il m'avait dit de me "diriger vers l'Est", afin que l'on se rencontre. N'ayant jamais vu son visage, je scrutais fébrilement le regard de chaque gringo marchant dans ma direction (on connaît bien sûr une photo de lui, mais comment être sûr qu'elle reflétait la réalité et non la légende qu'il aime imprimer). D'abord, je n'aperçus au loin qu'un nuage de poussière. La chaleur était étonnement pesante. Sous un palmier, un gamin jouait de l'harmonica. Je tournai la tête. Une silhouette s'avança vers moi. Le bras s'écarta légèrement du corps, les doigts se tendirent...
... et Vincent me serra la main pour me souhaiter la bienvenue à Nice, où il m'avait cordialement invité à l'occasion des 10ème Rencontres Cinéma et Vidéo.
Le bon Dr Orlof, qui était aussi de la partie, vient d'en parler chez lui. Partageant toutes ses impressions (du plaisir de rencontrer for real Joachim et donc, Vincent et le Doc, jusqu'à la chaleur et la simplicité de l'accueil que l'on nous a réservé), je ne vais pas les répéter ici mais seulement évoquer quelques images de cinéma qui me sont resté en tête après cette journée de projection de courts-métrages indépendants.
 Dans 3240°, Nicolas Pavageau croise en 7 minutes et en un unique plan séquence circulaire les trajectoires de quatre naufragés du désert. Le choix de ce dispositif et la chorégraphie mise en place assurent aux entrées et sorties de champ un caractère toujours étonnant.
Dans 3240°, Nicolas Pavageau croise en 7 minutes et en un unique plan séquence circulaire les trajectoires de quatre naufragés du désert. Le choix de ce dispositif et la chorégraphie mise en place assurent aux entrées et sorties de champ un caractère toujours étonnant.
Juste avant une table ronde entre amis au cours de laquelle j'allai tenter d'articuler péniblement quelques vagues idées, un film de Luc Moullet, Les sièges de l'Alcazar, était projeté (j'y reviendrai plus en détail dans ma prochaine note).
 Doto / Silenceest un documentaire tourné en quinze jours à Lomé, au Togo, par Jérémie Lenoir. Il s'attache à donner parole et espace aux rappeurs d'une région aux abois. Pas de commentaire off, quelques discours, des instants volés et surtout des chansons filmées dans la longueur. Souvent tournées dans les rues, ces séquences musicales sont centrées sur les chanteurs mais laissent le fond du cadre déborder. C'est du brut, un peu long parfois, très bien monté et assez marquant.
Doto / Silenceest un documentaire tourné en quinze jours à Lomé, au Togo, par Jérémie Lenoir. Il s'attache à donner parole et espace aux rappeurs d'une région aux abois. Pas de commentaire off, quelques discours, des instants volés et surtout des chansons filmées dans la longueur. Souvent tournées dans les rues, ces séquences musicales sont centrées sur les chanteurs mais laissent le fond du cadre déborder. C'est du brut, un peu long parfois, très bien monté et assez marquant.
S'ensuivait un programme de petits films Super8 en "tourné-monté" (aucune intervention une fois que les prises sont faites, le réalisateur découvre le résultat en même temps que le public). Ce format si particulier donne une certaine aura même aux ratés techniques. Des séries niçoises et caennaises proposées je retiendrai les beaux plans d'Incendie(Nathalie Portas), le brillant collage des Nouveaux enfants(Yannick Lecoeur) et les trouvailles visuelles du Démon à ma porte(Vincent Ducard). La projection des films anglais de la Maison Straight eight, tournés selon les mêmes principes par des réalisateurs forcément plus aguerris donnait à voir une ribambelle de réussites, la plupart extrêmement drôles, dont se détachait notamment le très surprenant Looking for Marylin(Anna Blandford et Anna Valdez Hanks).
Plongée dans un cinéma autreet belles rencontres amicales : un très bon weekend à Nice...
Liens :


 Dino Risi à la mise en scène, Gérard Brach et Age au scénario, Coluche, Serrault, Tognazzi et Carole Bouquet devant la caméra... Tout ce beau monde fut réuni en 1984 pour accoucher de cette catastrophe qu'est le Bon Roi Dagobert.
Dino Risi à la mise en scène, Gérard Brach et Age au scénario, Coluche, Serrault, Tognazzi et Carole Bouquet devant la caméra... Tout ce beau monde fut réuni en 1984 pour accoucher de cette catastrophe qu'est le Bon Roi Dagobert.

 Ayant lu ma note récente
Ayant lu ma note récente  Entre les murstire sa force de quelques parti-pris intelligents. Pendant les deux heures de projection, jamais nous ne sortons du collège Dolto et si de brèves incursions en salle des profs, dans le bureau du directeur ou dans la cour, nous sont autorisées, c'est bien dans la classe de 4ème, pendant les cours de François Martin (aliasFrançois Bégaudeau), que nous revenons incessamment. Le film débute le jour de la rentrée et se termine à la veille des vacances d'été, balayant ainsi une année scolaire, mais sans apporter de repère temporel particulier entre ces deux bornes. Le récit progresse par blocs de longues séquences, laissant entre chacune d'importantes ellipses, particulièrement reposantes (par exemple, celle qui ne nous explique pas comment ni pourquoi Khoumba revient sur sa décision de ne plus adresser la parole au prof). Travailler ainsi sur la durée permet de laisser les discussions se dérouler dans toute leur complexité et de ne pas mettre en valeur artificiellement les bons mots et les répliques saillantes.
Entre les murstire sa force de quelques parti-pris intelligents. Pendant les deux heures de projection, jamais nous ne sortons du collège Dolto et si de brèves incursions en salle des profs, dans le bureau du directeur ou dans la cour, nous sont autorisées, c'est bien dans la classe de 4ème, pendant les cours de François Martin (aliasFrançois Bégaudeau), que nous revenons incessamment. Le film débute le jour de la rentrée et se termine à la veille des vacances d'été, balayant ainsi une année scolaire, mais sans apporter de repère temporel particulier entre ces deux bornes. Le récit progresse par blocs de longues séquences, laissant entre chacune d'importantes ellipses, particulièrement reposantes (par exemple, celle qui ne nous explique pas comment ni pourquoi Khoumba revient sur sa décision de ne plus adresser la parole au prof). Travailler ainsi sur la durée permet de laisser les discussions se dérouler dans toute leur complexité et de ne pas mettre en valeur artificiellement les bons mots et les répliques saillantes. - Ah non ! Tu ne vas pas encore commencer ta note en parlant de ta difficulté à écrire sur le cinéma de Desplechin, trois mois à peine après
- Ah non ! Tu ne vas pas encore commencer ta note en parlant de ta difficulté à écrire sur le cinéma de Desplechin, trois mois à peine après  Soyons honnête. Même aux yeux du moins cinéphile des spectateurs, les films ne viennent pas au monde égaux. Chacun a beau se dire le plus éclectique du monde ou invariablement bon public, le jugement porté lors de la découverte d'une oeuvre nouvelle est toujours soumis aux lois de la probabilité. Ainsi, la probabilité que ma première rencontre avec le cinéma de Christophe Honoré se passe bien était assez faible, compte tenu de mes affinités avec certains critiques (ceux de Positif) ou certains bloggeurs qui n'ont jamais été tendres avec le cinéaste.
Soyons honnête. Même aux yeux du moins cinéphile des spectateurs, les films ne viennent pas au monde égaux. Chacun a beau se dire le plus éclectique du monde ou invariablement bon public, le jugement porté lors de la découverte d'une oeuvre nouvelle est toujours soumis aux lois de la probabilité. Ainsi, la probabilité que ma première rencontre avec le cinéma de Christophe Honoré se passe bien était assez faible, compte tenu de mes affinités avec certains critiques (ceux de Positif) ou certains bloggeurs qui n'ont jamais été tendres avec le cinéaste. L'insoumisdémarre en Kabylie en 1959 avec une embuscade dans laquelle des soldats sont pris sous le feu de tireurs algériens. Thomas, l'un des légionnaires, tente un coup d'éclat en allant porter secours à un camarade amoché en contrebas. Arrivé difficilement à ses côtés, il s'aperçoit que l'homme est déjà mort. Le deuxième long-métrage d'Alain Cavalier, dès son introduction, annonce la couleur : noire. A ses débuts, le cinéaste, comme Claude Sautet à la même époque, oeuvrait dans le film noir (avec Le combat dans l'île en 1962, puis Mise à sac en 1967). L'insoumisest en plein dans le genre, mais son argument de départ, lié à la guerre d'Algérie, change déjà beaucoup de choses (et ce film, avec d'autres, tord encore le cou à la légende tenace selon laquelle le cinéma français aurait traîné pour traiter de la question).
L'insoumisdémarre en Kabylie en 1959 avec une embuscade dans laquelle des soldats sont pris sous le feu de tireurs algériens. Thomas, l'un des légionnaires, tente un coup d'éclat en allant porter secours à un camarade amoché en contrebas. Arrivé difficilement à ses côtés, il s'aperçoit que l'homme est déjà mort. Le deuxième long-métrage d'Alain Cavalier, dès son introduction, annonce la couleur : noire. A ses débuts, le cinéaste, comme Claude Sautet à la même époque, oeuvrait dans le film noir (avec Le combat dans l'île en 1962, puis Mise à sac en 1967). L'insoumisest en plein dans le genre, mais son argument de départ, lié à la guerre d'Algérie, change déjà beaucoup de choses (et ce film, avec d'autres, tord encore le cou à la légende tenace selon laquelle le cinéma français aurait traîné pour traiter de la question).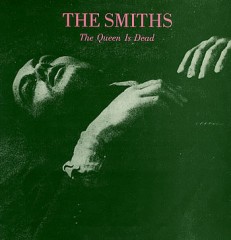
 Je précise d'emblée que vous ne trouverez ici nulle remarque sur "l'affaire Brisseau" qui occupa bien du monde en 2005. Je n'en connais précisément ni les détails ni les conséquences actuelles. Des deux positions les plus affirmées par les commentateurs de l'époque aucune ne me convient : ni le lynchage d'une personnalité hors-norme, ni l'excuse de tout écart au nom d'une grande oeuvre. Je ne tiens pas à ajouter d'autres sottises.
Je précise d'emblée que vous ne trouverez ici nulle remarque sur "l'affaire Brisseau" qui occupa bien du monde en 2005. Je n'en connais précisément ni les détails ni les conséquences actuelles. Des deux positions les plus affirmées par les commentateurs de l'époque aucune ne me convient : ni le lynchage d'une personnalité hors-norme, ni l'excuse de tout écart au nom d'une grande oeuvre. Je ne tiens pas à ajouter d'autres sottises.