(Ivan Passer / Tchécoslovaquie / 1965)
■■□□
 La courbe de la carrière d'Ivan Passer a commencé par épouser exactement celle de son collègue et ami Milos Forman : participation à l'écriture de trois films de ce dernier (Concours, Les amours d'une blonde et Au feu les pompiers!), passage à la réalisation en s'appuyant sur une méthode de tournage proche (acteurs non-professionnels, travail basé sur l'improvisation), premier rôle féminin confié à Madame Forman (Vera Kresadlova), excellent accueil critique international avant l'exil et la poursuite des activités aux États-Unis. À partir de là, les chemins divergent brusquement car lorsque Forman s'impose dans les années 70 grâce à des films grinçants et spectaculaires, Passer doit batailler ferme pour glisser sa sensibilité dans des oeuvres plus normalisées. De l'ensemble de sa filmographie, seuls Né pour vaincre (Born to win, 1971) et La blessure (Cutter's way, 1981) confirmeront réellement les promesses d'Éclairage intime (Intimni osvetleni). De fait, le nom de Passer reste aujourd'hui relégué dans l'ombre alors que nombre de critiques en faisaient, à la fin des années 60, l'auteur le plus important du nouveau cinéma tchèque.
La courbe de la carrière d'Ivan Passer a commencé par épouser exactement celle de son collègue et ami Milos Forman : participation à l'écriture de trois films de ce dernier (Concours, Les amours d'une blonde et Au feu les pompiers!), passage à la réalisation en s'appuyant sur une méthode de tournage proche (acteurs non-professionnels, travail basé sur l'improvisation), premier rôle féminin confié à Madame Forman (Vera Kresadlova), excellent accueil critique international avant l'exil et la poursuite des activités aux États-Unis. À partir de là, les chemins divergent brusquement car lorsque Forman s'impose dans les années 70 grâce à des films grinçants et spectaculaires, Passer doit batailler ferme pour glisser sa sensibilité dans des oeuvres plus normalisées. De l'ensemble de sa filmographie, seuls Né pour vaincre (Born to win, 1971) et La blessure (Cutter's way, 1981) confirmeront réellement les promesses d'Éclairage intime (Intimni osvetleni). De fait, le nom de Passer reste aujourd'hui relégué dans l'ombre alors que nombre de critiques en faisaient, à la fin des années 60, l'auteur le plus important du nouveau cinéma tchèque.
Cette place accordée alors au cinéaste, sur la foi d'un seul long-métrage (et du court Un fade après-midi, 1964), peut étonner. L'une des explications possibles à cet engouement tiendrait du phénomène de génération. Tout cinéphile, particulièrement dans ses jeunes années, connaît un jour ce sentiment d'être soudain en phase avec une oeuvre, la révélation se mêlant à la reconnaissance (la découverte peut avoir concerné Monte Hellman, Leos Carax, Jim Jarmusch, Hal Hartley, Sofia Coppola... chacun, selon son âge et son goût, ajoutera les noms qu'il voudra). Sur ces films qui nous sont chers, le temps ne nous semble plus avoir de prise, mais les publics nous succédant peuvent parfois n'y trouver qu'un certain charme.
Souvent, ces oeuvres sont fragiles, ne déroulant qu'un fil narratif ténu. Éclairage intime est avant tout une chronique, dans laquelle l'attention aux petits riens du quotidien est plus importante que la progression du récit. Aucun clou dramatique ne vient ponctuer cette histoire de soliste se retrouvant chez un ancien ami, à l'occasion d'un concert dont nous ne verrons finalement rien. L'arrivée d'un couple de jeunes citadins à la campagne : la mise en place de toute une série d'oppositions pouvait provoquer des étincelles scénaristiques, voire l'établissement d'une hiérarchie des valeurs. Pourtant, Ivan Passer se garde de toute critique et de tout jugement moral, ses vignettes, qu'elles soient centrées sur les figures locales ou sur son dandy praguois de héros, croquent avec amusement et tendresse. Nous sommes au coeur d'un cinéma du détour et de l'observation qui trouve sa meilleure expression dans la longue séquence de l'enterrement, avec ses à-côtés incongrus et calmes. L'humour est constant mais le rire jamais négatif. La vie irrigue subtilement les plans : il n'est pas rare que le cadre se décentre brièvement, attiré par une action secondaire, qu'un arrière-plan s'entrouvre sur une activité ludique insoupçonnée. La lumière naturelle et chaleureuse ainsi que le rythme, qui est celui de la marche, participent de notre attachement aux personnages.
Les comédiens sont des amateurs mais des vrais musiciens. Démarrant sur une répétition d'orchestre, l'oeuvre est toute entière dédiée à la musique. Dans le salon de Bambas, un quatuor s'exercera ou tentera de le faire, régulièrement et comiquement perturbé par les interventions extérieures ou les remarques incessantes de deux de ses membres. Cependant, même ces pauses forcées et ces échanges relativement vifs recouvrant la musique se coulent dans le mouvement. Tout dans Éclairage intime finit par devenir musical : un grincement de portail, un chant d'oiseau, un klaxon, des ronflements. La lumière elle-même, comme elle pénètre dans le salon, aide à trouver cette harmonie générale.
Le prolongement logique de l'allégresse musicale est la danse. Un bal succède à l'enterrement mais les mouvements dansés se retrouvent en plusieurs endroits et en des moments moins attendus. La grand-mère se lance ainsi dans quelques exercices physiques et trois silhouettes féminines se mettent à avancer en rythme dans le couloir, semblant caler parfaitement leur démarche légère sur la partition entendue. Toujours attaché à extraire la poésie du réel, Passer maintient le lien avec la réalité : la grand-mère évoquait sa vie passée dans un cirque et les trois femmes marchaient précautionneusement vers la chambre des enfants endormis.
Il est une dernière danse, dans un mouvement plus pathétique, celui de Petr et de Bambas, lorsque leurs silhouettes se découpent dans la nuit sous les phares des voitures. C'est que l'arrivée de Petr a provoqué quelques interrogations existentielles chez Bambas : est-il coincé par sa petite vie de famille, est-il étouffé par sa femme, ses enfants, ses beaux-parents, ne vaut-il pas mieux que ces concerts provinciaux, ces fêtes de village, ne devrait-il pas partir à l'aventure en compagnie de son ami ? Cette inertie est gentiment moquée dans une dernière séquence étonnante qui fige les personnages. Mais là non plus, Passer n'inflige pas de leçon. Le bonheur peut aussi bien naître d'une accommodation face à sa "petite vie". En traitant cette problématique de manière biaisée, en passant par une longue soirée d'éthylisme, la dernière partie de ce film très court voit s'opérer une certaine dilution, une sorte d'arythmie sans doute provoquée par la difficulté, sans cesse mise à jour, de faire partager au spectateur de cinéma un état d'hébriété.
Ce relatif affaissement narratif, au moment où s'imposent le plus nettement les enjeux moraux du film, constitue la principale limite d'Éclairage intime. Il ne faut toutefois pas s'y arrêter et goûter à son charme afin de profiter de cette nouvelle occasion qui nous est offerte de plonger dans une période féconde de l'histoire du cinéma, probablement celle où de jeunes réalisateurs ont représentés avec le plus de gourmandise et de tendresse leurs contemporains.
(Chronique DVD pour Kinok)

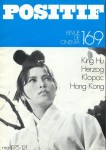 1975 : Aux Cahiers, l'année démarre en faisant le point sur Mai 68 et la suite, à travers un numéro consacré au cinéma militant, et se poursuit en ferraillant contre le cinéma naturaliste français ("Une certaine tendance du cinéma français" par Daney, Kané, Oudart et Toubiana). Peu de films sont encore étudiés mais l'accent est mis sur India song de Marguerite Duras et Milestones de Douglas et Kramer. Surtout, le Moïse et Aaron de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet est loué sur plusieurs numéros, dont un qui lui est spécialement réservé en octobre.
1975 : Aux Cahiers, l'année démarre en faisant le point sur Mai 68 et la suite, à travers un numéro consacré au cinéma militant, et se poursuit en ferraillant contre le cinéma naturaliste français ("Une certaine tendance du cinéma français" par Daney, Kané, Oudart et Toubiana). Peu de films sont encore étudiés mais l'accent est mis sur India song de Marguerite Duras et Milestones de Douglas et Kramer. Surtout, le Moïse et Aaron de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet est loué sur plusieurs numéros, dont un qui lui est spécialement réservé en octobre.
 Quitte à choisir : Amateurs des Cahiers, patience... Le retour des films en couverture et d'un rythme de parution plus soutenu, c'est pour 76. En attendant, en face, notre goût nous pousse à acquiescer aux choix de California split, du Tavernier, du King Hu et du Lewis. Cela dit, de part et d'autre, il nous reste de gros morceaux à découvrir : les films de Straub, Duras, Kramer, Angelopoulos et le deuxième Altman en question. Allez, pour 1975 : Avantage Positif.
Quitte à choisir : Amateurs des Cahiers, patience... Le retour des films en couverture et d'un rythme de parution plus soutenu, c'est pour 76. En attendant, en face, notre goût nous pousse à acquiescer aux choix de California split, du Tavernier, du King Hu et du Lewis. Cela dit, de part et d'autre, il nous reste de gros morceaux à découvrir : les films de Straub, Duras, Kramer, Angelopoulos et le deuxième Altman en question. Allez, pour 1975 : Avantage Positif. Si vous n'aimez pas la campagne et ses rustauds...
Si vous n'aimez pas la campagne et ses rustauds... En 1981, Louis Malle est en plein milieu de sa période américaine, celle qui débute après Lacombe Lucien (1974), qui se termine juste avant Au revoir les enfants (1987) et qui englobe huit long-métrages dont deux documentaires. Film très particulier au sein de ce corpus, My dinner with André se place en équilibre entre fiction et réalité. En équilibre mais pas en porte-à-faux, dans la mesure où la question du degré de réalité ne se pose finalement pas vraiment devant le récit qui nous est conté car le dispositif choisi par le cinéaste, malgré sa simplicité apparente et son minimalisme, n'est pas documentaire mais purement théâtral.
En 1981, Louis Malle est en plein milieu de sa période américaine, celle qui débute après Lacombe Lucien (1974), qui se termine juste avant Au revoir les enfants (1987) et qui englobe huit long-métrages dont deux documentaires. Film très particulier au sein de ce corpus, My dinner with André se place en équilibre entre fiction et réalité. En équilibre mais pas en porte-à-faux, dans la mesure où la question du degré de réalité ne se pose finalement pas vraiment devant le récit qui nous est conté car le dispositif choisi par le cinéaste, malgré sa simplicité apparente et son minimalisme, n'est pas documentaire mais purement théâtral.


 1974 : Sous l'impulsion de Daney et Toubiana, les Cahiers reviennent peu à peu aux films, même si cela passe beaucoup par des croisements avec d'autres disciplines (dossier sur le dramaturge Dario Fo, entretien avec Michel Foucault) et que les écrits les plus marquants consistent à s'attaquer au "rétro" (Lacombe Lucien et Portier de nuit dans le même sac). Dans une approche plus "positive", la revue s'attache à défendre René Allio et son Rude journée pour la reine ou le cinéma anti-impérialiste de l'Amérique latine, à travers les films de Jorge Sanjines, Helvio Soto et Miguel Littin.
1974 : Sous l'impulsion de Daney et Toubiana, les Cahiers reviennent peu à peu aux films, même si cela passe beaucoup par des croisements avec d'autres disciplines (dossier sur le dramaturge Dario Fo, entretien avec Michel Foucault) et que les écrits les plus marquants consistent à s'attaquer au "rétro" (Lacombe Lucien et Portier de nuit dans le même sac). Dans une approche plus "positive", la revue s'attache à défendre René Allio et son Rude journée pour la reine ou le cinéma anti-impérialiste de l'Amérique latine, à travers les films de Jorge Sanjines, Helvio Soto et Miguel Littin.
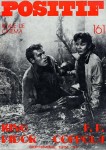 Quitte à choisir : Petit retour des Cahiers dans la course avec des choix limités numériquement mais a priori assez pertinents (souvenir fort du documentaire de Yann Le Masson, Kashima Paradise, par ailleurs également défendu par Positif) et, malgré les grands noms, léger coup de moins bien chez la revue d'en-face. Le Rosi, le Comencini, le Makavejev sont seulement, disons, "à voir" et le Boorman peut carrément être évité. Il reste tout même Fellini dessinateur, Vidor, Buñuel, Sautet (et probablement Guerra et Saura). Allez, pour 1974 : Avantage Positif.
Quitte à choisir : Petit retour des Cahiers dans la course avec des choix limités numériquement mais a priori assez pertinents (souvenir fort du documentaire de Yann Le Masson, Kashima Paradise, par ailleurs également défendu par Positif) et, malgré les grands noms, léger coup de moins bien chez la revue d'en-face. Le Rosi, le Comencini, le Makavejev sont seulement, disons, "à voir" et le Boorman peut carrément être évité. Il reste tout même Fellini dessinateur, Vidor, Buñuel, Sautet (et probablement Guerra et Saura). Allez, pour 1974 : Avantage Positif.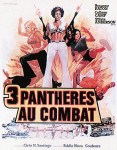 Ceux qui aimaient la série B étaient peut-être les moins bien lotis. Trois produits de Hong-Kong, pas franchement attirants, sortaient en salles : Kung fu lama contre boxeur chinois (de N.G. See Yuen), Poings d'acier contre les griffes du tigre (Yeh Yung Chou) et Les quatre forcenés de Shaolin (Liu Chia Fei). Dans le même esprit, Trois panthères au combat, signé par Cirio H. Santiago, battait pavillon philippin. Côté occidental, la moisson n'était pas plus emballante : USA : Profession tueur, un polar espagnol, comme son nom ne l'indique pas, de José-Luis Merino, Sévices à la prison des femmes, dont le sujet tient dans le titre, de Sergio Garrone, Le baroudeur un post-Rambo anglais de Philip Chalong et Catherine chérie un film érotique soft hispano-allemand de Hubert Frank.
Ceux qui aimaient la série B étaient peut-être les moins bien lotis. Trois produits de Hong-Kong, pas franchement attirants, sortaient en salles : Kung fu lama contre boxeur chinois (de N.G. See Yuen), Poings d'acier contre les griffes du tigre (Yeh Yung Chou) et Les quatre forcenés de Shaolin (Liu Chia Fei). Dans le même esprit, Trois panthères au combat, signé par Cirio H. Santiago, battait pavillon philippin. Côté occidental, la moisson n'était pas plus emballante : USA : Profession tueur, un polar espagnol, comme son nom ne l'indique pas, de José-Luis Merino, Sévices à la prison des femmes, dont le sujet tient dans le titre, de Sergio Garrone, Le baroudeur un post-Rambo anglais de Philip Chalong et Catherine chérie un film érotique soft hispano-allemand de Hubert Frank. Ceux qui aimaient les polars avaient le choix entre le singulier sérieux et le singulier déconnant. The hit, deuxième long-métrage cinéma de Stephen Frears, est un polar écrasé par le soleil espagnol et dont la distribution fait saliver : Terence Stamp, John Hurt, Laura del Sol, Tim Roth. Je ne l'ai malheureusement toujours pas vu. Les trottoirs de Bangkok non plus (franchement, il me tarde moins). C'est apparemment une parodie d'espionnage, un peu olé-olé, filmée par Jean Rollin.
Ceux qui aimaient les polars avaient le choix entre le singulier sérieux et le singulier déconnant. The hit, deuxième long-métrage cinéma de Stephen Frears, est un polar écrasé par le soleil espagnol et dont la distribution fait saliver : Terence Stamp, John Hurt, Laura del Sol, Tim Roth. Je ne l'ai malheureusement toujours pas vu. Les trottoirs de Bangkok non plus (franchement, il me tarde moins). C'est apparemment une parodie d'espionnage, un peu olé-olé, filmée par Jean Rollin.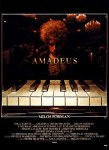 Ceux qui aimaient les grands auteurs affichaient un large sourire. Broadway Danny Rose est en effet l'un des meilleurs Woody Allen, hommage drôlatique et en noir et blanc à tous les artistes de seconde zone (Woody lui-même en impresario inoubliable). Milos Forman, lui, frappait très fort avec Amadeus, film rieur et funèbre, bien plus passionnant que les films-opéras de prestige réalisés à l'époque. Revue il y a quelques années, l'oeuvre tient diablement le coup. Maria's lovers, le mélodrame d'Andreï Konchalovsky, avec John Savage et Nastassja Kinski, est l'un des titres-phares du soviétique expatrié (mais mon souvenir est bien trop brumeux). Les yeux la bouche est un étrange projet de Marco Bellocchio, une mise en abyme, avec la complicité de Lou Castel, à partir de leur coup d'essai-coup de maître de 1966, Les poings dans les poches. Enfin, Souleymane Cissé voyait distribué son film de 1978, Baara.
Ceux qui aimaient les grands auteurs affichaient un large sourire. Broadway Danny Rose est en effet l'un des meilleurs Woody Allen, hommage drôlatique et en noir et blanc à tous les artistes de seconde zone (Woody lui-même en impresario inoubliable). Milos Forman, lui, frappait très fort avec Amadeus, film rieur et funèbre, bien plus passionnant que les films-opéras de prestige réalisés à l'époque. Revue il y a quelques années, l'oeuvre tient diablement le coup. Maria's lovers, le mélodrame d'Andreï Konchalovsky, avec John Savage et Nastassja Kinski, est l'un des titres-phares du soviétique expatrié (mais mon souvenir est bien trop brumeux). Les yeux la bouche est un étrange projet de Marco Bellocchio, une mise en abyme, avec la complicité de Lou Castel, à partir de leur coup d'essai-coup de maître de 1966, Les poings dans les poches. Enfin, Souleymane Cissé voyait distribué son film de 1978, Baara.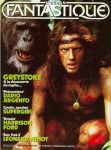 Ceux qui aimaient lire les revues pouvaient prolonger leurs réflexions sur L'amour à mort d'Alain Resnais, sorti le mois précédent, grâce à Positif (284) et à La revue du Cinéma (398) et sur Le futur est femme de Marco Ferreri, également à l'affiche depuis septembre, grâce à Cinéma 84 (310). Ils pouvaient aussi regarder dans les yeux Christophe Lambert sur les couvertures de Première (91), de Starfix (19) et de L'Écran Fantastique (49), lire un dossier "Méthodes de tournage" dans les Cahiers du Cinéma (364, photo d'Eric Rohmer tournant Les nuits de la pleine lune) et s'attacher au cinéma documentaire par l'intermédiaire de Jeune Cinéma (161, en couve : The good flight de Noel Buckner, Mary Dore et Sam Sills).
Ceux qui aimaient lire les revues pouvaient prolonger leurs réflexions sur L'amour à mort d'Alain Resnais, sorti le mois précédent, grâce à Positif (284) et à La revue du Cinéma (398) et sur Le futur est femme de Marco Ferreri, également à l'affiche depuis septembre, grâce à Cinéma 84 (310). Ils pouvaient aussi regarder dans les yeux Christophe Lambert sur les couvertures de Première (91), de Starfix (19) et de L'Écran Fantastique (49), lire un dossier "Méthodes de tournage" dans les Cahiers du Cinéma (364, photo d'Eric Rohmer tournant Les nuits de la pleine lune) et s'attacher au cinéma documentaire par l'intermédiaire de Jeune Cinéma (161, en couve : The good flight de Noel Buckner, Mary Dore et Sam Sills).
 Seul long-métrage cinéma d'Almodovar qui manquait jusqu'à présent à mon tableau de chasse, Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? (Qué he hecho yo para merecer hesto !!) trouve parfaitement sa place en tant qu'oeuvre de transition entre la première période du cinéaste (ses trois premiers films "officiels", provocateurs, foutraques, débraillés et très underground) et la deuxième (celle qui le voit accéder au statut d'auteur européen d'envergure, à partir de la deuxième moitié de la décennie 80).
Seul long-métrage cinéma d'Almodovar qui manquait jusqu'à présent à mon tableau de chasse, Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? (Qué he hecho yo para merecer hesto !!) trouve parfaitement sa place en tant qu'oeuvre de transition entre la première période du cinéaste (ses trois premiers films "officiels", provocateurs, foutraques, débraillés et très underground) et la deuxième (celle qui le voit accéder au statut d'auteur européen d'envergure, à partir de la deuxième moitié de la décennie 80). J'ai découvert il y a cinq ans de cela la version de Griffith des Deux orphelines (Orphans of the storm). Quelques notes griffonées alors me permettent de me la remémorer, au moment d'écrire sur celle de Tourneur.
J'ai découvert il y a cinq ans de cela la version de Griffith des Deux orphelines (Orphans of the storm). Quelques notes griffonées alors me permettent de me la remémorer, au moment d'écrire sur celle de Tourneur. Douze ans plus tard, Maurice Tourneur réalise à son tour Les Deux orphelines pour un résultat qui n'est point trop indigne du précédent (il existe plusieurs autres versions, dont une de Riccardo Freda, datant des années 60). Nous n'y trouvons certes pas les mêmes fulgurantes inspirations et Rosine Déréan et Renée Saint-Cyr n'ont pas l'aura des soeurs Gish. Toutefois, le plaisir du récit mélodramatique est toujours présent. Le développement narratif est moins complexe mais assez rigoureux. Tourneur est resté fidèle au roman d'Eugène Cormon et Adolphe d'Ennery : de la Révolution, nous ne sentons qu'à peine les frémissements, là où Griffith faisait intervenir dans son scénario Danton et Robespierre.
Douze ans plus tard, Maurice Tourneur réalise à son tour Les Deux orphelines pour un résultat qui n'est point trop indigne du précédent (il existe plusieurs autres versions, dont une de Riccardo Freda, datant des années 60). Nous n'y trouvons certes pas les mêmes fulgurantes inspirations et Rosine Déréan et Renée Saint-Cyr n'ont pas l'aura des soeurs Gish. Toutefois, le plaisir du récit mélodramatique est toujours présent. Le développement narratif est moins complexe mais assez rigoureux. Tourneur est resté fidèle au roman d'Eugène Cormon et Adolphe d'Ennery : de la Révolution, nous ne sentons qu'à peine les frémissements, là où Griffith faisait intervenir dans son scénario Danton et Robespierre.