(King Vidor / Etats-Unis / 1940)
■■■□
 Devant les abus des autorités et l'intolérance de la bonne société de Portsmouth, Langdon Towne, fraîchement viré de Harvard, et son ami Hunk Marriner partent à l'aventure vers l'Ouest. Ils croisent alors la route du Major Rogers et de son bataillon de Rangers, soutenu par les Anglais. Le militaire a besoin d'un cartographe et prenant connaissance des talents de dessinateur de Towne, les invite à se joindre à eux pour une expédition périlleuse destinée à anéantir une tribu d'indiens alliés aux Français.
Devant les abus des autorités et l'intolérance de la bonne société de Portsmouth, Langdon Towne, fraîchement viré de Harvard, et son ami Hunk Marriner partent à l'aventure vers l'Ouest. Ils croisent alors la route du Major Rogers et de son bataillon de Rangers, soutenu par les Anglais. Le militaire a besoin d'un cartographe et prenant connaissance des talents de dessinateur de Towne, les invite à se joindre à eux pour une expédition périlleuse destinée à anéantir une tribu d'indiens alliés aux Français.
Selon la tradition, notre regard épousera donc celui des deux témoins Towne et Marriner (l'excellent Robert Young et l'indispensable Walter Brennan) pour mieux plonger dans la vie des Rangers et admirer la force de caractère de l'homme d'exception placé à leur tête (Spencer tracy, à la fois intransigeant et humain, ferme et accessible). Mais avant toute chose, dans ce Grand passage (Northwest passage), frappe le cadre dans lequel se déroule cette rencontre avec un corps militaire car une fois passée l'introduction, nous serons placé au coeur de la nature immense, protectrice parfois, meurtrière souvent. Dans un prodigieux Technicolor, Vidor capte en extérieurs son incroyable présence, rend toute la vérité d'un terrain et traduit sans détour l'impact physique de celui-ci sur les hommes. S'y fondre ne va pas de soi, l'union se mérite et l'effort est permanent pour y parvenir. Quelques plans magnifiques montrent les Rangers (tout de vert vêtus) au repos, se confondant aux broussailles à flan de colline ou épousant la forme des branches émergeant des eaux d'un marais. Plus douloureusement, titubant en guenilles, ils se mettront à ressembler aux herbes folles brûlées par le soleil qui envahissent le fort désert, là où ils pensaient connaître la fin de leur calvaire. La majeure partie du récit se réduit en fait à une série d 'épreuves : faire basculer d'un flan à l'autre d'une colline une dizaine de canots (comme Fitzcarraldo son bateau), patauger dans un marais infesté de moustiques, former une chaîne humaine afin de traverser un torrent indomptable. Chacune de ces séquences se déploie dans toute sa longueur, Vidor alternant plans d'ensemble situant l'action face aux éléments et plans rapprochés rendant l'effort physique évident (on sent littéralement la densité des matières, comme celle du bois dont sont faits les canots). Le lyrisme ne découle donc pas seulement de la majesté du cadre mais aussi d'une épaisseur concrète des choses. Question de moyens bien sûr, et surtout, de savoir-faire. Le bataillon est constitué de 200 hommes au départ et d'une quarantaine à l'arrivée. On nous le dit et on le voit réellement sur l'écran. L'artifice et la simulation n'ont pas leur place ici.
Cette approche est nécessaire pour faire passer l'éloge de la volonté, de l'endurance et de la résistance. La morale est militaire : l'homme s'élève par l'effort, la mission passe avant tout et les morts laissés derrière ne doivent pas ébranler l'âme. Elle s'accorde aussi parfaitement avec l'idéologie américaine : le chef charismatique guide et galvanise ses troupes, les aidant à trouver des ressources insoupçonnés de courage, mais il peut également se soumettre à un vote de ses subordonnés lorsque les tensions naissent d'une situation extrême qui n'est plus tenable. Toutefois, l'homme providentiel n'est pas Dieu, il ne le remplace pas (le dernier plan, qui en rajoute dans le messianisme, fut semble-t-il tourné dans le dos de Vidor) et Rogers aura son instant d'affaissement, en craquant, bien à l'abri des regards. A l'image de ce dernier personnage, le film de Vidor est moins dirigiste qu'il n'y paraît. Towne, le dessinateur, s'il se trouvera profondément changé par le périple et sa rencontre avec Rogers, n'endossera pas pour autant l'uniforme, restera civil et deviendra peut-être, comme le souhaite sa femme retrouvée (par l'épreuve), un grand peintre, une fois installé en Europe, à Londres.
Comme souvent dans le Hollywood classique, il est fort intéressant de se pencher sur la façon dont sont vus les Indiens. Dans les rangs des Rangers, la haine est le moteur de ceux qui ont vécu les massacres de proches et la violence des témoignages surprend (scalps mais aussi éviscérations et autres amabilités, pratiques qui ne sont pas l'apanage des ennemis puisque l'un des militaires ira jusqu'au cannibalisme). Pourtant, le spectre des sentiments envers les Indiens est relativement large (Towne souhaite, au départ, juste aller à leur rencontre afin de les dessiner, d'autres n'y font guère allusion et ne semblent pas être obnubilés par le problème). Vidor ne monte pas de plan de réaction lorsqu'est fait par un soldat l'horrible récit destiné à galvaniser ses camarades et à l'heure de la bataille, certains freineront l'ardeur des plus hallucinés. Le cinéaste cède donc moins à une vision manichéenne qu'il ne traduit l'état d'esprit probable de ces militaires. Le seul épisode guerrier n'advient qu'à la moitié du métrage et il n'a rien d'une glorification par le face à face. La bataille éngagée ne l'est nullement sur un pied d'égalité qui permettrait aux Blancs victorieux de tirer le plus grand bénéfice. L'écrasement de l'ennemi est la conséquence d'une attaque-piège dans laquelle aucune chance n'est laissée, visant jusqu'aux femmes et aux enfants. Vidor, au terme de cette longue séquence au cours de laquelle ne s'entend aucune note de musique, dans un geste réaliste et dérangeant (on voit Towne recharger allègrement son fusil), assume l'image terrible qui change l'affrontement en extermination pure et simple : les derniers Indiens survivants sont encerclés au centre de leur village, désarmés pour la plupart, et sont abattus. Mission accomplie. Guerre nécessaire pour ces soldats, sans doute, sale assurément (au moins deux y laisseront leur santé mentale).
Le grand passage est un film fort, une oeuvre ample qui avance lentement mais sûrement, où chaque élément scénaristique devient une toute autre chose qu'une simple péripétie, transfiguré qu'il est par la mise en scène.
 En un long plan-séquence serré, Amos Gitai filme Natalie Portman en pleurs, assise à l'arrière d'une voiture, au son d'une chanson israélienne jouant sur la répétition des phrases. Les premières minutes de Free Zone sont aussi radicales que l'étaient les dernières du Vive l'amour de Tsai Ming-liang (1994) où l'on voyait de même une femme se mettre à pleurer sans pouvoir s'arrêter. Ici, les gestes de l'actrice américaine qui, en essuyant ses joues perd son maquillage, prennent la forme d'un dépouillement des artifices, nécessaire à l'immersion d'une figure occidentale dans la réalité brute du Proche-Orient. En imposant ce dispositif d'emblée, le cinéaste accroche le spectateur mais, en ne s'y tenant pas exclusivement par la suite, prend le risque de relâcher la pression.
En un long plan-séquence serré, Amos Gitai filme Natalie Portman en pleurs, assise à l'arrière d'une voiture, au son d'une chanson israélienne jouant sur la répétition des phrases. Les premières minutes de Free Zone sont aussi radicales que l'étaient les dernières du Vive l'amour de Tsai Ming-liang (1994) où l'on voyait de même une femme se mettre à pleurer sans pouvoir s'arrêter. Ici, les gestes de l'actrice américaine qui, en essuyant ses joues perd son maquillage, prennent la forme d'un dépouillement des artifices, nécessaire à l'immersion d'une figure occidentale dans la réalité brute du Proche-Orient. En imposant ce dispositif d'emblée, le cinéaste accroche le spectateur mais, en ne s'y tenant pas exclusivement par la suite, prend le risque de relâcher la pression. Trois camarades (Three comrades) s'ouvre sur le soulagement d'une poignée de soldats allemands célébrant dans leur cantine la fin de la guerre (celle de 14-18). Parmi eux, Erich, Otto et Gottfried portent un toast qui n'a pas grand chose d'enjoué. En démarrant au soir de l'arrêt des hostilités, le récit se déploie à partir d'une blessure dont la cicatrisation se révèlera impossible et se leste d'un sentiment de tristesse insondable.
Trois camarades (Three comrades) s'ouvre sur le soulagement d'une poignée de soldats allemands célébrant dans leur cantine la fin de la guerre (celle de 14-18). Parmi eux, Erich, Otto et Gottfried portent un toast qui n'a pas grand chose d'enjoué. En démarrant au soir de l'arrêt des hostilités, le récit se déploie à partir d'une blessure dont la cicatrisation se révèlera impossible et se leste d'un sentiment de tristesse insondable.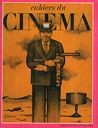
 1968 : En début d'année, c'est "l'affaire Langlois" qui agite le monde du cinéma et dès leurs numéros de mars, les Cahiers et Positif affichent leur soutien au directeur de la Cinémathèque. Dans la foulée surviennent les événements de mai dont les deux revues rendent abondamment compte en juin et juillet, des Etats Généraux du Cinéma au Festival de Cannes en passant par la recension des nombreux films et reportages nés des mouvements de révolte printaniers.
1968 : En début d'année, c'est "l'affaire Langlois" qui agite le monde du cinéma et dès leurs numéros de mars, les Cahiers et Positif affichent leur soutien au directeur de la Cinémathèque. Dans la foulée surviennent les événements de mai dont les deux revues rendent abondamment compte en juin et juillet, des Etats Généraux du Cinéma au Festival de Cannes en passant par la recension des nombreux films et reportages nés des mouvements de révolte printaniers.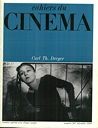
 Quitte à choisir : Les choix de Metropolis et Vampyr s'annulent (comme ceux des couvertures de l'été, consacrées à deux oeuvres audacieuses mais bancales) mais ensuite les films de Delvaux, Mankiewicz, Brooks et Kubrick surplombent ces Truffaut, Lubitsch et Buñuel-là. Ceux de Lewis, Rivette, Pollet et Demy suffiraient-ils à rétablir la balance, même sans parler du Rocha et du Mingozzi ? Allez, pour 1968 : Avantage Positif.
Quitte à choisir : Les choix de Metropolis et Vampyr s'annulent (comme ceux des couvertures de l'été, consacrées à deux oeuvres audacieuses mais bancales) mais ensuite les films de Delvaux, Mankiewicz, Brooks et Kubrick surplombent ces Truffaut, Lubitsch et Buñuel-là. Ceux de Lewis, Rivette, Pollet et Demy suffiraient-ils à rétablir la balance, même sans parler du Rocha et du Mingozzi ? Allez, pour 1968 : Avantage Positif.
 A la fin des années 50, au moment même où, en France, la Nouvelle Vague commence à redistribuer les cartes, le Free Cinema britannique explose de l'autre côté du Channel. Moins formaliste et revendiquant moins fortement la pratique de la terre brûlée esthétique, le mouvement qui vit s'épanouir les oeuvres de Tony Richardson, Lindsay Anderson et Karel Reisz, est en revanche bien plus clairement combatif sur le plan social et politique, tournant essentiellement son regard vers les classes moyennes et ouvrières.
A la fin des années 50, au moment même où, en France, la Nouvelle Vague commence à redistribuer les cartes, le Free Cinema britannique explose de l'autre côté du Channel. Moins formaliste et revendiquant moins fortement la pratique de la terre brûlée esthétique, le mouvement qui vit s'épanouir les oeuvres de Tony Richardson, Lindsay Anderson et Karel Reisz, est en revanche bien plus clairement combatif sur le plan social et politique, tournant essentiellement son regard vers les classes moyennes et ouvrières. Une simple idée peut-elle suffire à faire tenir un film droit ? Parfois oui, comme c'est le cas avec Cloverfield. A Manhattan, Hud se retrouve avec une caméra numérique dans les mains, chargé de couvrir la fête donnée en l'honneur de son pote Rob. En pleine nuit, coupures de courant et explosions sément la pagaille aux alentours. Des monstres attaquent New York et Hud va filmer l'incroyable. Sur l'écran, nous ne verrons rien d'autre que le déroulement intégral de cet enregistrement.
Une simple idée peut-elle suffire à faire tenir un film droit ? Parfois oui, comme c'est le cas avec Cloverfield. A Manhattan, Hud se retrouve avec une caméra numérique dans les mains, chargé de couvrir la fête donnée en l'honneur de son pote Rob. En pleine nuit, coupures de courant et explosions sément la pagaille aux alentours. Des monstres attaquent New York et Hud va filmer l'incroyable. Sur l'écran, nous ne verrons rien d'autre que le déroulement intégral de cet enregistrement.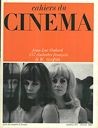
 1967 : L'évènement c'est, quinze ans après sa naissance, la parution réellement mensuelle de Positif, acquise pour de bon en février. Pour la revue, l'année s'ouvre sous les auspices de Richard Brooks mais l'évantail géographique se fait de plus en plus large : on trouve au fil des numéros des entretiens avec Miklos Jancso ou Ruy Guerra et les couvertures consacrent Nico Papatakis, Jan Nemec et Dusan Makavejev (avec la une la plus déshabillée de l'histoire de la revue jusque-là). Frédéric Vitoux et Patrick Rambaud écrivent quelques textes. Von Sternberg, Welles et Ford se croisent dans l'impressionnant sommaire du numéro de mars. On bataille ardemment pour Belle de jour alors que Blow-up divise la rédaction...
1967 : L'évènement c'est, quinze ans après sa naissance, la parution réellement mensuelle de Positif, acquise pour de bon en février. Pour la revue, l'année s'ouvre sous les auspices de Richard Brooks mais l'évantail géographique se fait de plus en plus large : on trouve au fil des numéros des entretiens avec Miklos Jancso ou Ruy Guerra et les couvertures consacrent Nico Papatakis, Jan Nemec et Dusan Makavejev (avec la une la plus déshabillée de l'histoire de la revue jusque-là). Frédéric Vitoux et Patrick Rambaud écrivent quelques textes. Von Sternberg, Welles et Ford se croisent dans l'impressionnant sommaire du numéro de mars. On bataille ardemment pour Belle de jour alors que Blow-up divise la rédaction...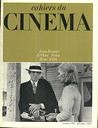
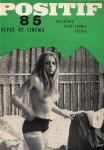 Quitte à choisir : L'équilibre numérique étant enfin atteint, c'est l'ouverture au monde qui pénalise cette fois-ci Positif. En effet, qui a vu à la fois le court-métrage de Borowczyk, Rosalie, Une affaire de coeur, Les martyrs de l'amour et Les pâtres du désordre ? Pas votre serviteur en tout cas. En revanche, du côté des Cahiers, l'ensemble des titres est bien connu. Donc, comme l'on retrouve Buñuel et Penn des deux côtés, il reste à jouer Polanski et Antonioni contre Demy, Bergman, Godard et Hawks. Allez, pour 1967 : Avantage Cahiers.
Quitte à choisir : L'équilibre numérique étant enfin atteint, c'est l'ouverture au monde qui pénalise cette fois-ci Positif. En effet, qui a vu à la fois le court-métrage de Borowczyk, Rosalie, Une affaire de coeur, Les martyrs de l'amour et Les pâtres du désordre ? Pas votre serviteur en tout cas. En revanche, du côté des Cahiers, l'ensemble des titres est bien connu. Donc, comme l'on retrouve Buñuel et Penn des deux côtés, il reste à jouer Polanski et Antonioni contre Demy, Bergman, Godard et Hawks. Allez, pour 1967 : Avantage Cahiers.



