(Robert Aldrich / Etats-Unis / 1955)
■■■□
 Cinéaste de l'excès et du grotesque, Robert Aldrich, quels que soient les sujets auxquels il s'attela au cours de sa longue carrière, n'avait pas pour habitude de faire dans la demie-mesure. En filmant en 1955 Le grand couteau (The big knife), basé sur l'adaptation que fit James Poe d'une pièce de Clifford Odets, il s'attaque au mirage hollywoodien, alors toujours entraîné dans les remous du Maccarthysme. Le regard qu'Aldrich porte sur le monde du cinéma est particulièrement acide. Les rapports entre les gens du spectacle semblent n'obéir qu'à des régles d'allégeance et de services rendus aux plus puissants en échange d'une protection financière. Cette micro-société a tout d'une structure à caractère mafieux. La mise en scène se charge de valider ce parallèle. Le premier face-à-face entre l'acteur réticent Charles Castle et son producteur Stanley Hoff se pare de tous les atours du polar et l'élément scénaristique déclencheur de la crise finale achève de déplacer le récit à la lisière du genre criminel.
Cinéaste de l'excès et du grotesque, Robert Aldrich, quels que soient les sujets auxquels il s'attela au cours de sa longue carrière, n'avait pas pour habitude de faire dans la demie-mesure. En filmant en 1955 Le grand couteau (The big knife), basé sur l'adaptation que fit James Poe d'une pièce de Clifford Odets, il s'attaque au mirage hollywoodien, alors toujours entraîné dans les remous du Maccarthysme. Le regard qu'Aldrich porte sur le monde du cinéma est particulièrement acide. Les rapports entre les gens du spectacle semblent n'obéir qu'à des régles d'allégeance et de services rendus aux plus puissants en échange d'une protection financière. Cette micro-société a tout d'une structure à caractère mafieux. La mise en scène se charge de valider ce parallèle. Le premier face-à-face entre l'acteur réticent Charles Castle et son producteur Stanley Hoff se pare de tous les atours du polar et l'élément scénaristique déclencheur de la crise finale achève de déplacer le récit à la lisière du genre criminel.
Le héros du Grand couteau, la star Charles Castle, est un acteur encore très populaire mais fatigué de ne se voir confier que des rôles sans consistance dans des productions purement commerciales, lui qui rêvait quelques années plus tôt d'ébranler le système en accompagnant de nouveaux artistes tels Huston, Wilder, Kazan, Mankiewicz (cités nommément). L'homme droit et idéaliste, au grand désespoir de sa femme, est devenu un professionnel docile, prêt à prolonger un contrat d'exclusivité avec son monstrueux producteur qui finirait de l'enterrer artistiquement. A force de compromissions, Charles Castle a franchi un à un les différents cercles de l'enfer et le récit consistera à laisser venir tous les démons à sa porte. Il doit ainsi se confronter successivement à la mégère journaliste, à son producteur, à l'homme d'affaire sans scrupules de ce dernier, à la femme aguicheuse de son agent, à la starlette risquant la réputation du studio. Tous le tentent une dernière fois, éprouvant le peu de moralité qui lui reste. Castle, portant bien son nom, est absolument cerné de toutes parts dans sa villa, ces diables ayant la faculté de débouler à n'importe quel moment et de n'importe où (de l'entrée principale, où personne ne s'annonce jamais, de l'escalier tombant de l'étage, de la baie vitrée donnant sur le jardin).
Jack Palance campe ce personnage piégé tel un félin blessé, capable de bondir brusquement vers ses agresseurs (la caméra d'Aldrich s'élevant alors, afin de faire apprécier l'explosivité de la réplique). Tendu, nerveux, il saisit le moindre objet à sa portée, à la recherche d'un apaisement impossible. Ses proches se chargent parfois de le contenir : son entraîneur personnel ne cesse de le toucher, comme l'on caresse un animal (moments extrêmement physiques, chargés d'ambiguïté mais aussi faisant resentir une certaine infantilisation). Constamment à fleur de peau, Palance n'a aucun mal à jouer, avec la même justesse et la même intensité, la sobriété et l'ivresse.
Instables, les personnages du Grand couteau semblent toutefois taillés d'un seul bloc, représentant certaines catégories de caractères, et il s'agit moins d'observer leur évolution que leur effritement. La conduite du récit, qui garde effrontément sa structure (et son cadre) théâtrale, se fait en proposant une série de choix, parfois jusqu'au manichéisme. Cependant, un réel approfondissement naît de cette succession de nouveaux dilemmes qui donnent parfois l'impression d'oblitérer les précédents : signer un contrat ou pas, tromper sa femme ou pas, résister ou pas, accepter un arrangement ou pas, être honnête avec soi ou pas. Ce surplus dramatique, Aldrich l'accompagne à sa façon, très directe et très expressive visuellement. L'exacerbation des affects par la mise en scène fait penser plus d'une fois au cinéma d'Elia Kazan. Deux autres caractéristiques poussent également à la comparaison : l'origine théâtrale de l'argument et le jeu des acteurs. Celui de Rod Steiger semble mimer celui de Brando. Dans la peau du producteur Hoff, peroxydé, affublé d'une oreillette et de lunettes noires, il va et vient entre l'émotion brute et un au-delà du cabotinage, tout cela s'accordant finalement assez bien avec le style d'Aldrich (et pouvant toujours se justifier dans ce monde en perpétuelle représentation qu'est Hollywood).
La violence s'accompagne donc d'une volonté satirique certaine, dont la musique prend une bonne part. La partition de Frank De Vol se fait commentaire musical plutôt qu'illustration. Le thème lié aux apparitions de Stanley Hoff est militaire et une conversation très tendue peut se trouver finalement désamorcée par une boutade accompagnée de quelques notes guillerettes. La brièveté de ces instants musicaux, soulignant quelques moments forts, laisse peu de doute sur le second degré visé. L'ultime envolée elle-même semble jouer un double-jeu, celui de l'émotion devant les larmes versées et celui du détachement face à ces personnages abandonnés dans leur souricière.
On peut assurément préférer d'autres Aldrich à celui-ci, coincé qu'il est entre le ravageur En quatrième vitesse et le puissant Attaque ! (où l'on retrouvera cet hallucinant Jack Palance). Son rythme est plus lent, les dialogues y sont abondants. S'y affirme toutefois l'assurance et la vigueur d'un style peu enclin aux bonnes manières.
(Chronique dvd pour Kinok)
 Étranges étrangers est au centre de la nouvelle livraison de la collection "Histoire d'un film, mémoire d'une lutte", dirigée par Tangui Perron pour Scope Editions et Périphérie, centre de création cinématographique. Après un premier livre-dvd qui s'appuyait sur le film de Jean-Pierre Thorn, Le dos au mur, ce deuxième numéro confirme que nous tenons là l'une des initiatives éditoriales les plus passionnantes de ces dernières années, redonnant vie à des oeuvres cinématographiques militantes rares et les accompagnant d'une documentation extrèmement riche et instructive.
Étranges étrangers est au centre de la nouvelle livraison de la collection "Histoire d'un film, mémoire d'une lutte", dirigée par Tangui Perron pour Scope Editions et Périphérie, centre de création cinématographique. Après un premier livre-dvd qui s'appuyait sur le film de Jean-Pierre Thorn, Le dos au mur, ce deuxième numéro confirme que nous tenons là l'une des initiatives éditoriales les plus passionnantes de ces dernières années, redonnant vie à des oeuvres cinématographiques militantes rares et les accompagnant d'une documentation extrèmement riche et instructive.







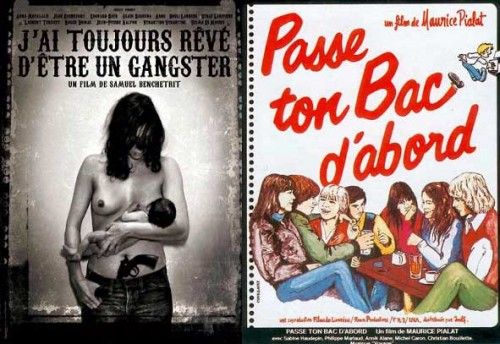




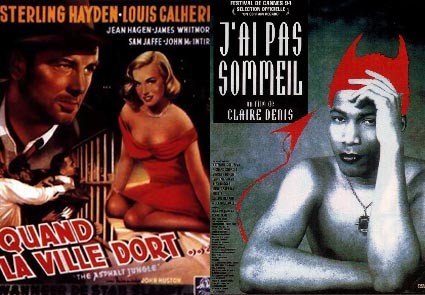





 Whatever works commence avec l'interpellation du spectateur par le personnage principal, Boris Yellnikoff. Cette apostrophe est déstabilisante tout d'abord par l'indécision du degré de distanciation qui la caractérise : débarquant au milieu d'une conversation entre amis, nous croyons bien déceler deux ou trois coups d'oeil de l'un des protagonistes vers la caméra avant que celui-ci s'adresse à nous directement, à la surprise de ses compagnons, qui continuent tout de même, tous comme les passants, à vivre leur vie de fiction.
Whatever works commence avec l'interpellation du spectateur par le personnage principal, Boris Yellnikoff. Cette apostrophe est déstabilisante tout d'abord par l'indécision du degré de distanciation qui la caractérise : débarquant au milieu d'une conversation entre amis, nous croyons bien déceler deux ou trois coups d'oeil de l'un des protagonistes vers la caméra avant que celui-ci s'adresse à nous directement, à la surprise de ses compagnons, qui continuent tout de même, tous comme les passants, à vivre leur vie de fiction. En revoyant le King Kong de Schoedsack et Cooper, frappe d'abord l'évidence d'un coup de génie des auteurs, celui d'avoir voulu faire de leur grand film d'aventure, un film qui réfléchit en même temps sur le pouvoir extraordinaire du cinéma. Grâce au choix initial du scénario de lancer l'expédition sous le prétexte d'un tournage exotique, nombre de séquences acquièrent par la suite une toute autre dimension. L'essai filmé que Carl Denham demande à son actrice Ann Darrow, sur le pont du navire en route pour Skull Island, consiste à la faire crier et à enregistrer son effroi. Celui-ci inquiète par anticipation Jack Driscoll, compagnon bientôt amoureux de la belle. A travers cette scène, le spectateur, lui, perçoit bien plus que cela : l'affirmation que de l'artifice pourra naître l'émotion.
En revoyant le King Kong de Schoedsack et Cooper, frappe d'abord l'évidence d'un coup de génie des auteurs, celui d'avoir voulu faire de leur grand film d'aventure, un film qui réfléchit en même temps sur le pouvoir extraordinaire du cinéma. Grâce au choix initial du scénario de lancer l'expédition sous le prétexte d'un tournage exotique, nombre de séquences acquièrent par la suite une toute autre dimension. L'essai filmé que Carl Denham demande à son actrice Ann Darrow, sur le pont du navire en route pour Skull Island, consiste à la faire crier et à enregistrer son effroi. Celui-ci inquiète par anticipation Jack Driscoll, compagnon bientôt amoureux de la belle. A travers cette scène, le spectateur, lui, perçoit bien plus que cela : l'affirmation que de l'artifice pourra naître l'émotion. Rééditer l'exploit à la faveur d'une suite rapidement mise en chantier (pour une sortie en salles seulement neuf mois après le premier) était une gageure impossible à tenir. Certaines des beautés de King Kong, telles que la charge érotique et la libération de l'imaginaire sont tellement volatiles que l'on peut considérer qu'elles ont échappé aux auteurs. Fatalement, Le fils de Kong (The son of Kong) est loin d'être porteur de la même fascination. Beaucoup plus court (65 minutes), il est bâti en deux parties distinctes et très inégales.
Rééditer l'exploit à la faveur d'une suite rapidement mise en chantier (pour une sortie en salles seulement neuf mois après le premier) était une gageure impossible à tenir. Certaines des beautés de King Kong, telles que la charge érotique et la libération de l'imaginaire sont tellement volatiles que l'on peut considérer qu'elles ont échappé aux auteurs. Fatalement, Le fils de Kong (The son of Kong) est loin d'être porteur de la même fascination. Beaucoup plus court (65 minutes), il est bâti en deux parties distinctes et très inégales. Nouvelle variation, seize ans plus tard. Joe est un gorille géant vivant depuis sa naissance près de Jill, aujourd'hui une jeune femme héritière du domaine africain de son père. Max O'Hara (interprété, comme le personnage de Carl Denham, par Robert Armstrong), un entrepreneur de spectacle américain, finit par les rencontrer et faire signer un contrat à Jill afin de produire Joe dans son nouveau night-club new yorkais.
Nouvelle variation, seize ans plus tard. Joe est un gorille géant vivant depuis sa naissance près de Jill, aujourd'hui une jeune femme héritière du domaine africain de son père. Max O'Hara (interprété, comme le personnage de Carl Denham, par Robert Armstrong), un entrepreneur de spectacle américain, finit par les rencontrer et faire signer un contrat à Jill afin de produire Joe dans son nouveau night-club new yorkais.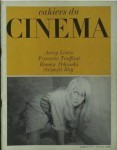
 1966 : Dans la deuxième moitié des années 60, le soutien apporté au "Nouveau Cinéma" venant des quatre coins du monde tend à faire converger les lignes des deux revues. Elles se retrouvent notamment dans la présentation et la défense de Milos Forman, de Marco Bellocchio, de Vera Chytilova, de Dusan Makavejev, d'Andreï Kontchalovski ou de Glauber Rocha (ces cinéastes entraînant progressivement les rédacteurs des Cahiers vers la politique). Le combat contre la censure dont est victime Rivette et sa Religieuse est également commun (Positif, plus aguerri sur ce terrain-là, réagissant plus rapidement). Le temps est donc à la détente.
1966 : Dans la deuxième moitié des années 60, le soutien apporté au "Nouveau Cinéma" venant des quatre coins du monde tend à faire converger les lignes des deux revues. Elles se retrouvent notamment dans la présentation et la défense de Milos Forman, de Marco Bellocchio, de Vera Chytilova, de Dusan Makavejev, d'Andreï Kontchalovski ou de Glauber Rocha (ces cinéastes entraînant progressivement les rédacteurs des Cahiers vers la politique). Le combat contre la censure dont est victime Rivette et sa Religieuse est également commun (Positif, plus aguerri sur ce terrain-là, réagissant plus rapidement). Le temps est donc à la détente.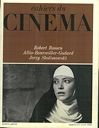
 Quitte à choisir : Les films de Welles et de Hawks m'étant inconnus, je dirai qu'une bonne moitié des couvertures Cahiers est indiscutable (Polanski, Rivette, Mankiewicz, Godard, Hitchcock, Bresson), à côté d'un intéressant Arthur Penn et d'un mauvais Truffaut. En face, je ne peux juger ni du Rocha, ni du Wajda. Le reste est impeccable mais insuffisant, le rythme de parution souffrant toujours de quelques "trous". L'année suivante, ça changera enfin. Allez, pour 1966 : Avantage Cahiers.
Quitte à choisir : Les films de Welles et de Hawks m'étant inconnus, je dirai qu'une bonne moitié des couvertures Cahiers est indiscutable (Polanski, Rivette, Mankiewicz, Godard, Hitchcock, Bresson), à côté d'un intéressant Arthur Penn et d'un mauvais Truffaut. En face, je ne peux juger ni du Rocha, ni du Wajda. Le reste est impeccable mais insuffisant, le rythme de parution souffrant toujours de quelques "trous". L'année suivante, ça changera enfin. Allez, pour 1966 : Avantage Cahiers. Le jeune ado que j'étais pu aller voir une petite poignée de films familiaux : Signé Lassiter (de Roger Young, avec Tom "Magnum" Selleck en Arsène Lupin au pays des Nazis) me laissa relativement indifférent tandis que Roar, probablement pas meilleur, me séduisit un peu plus (un film de Noel Marshall où, pour moi, les stars étaient les dizaines de fauves que l'on y croisait, plutôt que les inconnues Tippi Hedren et sa fille Melanie (Griffith)). Toutefois, sur le moment, l'expérience la plus emballante fut incontestablement la découverte d'un drôle de film d'aventures signé par un protégé de Spielberg, Robert Zemeckis : A la poursuite du diamant vert. Gros succès en salles (relativement inattendu, semble-t-il me rappeler, malgré sa "recette") puis à la télévision pendant de longues années, il reste peut-être encore aujourd'hui fréquentable, son auteur ayant par la suite assez vite prouvé qu'il était un peu plus qu'un sous-Steven S.
Le jeune ado que j'étais pu aller voir une petite poignée de films familiaux : Signé Lassiter (de Roger Young, avec Tom "Magnum" Selleck en Arsène Lupin au pays des Nazis) me laissa relativement indifférent tandis que Roar, probablement pas meilleur, me séduisit un peu plus (un film de Noel Marshall où, pour moi, les stars étaient les dizaines de fauves que l'on y croisait, plutôt que les inconnues Tippi Hedren et sa fille Melanie (Griffith)). Toutefois, sur le moment, l'expérience la plus emballante fut incontestablement la découverte d'un drôle de film d'aventures signé par un protégé de Spielberg, Robert Zemeckis : A la poursuite du diamant vert. Gros succès en salles (relativement inattendu, semble-t-il me rappeler, malgré sa "recette") puis à la télévision pendant de longues années, il reste peut-être encore aujourd'hui fréquentable, son auteur ayant par la suite assez vite prouvé qu'il était un peu plus qu'un sous-Steven S. Vu d'ici et aujourd'hui, dans la liste de l'été 84, que regrette-t-on de ne pas encore connaître ? En premier lieu, Les années déclic, l'autoportrait de Raymond Depardon, sorti en catimini à l'époque et encore peu diffusé de nos jours. Ensuite, le remake, apparemment pas déshonorant, de L'homme qui aimait les femmes de Truffaut par Blake Edwards : L'homme à femmes (campé par Burt Reynolds). Enfin, malgré le peu d'enthousiasme réel qu'ont pu susciter chez moi les quelques films que j'ai pu voir d'Abel Ferrara (hormis Nos funérailles) : New York, deux heures du matin, l'un de ses polars poisseux s'étant taillé une petite réputation.
Vu d'ici et aujourd'hui, dans la liste de l'été 84, que regrette-t-on de ne pas encore connaître ? En premier lieu, Les années déclic, l'autoportrait de Raymond Depardon, sorti en catimini à l'époque et encore peu diffusé de nos jours. Ensuite, le remake, apparemment pas déshonorant, de L'homme qui aimait les femmes de Truffaut par Blake Edwards : L'homme à femmes (campé par Burt Reynolds). Enfin, malgré le peu d'enthousiasme réel qu'ont pu susciter chez moi les quelques films que j'ai pu voir d'Abel Ferrara (hormis Nos funérailles) : New York, deux heures du matin, l'un de ses polars poisseux s'étant taillé une petite réputation. Un second wagon fait un peu peur : Bingo Bongo (conte pour enfants autour d'un homme-singe, signé Pascale Festa-Campanile, avec Carole Bouquet), La nuit des loups (film de bande ouest-allemand de Rüdiger Nüchtern), Le challenger (film de David Fischer, sorti du fond du tiroir suite à la starification coppolesque de Matt Dillon), C'est dans la poche (une comédie de Daniel Mann sur un ex-champion de boxe et un kangourou, avec Elliot Gould et Robert Mitchum !), Tonnerre (Larry Ludman), Le gang des BMX (film d'aventures familial à l'Australienne, signé Brian Trenchard-Smith, avec notamment une certaine Nicole Kidman), Règlement de compte (de Paul Aaron, pas de Fritz Lang), Les maîtres du soleil (SF française de Jean-Jacques Aublanc), Le sang du dragon (polar hongkongais de Jimmy Tseng), Le palace en délire (Neel Israel).
Un second wagon fait un peu peur : Bingo Bongo (conte pour enfants autour d'un homme-singe, signé Pascale Festa-Campanile, avec Carole Bouquet), La nuit des loups (film de bande ouest-allemand de Rüdiger Nüchtern), Le challenger (film de David Fischer, sorti du fond du tiroir suite à la starification coppolesque de Matt Dillon), C'est dans la poche (une comédie de Daniel Mann sur un ex-champion de boxe et un kangourou, avec Elliot Gould et Robert Mitchum !), Tonnerre (Larry Ludman), Le gang des BMX (film d'aventures familial à l'Australienne, signé Brian Trenchard-Smith, avec notamment une certaine Nicole Kidman), Règlement de compte (de Paul Aaron, pas de Fritz Lang), Les maîtres du soleil (SF française de Jean-Jacques Aublanc), Le sang du dragon (polar hongkongais de Jimmy Tseng), Le palace en délire (Neel Israel).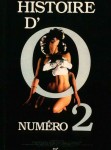 En se tournant vers les productions érotiques soft, mis à part le Carmen cité plus avant, on ne tombe que sur des propositions peu engageantes : Où sont les hommes ? (espagnol de Ignacio F. Iquino) et Histoire d'O, chapitre 2 (Eric Rochat). Tant qu'à faire, autant choisir Sodopartouzes clandestines (de "Joanna Morgan") ou Pénétrations multiples (de "Mike Strong"), sans doute moins décevants par rapport à ce que l'on en attend.
En se tournant vers les productions érotiques soft, mis à part le Carmen cité plus avant, on ne tombe que sur des propositions peu engageantes : Où sont les hommes ? (espagnol de Ignacio F. Iquino) et Histoire d'O, chapitre 2 (Eric Rochat). Tant qu'à faire, autant choisir Sodopartouzes clandestines (de "Joanna Morgan") ou Pénétrations multiples (de "Mike Strong"), sans doute moins décevants par rapport à ce que l'on en attend. Sur la plage, nous pouvions lire dans Cinématographe (n°102) un dossier sur le casting (avec Lambert Wilson en couverture, dans La femme publique) et dans Première (88) une interview de Catherine Deneuve qui "tourne à Montréal Paroles et musique". Starfix (17) piaffait d'impatience en attendant Indiana Jones et le temple maudit. La revue du Cinéma (396) anticipait également sur les films de la rentrée et Au-dessous du volcan de Huston. Positif (281-282) et Cinéma 84 (307-308) choisissaient la même une : Le succès à tout prix (le film de Skolimowski sorti sur les écrans en mai). Les Cahiers, eux, font relâche. Enfin, deux revues ont été jusque là scandaleusement oubliées par mes services et nous y remédions enfin : L'Écran Fantastique (47) revenait sur Le Bounty et Mel Gibson alors que Jeune Cinéma (160) rendait compte, comme la majorité des publications estivales, du festival de Cannes et mettait en couverture Henri IV de Marco Bellocchio.
Sur la plage, nous pouvions lire dans Cinématographe (n°102) un dossier sur le casting (avec Lambert Wilson en couverture, dans La femme publique) et dans Première (88) une interview de Catherine Deneuve qui "tourne à Montréal Paroles et musique". Starfix (17) piaffait d'impatience en attendant Indiana Jones et le temple maudit. La revue du Cinéma (396) anticipait également sur les films de la rentrée et Au-dessous du volcan de Huston. Positif (281-282) et Cinéma 84 (307-308) choisissaient la même une : Le succès à tout prix (le film de Skolimowski sorti sur les écrans en mai). Les Cahiers, eux, font relâche. Enfin, deux revues ont été jusque là scandaleusement oubliées par mes services et nous y remédions enfin : L'Écran Fantastique (47) revenait sur Le Bounty et Mel Gibson alors que Jeune Cinéma (160) rendait compte, comme la majorité des publications estivales, du festival de Cannes et mettait en couverture Henri IV de Marco Bellocchio.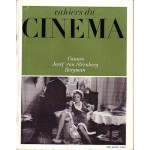
 1965 : Positif, sur trois numéros, prolonge les réflexions autour du Désert rouge entamées fin 1964 par les Cahiers. Robert Benayoun poursuit ses rencontres hollywoodiennes avec Jerry Lewis, Frank Tashlin, Sam Peckinpah, John Huston et Don Siegel. En mai, la maquette change et un nouvel auteur, Franceso Rosi, est adoubé par la revue. Bernard Cohn et Freddy Buache entrent au comité de rédaction.
1965 : Positif, sur trois numéros, prolonge les réflexions autour du Désert rouge entamées fin 1964 par les Cahiers. Robert Benayoun poursuit ses rencontres hollywoodiennes avec Jerry Lewis, Frank Tashlin, Sam Peckinpah, John Huston et Don Siegel. En mai, la maquette change et un nouvel auteur, Franceso Rosi, est adoubé par la revue. Bernard Cohn et Freddy Buache entrent au comité de rédaction.
 Quitte à choisir : Claudia Cardinale illumine le mois de décembre des deux côtés. Ce sont donc trois Italiens qui sont à l'origine des couvertures de Positif les plus remarquables : Antonioni, Rosi et Visconti. Mais Godard et les anciens (Sternberg, Lang), se chargent de placer les Cahiers en pole position. Allez, pour 1965 : Avantage Cahiers.
Quitte à choisir : Claudia Cardinale illumine le mois de décembre des deux côtés. Ce sont donc trois Italiens qui sont à l'origine des couvertures de Positif les plus remarquables : Antonioni, Rosi et Visconti. Mais Godard et les anciens (Sternberg, Lang), se chargent de placer les Cahiers en pole position. Allez, pour 1965 : Avantage Cahiers.
 C'est au dernier moment que je me suis aperçu que le film d'Emmanuel Mouret diffusé par Arte hier soir n'était pas
C'est au dernier moment que je me suis aperçu que le film d'Emmanuel Mouret diffusé par Arte hier soir n'était pas