(Emmanuel Mouret / France / 2006)
■■□□
 C'est au dernier moment que je me suis aperçu que le film d'Emmanuel Mouret diffusé par Arte hier soir n'était pas celui que je connaissais déjà, contrairement à ce que me laissa croire l'autre jour le survol trop rapide de mon programme télévisé. Si ce n'est pas là une preuve que notre homme fait toujours le même film...
C'est au dernier moment que je me suis aperçu que le film d'Emmanuel Mouret diffusé par Arte hier soir n'était pas celui que je connaissais déjà, contrairement à ce que me laissa croire l'autre jour le survol trop rapide de mon programme télévisé. Si ce n'est pas là une preuve que notre homme fait toujours le même film...
Changement d'adresse est une comédie, plaisante plutôt qu'hilarante, auscultant les problèmes de coeur de deux co-locataires, Anne et David, qui tentent de se persuader mutuellement qu'une promiscuité amicale et sans arrière-pensée est possible entre deux jeunes personnes à la recherche de l'amour. Le scénario avance à coups de quiproquos et de malentendus sentimentaux, s'ingéniant à faire battre les coeurs sur des rythmes trop différents pour qu'ils s'accordent avant longtemps. Si quelques intermèdes burlesques trouvent leur place, l'humour passe essentiellement par la parole : opposition entre les registres (logorhée verbale, mutisme, assurance de tombeur, bafouillages), jeu autour du double sens de certains mots (un cor / un corps), propos extravagants tenus avec le plus grand naturel ou, au contraire, analyses interminables de choses pourtant très simples...
Emmanuel Mouret filme avec une élégance et un calme "à l'ancienne" qui peuvent ressembler parfois à un refus d'être de son temps. Cette assurance séduit le plus souvent mais peut aussi laisser indifférent à l'occasion (les guillerettes transitions musicales par exemple).
Du point de vue narratif, l'histoire se déroule de façon si mécanique qu'elle pourrait quasiment se réduire à une formule mathématique. Les efforts de Mouret portent alors sur l'injection de contretemps imprévisibles chargés de maintenir l'intérêt de cette série de combinaisons programmées. Il n'y parvient pas toujours. Ainsi, l'irruption du personnage de Julien semble d'abord provoquer un bouleversement bénéfique au récit, par son refus de suivre les règles tacites établies par les principaux protagonistes jusque là. Malheureusement, il finit par entrer lui aussi dans la ronde. La pièce rapportée s'emboîte trop facilement.
Le registre comique et les ressorts dramatiques seront donc repris à l'identique dans le film suivant de Mouret, Un baiser s'il vous plaît. Même charme et mêmes limites : l'impression de ne pas avoir avancé d'un pouce est tenace. Le tout récent Fais-moi plaisir tiendra-t-il la promesse de son titre en ouvrant sur d'autres horizons ?
 [Seconde contribution personnelle au
[Seconde contribution personnelle au 

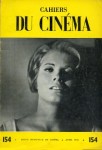
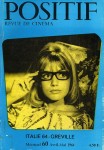 1964 : Comme l'année précédente, les livraisons de Positif se font plutôt thématiques : comédie à l'italienne, cinéma américain (classique ou indépendant) et bien sûr l'irrésistible numéro spécial consacré à l'érotisme. Robert Benayoun parle avec Roger Corman et Buñuel est une nouvelle fois à la fête.
1964 : Comme l'année précédente, les livraisons de Positif se font plutôt thématiques : comédie à l'italienne, cinéma américain (classique ou indépendant) et bien sûr l'irrésistible numéro spécial consacré à l'érotisme. Robert Benayoun parle avec Roger Corman et Buñuel est une nouvelle fois à la fête.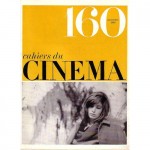
 Quitte à choisir : Joker pour le Roger Corman, mais l'année de Positif ressemble à un sans-faute. Cependant, la faiblesse quantitative biaise une nouvelle fois la confrontation. Demy, Bergman, (Godard ?), Mizoguchi, Antonioni (partagé avec la concurrence qui l'affichera en janvier 65) : à part les interrogations sur David et Lisa et La bataille de France, en face, c'est aussi du solide. Allez, pour 1964 : Match nul.
Quitte à choisir : Joker pour le Roger Corman, mais l'année de Positif ressemble à un sans-faute. Cependant, la faiblesse quantitative biaise une nouvelle fois la confrontation. Demy, Bergman, (Godard ?), Mizoguchi, Antonioni (partagé avec la concurrence qui l'affichera en janvier 65) : à part les interrogations sur David et Lisa et La bataille de France, en face, c'est aussi du solide. Allez, pour 1964 : Match nul. Le parcours du jeune couple Hans-Lammchen dans l'Allemagne en crise du début des années 30, leurs difficultés financières, leurs rencontres, le frottement de leur idéalisme au contact d'une société en quête de repères, la fortification de leur amour et le maintien de leur volonté combative...
Le parcours du jeune couple Hans-Lammchen dans l'Allemagne en crise du début des années 30, leurs difficultés financières, leurs rencontres, le frottement de leur idéalisme au contact d'une société en quête de repères, la fortification de leur amour et le maintien de leur volonté combative...
 1963 : Howard Hawks a enfin son dossier et sa couverture des Cahiers. Mais pour la revue, le bouleversement se réalise en interne : Rohmer est poussé vers la sortie et un comité de rédaction (officieusement dirigé par Jacques Rivette) prend les commandes. Un éditorial présente la chose en juillet. La ligne tendra désormais vers le cinéma moderne (principalement européen) plutôt que vers les grands classiques (essentiellement hollywoodiens). Les pages des Cahiers s'ouvriront aussi à d'autres disciplines : ainsi, un entretien avec Roland Barthes parait dans le n°147.
1963 : Howard Hawks a enfin son dossier et sa couverture des Cahiers. Mais pour la revue, le bouleversement se réalise en interne : Rohmer est poussé vers la sortie et un comité de rédaction (officieusement dirigé par Jacques Rivette) prend les commandes. Un éditorial présente la chose en juillet. La ligne tendra désormais vers le cinéma moderne (principalement européen) plutôt que vers les grands classiques (essentiellement hollywoodiens). Les pages des Cahiers s'ouvriront aussi à d'autres disciplines : ainsi, un entretien avec Roland Barthes parait dans le n°147.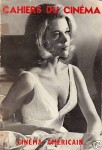
 Quitte à choisir : Le déséquilibre toujours flagrant dans le nombre de numéros parus profite encore une fois aux Cahiers (en premier lieu : Les oiseaux, Le feu follet, Muriel, Main basse sur la ville), même si Positif ne démérite pas (Jerry Lewis et Tony Richardson). Allez, pour 1963 : Avantage Cahiers.
Quitte à choisir : Le déséquilibre toujours flagrant dans le nombre de numéros parus profite encore une fois aux Cahiers (en premier lieu : Les oiseaux, Le feu follet, Muriel, Main basse sur la ville), même si Positif ne démérite pas (Jerry Lewis et Tony Richardson). Allez, pour 1963 : Avantage Cahiers. Un mélodrame de Borzage assez mauvais, qui fait illusion pendant une quarantaine de minutes avant de sombrer vers les limites du supportable. Bien sûr, nous ne croyons pas une seule seconde à cette histoire, celle de Myra, jeune femme élevée à la campagne par son père, autrefois pianiste célèbre en Europe, et qui devient la protégée du Maestro Goronof avant de lui faire de l'ombre sur la prestigieuse scène du Carnegie Hall. Toutefois, les péripéties du début s'enchaînent avec suffisamment d'assurance et la caractérisation des personnages oscille assez plaisamment entre stéréotypes et touches plus originales. Surtout, Borzage laisse toute sa place à la musique : le chemin balisé qui nous mène de l'audition au premier concert, en passant par les nombreuses répétitions, grâce sans doute à la sensibilité du cinéaste, évite les raccourcis et les escamotages habituels.
Un mélodrame de Borzage assez mauvais, qui fait illusion pendant une quarantaine de minutes avant de sombrer vers les limites du supportable. Bien sûr, nous ne croyons pas une seule seconde à cette histoire, celle de Myra, jeune femme élevée à la campagne par son père, autrefois pianiste célèbre en Europe, et qui devient la protégée du Maestro Goronof avant de lui faire de l'ombre sur la prestigieuse scène du Carnegie Hall. Toutefois, les péripéties du début s'enchaînent avec suffisamment d'assurance et la caractérisation des personnages oscille assez plaisamment entre stéréotypes et touches plus originales. Surtout, Borzage laisse toute sa place à la musique : le chemin balisé qui nous mène de l'audition au premier concert, en passant par les nombreuses répétitions, grâce sans doute à la sensibilité du cinéaste, évite les raccourcis et les escamotages habituels.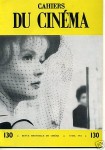

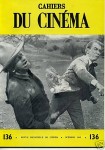
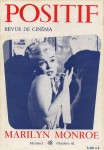
 L'histoire de la production des Visiteurs (The visitors) est relativement connue. En ce début de décennie 70, Elia Kazan se remet difficilement des échecs publics successifs d'America America (1963) et de L'arrangement (1969), deux de ses films les plus personnels et les plus ambitieux. Il décide alors de se lancer dans une aventure plus modeste, s'appuyant sur un scénario de son fils Chris, tournant en 16 mm avec une équipe réduite dans sa propriété du Connecticut et engageant des interprètes peu expérimentés, dont le jeune James Woods. A cette nouvelle approche, il est d'autant mieux préparé qu'il est marié à l'époque à Barbara Loden, actrice et réalisatrice d'un unique long-métrage, Wanda (1970), titre mythique du cinéma indépendant américain.
L'histoire de la production des Visiteurs (The visitors) est relativement connue. En ce début de décennie 70, Elia Kazan se remet difficilement des échecs publics successifs d'America America (1963) et de L'arrangement (1969), deux de ses films les plus personnels et les plus ambitieux. Il décide alors de se lancer dans une aventure plus modeste, s'appuyant sur un scénario de son fils Chris, tournant en 16 mm avec une équipe réduite dans sa propriété du Connecticut et engageant des interprètes peu expérimentés, dont le jeune James Woods. A cette nouvelle approche, il est d'autant mieux préparé qu'il est marié à l'époque à Barbara Loden, actrice et réalisatrice d'un unique long-métrage, Wanda (1970), titre mythique du cinéma indépendant américain.