(Francisco Fordo Coppolacini / Etats-Unis - Italie - Espagne - Argentine / 2009)
■□□□
 Je n'avais jamais entendu parler de ce jeune cinéaste mais après avoir découvert son premier long-métrage, le dénommé Tetro, j'ai envie de saluer son audace malgré l'impression de ratage presque total que j'ai pu ressentir.
Je n'avais jamais entendu parler de ce jeune cinéaste mais après avoir découvert son premier long-métrage, le dénommé Tetro, j'ai envie de saluer son audace malgré l'impression de ratage presque total que j'ai pu ressentir.
Le bonhomme serait fraîchement diplomé de quelque école de cinéma que cela ne m'étonnerai guère. L'œuvre est en effet sur-référencée et convoque tous les arts possibles, le septième en premier. L'évocation d'un Powell-Pressburger (Les contes d'Hoffmann, dont on voit un extrait) sert à tisser l'un des fils du scénario et cette histoire d'une famille d'artistes torturés se prête à la mise en abîme et à la distanciation fassbinderienne du mélodrame. L'érotisation des corps, tant féminins que masculins, et la circulation d'un désir flottant entre les genres renvoient également au cinéaste allemand et donc, par ricochet, à Almodovar. Une représentation théâtrale nous transporte presque en pleine movida, pas seulement par les échanges en espagnol et l'apparition de Carmen Maura, mais aussi et surtout par le débraillé (certes lêché) de la mise en scène poussé jusqu'au n'importe quoi (Almodovar, donc, enfin... celui de l'époque Pepi, Luci, Bom...).
Notre débutant à choisi de traiter un sujet fort ambitieux, celui de la famille, en l'abordant par la face mélodramatique de la découverte du secret. Consciencieux, il nous gratifie donc, à peu près toutes les dix minutes (sachant qu'il y en a au total 127), d'une grosse révélation pour finir sur un ahurissant point d'orgue. Compte tenu de cela, on comprend que les personnages soient très tourmentés. Comme ils baignent dans l'art, ils dialoguent par formules, s'appliquant à trousser des phrases sonnant de manière définitive au mépris de la plus élémentaire crédibilité des échanges (mais me direz-vous peut-être : quelle poésie, quel mystère, quelle profondeur...).
Sans doute par manque de moyens, notre grand espoir a tourné en noir et blanc, à l'exception des séquences de flash-backs, cadrées en couleurs dans un format plus carré, se rapprochant (comme c'est bien vu !) de celui des home movies(apparaît alors le pourtant très peu latin Klaus Maria Brandauer dans le rôle du Maestro Tetrocini). Il faut dire que Monsieur sait travailler l'image et magnifier ses acteurs (Vincent Gallo est très... affecté... très Vincent Gallo quoi). En revanche, pour retranscrire l'ambiance de Buenos Aires, mettre du tango sur la bande-son et un couple pittoresque s'invectivant avec passion au bord du cadre, c'est un peu juste.
En fait notre jeunot a ranimé un genre délaissé : le film arty (et sexy). Devant le résultat obtenu, la nostalgie nous rattrape par le col (du blouson en cuir) et l'on repense à Rusty James et au Motorcycle Boy...
...Ah, excusez-moi, on m'interpelle... Comment ?... Qu'est-ce que vous dites ?... Non... Qui ça ? Coppola ?... Roman, alors... Non ? Vous en êtes sûr ?... Francis ?!?!... Oh putain !
 L'institution que Frederick Wiseman a décidé de radiographier cette fois-ci est l'Opéra de Paris. Il le fait en long, en large et en travers, filmant aussi bien le bureau de la directrice artistique que les ruches sur le toit du bâtiment ou le dédale des sous-sols. Toutefois, l'essentiel se passe bien sûr au cours des répétitions et des représentations.
L'institution que Frederick Wiseman a décidé de radiographier cette fois-ci est l'Opéra de Paris. Il le fait en long, en large et en travers, filmant aussi bien le bureau de la directrice artistique que les ruches sur le toit du bâtiment ou le dédale des sous-sols. Toutefois, l'essentiel se passe bien sûr au cours des répétitions et des représentations.
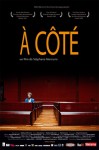
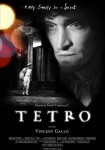
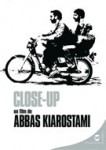
 Rien à redire sur le plan purement technique. Cars est un régal d'animation dans le rendu des matières, dans la fluidité des mouvements, dans l'homogénéité visuelle de l'ensemble des séquences et Lasseter sait parfaitement créer une dynamique narrative. La carrosserie est donc nickel et le moteur tourne impeccablement. Malheureusement, il n'y a rien ni personne dans l'habitacle.
Rien à redire sur le plan purement technique. Cars est un régal d'animation dans le rendu des matières, dans la fluidité des mouvements, dans l'homogénéité visuelle de l'ensemble des séquences et Lasseter sait parfaitement créer une dynamique narrative. La carrosserie est donc nickel et le moteur tourne impeccablement. Malheureusement, il n'y a rien ni personne dans l'habitacle.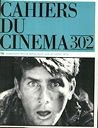
 1979 : Le numéro de l'été 79 des Cahiers du Cinéma est souvent désigné comme un point de rupture dans l'histoire de la revue. Le retour spectaculaire du cinéma américain (Apocalypse now en couverture et Coppola en entretien) marque pour les uns un nouveau départ salutaire après des années d'égarement intellectuel et pour les autres une capitulation devant la culture cinématographique de masse. Le début de l'année est placé sous le sceau du burlesque et de Toto et une table ronde est organisée à propos de L'homme de marbre de Wajda. Outre Godard, à qui l'on a confié la mise en œuvre du n°300, on croise, à la faveur d'entretiens, Jean-Claude Guiguet, Luc Moullet, Frederic Wiseman, Maurice Pialat, Roman Polanski, Raymond Depardon ou Jean Eustache. La signature de Charles Tesson apparaît et en mars, Serge Daney passe rédacteur en chef.
1979 : Le numéro de l'été 79 des Cahiers du Cinéma est souvent désigné comme un point de rupture dans l'histoire de la revue. Le retour spectaculaire du cinéma américain (Apocalypse now en couverture et Coppola en entretien) marque pour les uns un nouveau départ salutaire après des années d'égarement intellectuel et pour les autres une capitulation devant la culture cinématographique de masse. Le début de l'année est placé sous le sceau du burlesque et de Toto et une table ronde est organisée à propos de L'homme de marbre de Wajda. Outre Godard, à qui l'on a confié la mise en œuvre du n°300, on croise, à la faveur d'entretiens, Jean-Claude Guiguet, Luc Moullet, Frederic Wiseman, Maurice Pialat, Roman Polanski, Raymond Depardon ou Jean Eustache. La signature de Charles Tesson apparaît et en mars, Serge Daney passe rédacteur en chef.
 Quitte à choisir : La pertinence des retours vers le passé n'est guère contestable, d'un côté comme de l'autre (Ozu, Renoir, Tati, Ray, Stahl, Kurosawa). Pour ce qui est de l'actualité, autour du point central Coppola, on se satisfait à égalité des choix de Godard et Pialat et de Rosi et Cimino. Don Giovanni et La luna, bien qu'intéressants, ne m'avaient pas bouleversé mais il reste des propositions intrigantes de part et d'autre (Oliveira, Straub, Depardon, Skolimowski, Altman, Jancso). Equilibre parfait. Allez, pour 1979 : Match nul.
Quitte à choisir : La pertinence des retours vers le passé n'est guère contestable, d'un côté comme de l'autre (Ozu, Renoir, Tati, Ray, Stahl, Kurosawa). Pour ce qui est de l'actualité, autour du point central Coppola, on se satisfait à égalité des choix de Godard et Pialat et de Rosi et Cimino. Don Giovanni et La luna, bien qu'intéressants, ne m'avaient pas bouleversé mais il reste des propositions intrigantes de part et d'autre (Oliveira, Straub, Depardon, Skolimowski, Altman, Jancso). Equilibre parfait. Allez, pour 1979 : Match nul. A l'aide de sa petite caméra numérique, Alain Cavalier filme autour de lui tout ce qui peut évoquer Irène, sa compagne décédée il y a près de quarante de cela. Il cadre des objets, du mobilier, des pièces, des paysages susceptibles de se recharger de sa présence. Se situant à l'une des extrémités du spectre du cinéma, le film contient tout de même, en son centre, une sorte de morceau de bravoure (preuve qu'il y a bien, malgré les apparences, une dramaturgie) : le récit de ce terrible après-midi de janvier 1972, au cours duquel Alain Cavalier perdit sa femme. La séquence est bouleversante au point de nous faire dire qu'une telle chose, si proche de l'indicible, ne peut finalement être racontée et partagée que comme cela, en passant par une remémoration clinique des faits et des gestes dans les lieux inchangés du traumatisme. Cette déambulation dans un salon sous-éclairé et vide de toute présence humaine autre que celle du cinéaste derrière sa caméra dit tout de l'absence et traduit très précisément l'interrogation insoutenable et paralysante, la montée de l'angoisse et l'incompréhension.
A l'aide de sa petite caméra numérique, Alain Cavalier filme autour de lui tout ce qui peut évoquer Irène, sa compagne décédée il y a près de quarante de cela. Il cadre des objets, du mobilier, des pièces, des paysages susceptibles de se recharger de sa présence. Se situant à l'une des extrémités du spectre du cinéma, le film contient tout de même, en son centre, une sorte de morceau de bravoure (preuve qu'il y a bien, malgré les apparences, une dramaturgie) : le récit de ce terrible après-midi de janvier 1972, au cours duquel Alain Cavalier perdit sa femme. La séquence est bouleversante au point de nous faire dire qu'une telle chose, si proche de l'indicible, ne peut finalement être racontée et partagée que comme cela, en passant par une remémoration clinique des faits et des gestes dans les lieux inchangés du traumatisme. Cette déambulation dans un salon sous-éclairé et vide de toute présence humaine autre que celle du cinéaste derrière sa caméra dit tout de l'absence et traduit très précisément l'interrogation insoutenable et paralysante, la montée de l'angoisse et l'incompréhension. Retraçant l'histoire du "prisonnier le plus dangereux d'Angleterre", "ce film est basé sur des événements réels". Bien avant le terme des quatre-vingt dix minutes, on se dit pourtant que non seulement Nicolas Winding Refn a pris un malin plaisir à bousculer les règles du biopic traditionnel, mais qu'il a surtout réussi à éviscérer le genre, à le vider littéralement de sa morale, de son idéologie, de ses visées édifiantes. Le cinéaste danois n'est bien évidemment pas le premier à jouer au déconstructeur de biographie. En revanche, l'ironie féroce avec laquelle il recouvre le passage obligé des souvenirs d'enfance et d'adolescence démontre bien le peu de cas qu'il fait de la recherche d'un éclairage psychologique sur son héros. De plus, le véritable Michael Peterson, alias Bronson, est devenu une personnalité reconnue exposant ses œuvres dans les musées internationaux. Or, la dernière partie du film substitue à la découverte salvatrice et apaisante de l'art plastique un happening violent et absurde.
Retraçant l'histoire du "prisonnier le plus dangereux d'Angleterre", "ce film est basé sur des événements réels". Bien avant le terme des quatre-vingt dix minutes, on se dit pourtant que non seulement Nicolas Winding Refn a pris un malin plaisir à bousculer les règles du biopic traditionnel, mais qu'il a surtout réussi à éviscérer le genre, à le vider littéralement de sa morale, de son idéologie, de ses visées édifiantes. Le cinéaste danois n'est bien évidemment pas le premier à jouer au déconstructeur de biographie. En revanche, l'ironie féroce avec laquelle il recouvre le passage obligé des souvenirs d'enfance et d'adolescence démontre bien le peu de cas qu'il fait de la recherche d'un éclairage psychologique sur son héros. De plus, le véritable Michael Peterson, alias Bronson, est devenu une personnalité reconnue exposant ses œuvres dans les musées internationaux. Or, la dernière partie du film substitue à la découverte salvatrice et apaisante de l'art plastique un happening violent et absurde.

 Capitalism : a love story est bien sûr moins passionnant que les trois premiers documentaires de Michael Moore, il est même moins intéressant, du point de vue des tiraillements que provoquent les méthodes et les choix du cinéaste, que
Capitalism : a love story est bien sûr moins passionnant que les trois premiers documentaires de Michael Moore, il est même moins intéressant, du point de vue des tiraillements que provoquent les méthodes et les choix du cinéaste, que