(Park Chan-wook / Corée du Sud - Etats-Unis / 2009)
■■■□
 Le nouveau Park Chan-wook, Thirst, ceci est mon sang (Bakjwi), met en jeu divers composants supposés inconciliables : le fantastique et le quotidien, le prêtre et le vampire, le baiser et la morsure, le noir et le blanc, le jour et la nuit, le vivant et le mort. La grande beauté qui s'en dégage naît de la fusion, a priori inconcevable, réalisée entre chacun de ces termes opposés : le fantastique est le quotidien, le prêtre est le vampire... S'il est tentant d'utiliser l'expression de "mélange des genres", en faire usage ne me satisfait qu'à moitié. D'une part, elle ne dit rien de l'incroyable unité que Park parvient à trouver. D'autre part, elle peut faire croire que Thirst est une nouvelle consolidation du règne actuel du second degré au cinéma. Bien évidemment, le film ne manque pas, loin de là, d'humour (jusqu'au grotesque, voire au mauvais goût assumé) mais une bonne partie du public ne semble vouloir y trouver que du "fun", en riant tout autant aux éclats de violence qu'aux envolées vers le sublime.
Le nouveau Park Chan-wook, Thirst, ceci est mon sang (Bakjwi), met en jeu divers composants supposés inconciliables : le fantastique et le quotidien, le prêtre et le vampire, le baiser et la morsure, le noir et le blanc, le jour et la nuit, le vivant et le mort. La grande beauté qui s'en dégage naît de la fusion, a priori inconcevable, réalisée entre chacun de ces termes opposés : le fantastique est le quotidien, le prêtre est le vampire... S'il est tentant d'utiliser l'expression de "mélange des genres", en faire usage ne me satisfait qu'à moitié. D'une part, elle ne dit rien de l'incroyable unité que Park parvient à trouver. D'autre part, elle peut faire croire que Thirst est une nouvelle consolidation du règne actuel du second degré au cinéma. Bien évidemment, le film ne manque pas, loin de là, d'humour (jusqu'au grotesque, voire au mauvais goût assumé) mais une bonne partie du public ne semble vouloir y trouver que du "fun", en riant tout autant aux éclats de violence qu'aux envolées vers le sublime.
Sublime et triviale (encore une convergence inattendue) par exemple, la première scène d'amour entre Tae-joo et Sang-hyeon (soit la révélation Kim Ok-vin et le mieux connu Song Kang-ho, tous deux ici en état de grâce), au cours de laquelle ni les contretemps imposés, ni le rythme burlesque, ni l'abondance verbale de l'une, ni l'auto-flagellation de l'autre ne contiennent les vagues du désir (*). Après ce premier acte contrarié, une autre occasion permet aux personnages de se libérer totalement. Park filme cette deuxième étreinte très différemment : quasiment in extenso, de manière intense mais calme, sans aucune interférence extérieure, pour arriver à un même sentiment de fascination. Un plan montre la poitrine de Tae-joo en sueur, un autre la remontée du drap par Sang-Hyeon sur les épaules de sa partenaire. Deux plans conventionnels, mais deux plans qui sont prolongés par un geste simple et furtif, un détail génial : le drap sert à éponger les gouttes de sueur.
Chaque scène de Thirst repose sur au moins une idée de mise en scène, qui prend la couleur de l'inédit. Encore faut-il s'entendre sur le sens de ces mots. Je ne parle pas de truc technique ou d'un effet quelconque visant à en mettre plein la vue mais d'expressivité, de présence physique, de dynamisme, de variations de registres et de rythme, d'échos et de rappels (des détails peuvent paraître mal assurés ou anodins avant de rebondir deux ou trois séquences plus loin : le choix d'un matelas "aquatique" dans la chambre du mari, l'appel à un médecin face au mal-être de Tae-joo, l'anecdotique discussion à propos d'une date de naissance inconnue qui annonce une nouvelle naissance...). Je ne résiste pas à l'envie de mettre en regard, à ce sujet, deux positions antinomiques retranscrites dans les deux derniers numéros de Positif. Tout d'abord celle-ci : "Il faut qu'à chaque plan, il y ait une idée de dialogue ou visuelle, qu'il se passe un truc. (...) C'est vrai que les acteurs qui intériorisent n'ont pas de place dans mes films. Il faut que ce soit ludique". Puis celle-là : "Je ne suis pas sûr de savoir quel est le secret de la mise en scène. (...) Je m'angoisse parfois, j'ai peur que la mise en scène soit trop imposante et freine le rapport émotionnel entre les spectateurs et les personnages. J'essaie que tout se mette en place par rapport aux personnages, mais sans les dominer." La première est celle de Jean-Pierre Jeunet, la seconde, celle de Park Chan-wook. Ne cherchons pas plus loin la différence de qualité entre leurs derniers films en date.
Rarement soulignée, la qualité des dialogues de Thirst a aussi son importance. Ceux-ci sont impeccables jusque dans une drôlerie qui ne nous tire jamais la manche, qui ne les détache jamais de la réalité du film, bref, qui n'est jamais gratuite. Dans un autre registre, un mot, un consentement susurré par Tae-joo suffit à repousser l'ombre du jugement moral porté sur la femme manipulatrice. Sur le plan visuel, l'extraordinaire travail sur les décors autorise de qualifier Park Chan-wook de grand cinéaste expressionniste. L'appartement de la belle-famille de Tae-joo apparaît d'abord dans toute sa banalité kitsch avant que la mise en scène ne le charge de soutenir par la suite tout le récit, le faisant répercuter la folie des personnages.
La trame reprise du Thérèse Raquin de Zola est pimentée du thème du vampirisme, duquel sont tirées plusieurs figures imposées mais réduites au strict minimum et astucieusement actualisées (détournement des transfusions, habit de prêtre flottant telle une cape, duel à l'aurore). Le gore pointe son nez et le sang coule à flot mais ces projections rouges écarlates bouleversent. Le spectacle des humeurs corporelles et de l'avidité est aussi troublant que chez Cronenberg.
Pas loin d'être un chef-d'œuvre, Thirst, comme le fut Old boy, est un grand film de genre. Et depuis combien de temps n'avions nous pas vu une telle histoire d'amour fou ?
(*) : Qu'une scène issue d'un film de vampires coréen particulièrement sanglant rende de manière si évidente une passion charnelle laisse songeur quant à l'incapacité chronique du cinéma français à renouveller de son côté ses représentations de l'amour physique, qui continue invariablement à être vu sous l'angle d'un naturalisme vaguement bestial, comme dans les récents Regrets.
 Mon espoir de trouver en Micmacs à tire-larigot une comédie française qui soit à la fois "grand public" et inventive a vécu une vingtaine de minutes. La façon dont Jeunet nous fait entrer dans son nouveau conte, se passant quasiment de dialogues et laissant son fil narratif prendre tout son temps pour se nouer, m'a plutôt séduit.
Mon espoir de trouver en Micmacs à tire-larigot une comédie française qui soit à la fois "grand public" et inventive a vécu une vingtaine de minutes. La façon dont Jeunet nous fait entrer dans son nouveau conte, se passant quasiment de dialogues et laissant son fil narratif prendre tout son temps pour se nouer, m'a plutôt séduit. J'ai eu la surprise de découvrir aujourd'hui que j'étais, en compagnie d'Alain Resnais, au centre de la livraison de novembre de la revue
J'ai eu la surprise de découvrir aujourd'hui que j'étais, en compagnie d'Alain Resnais, au centre de la livraison de novembre de la revue  Misère du cinéma français du milieu, rentrée 2009, épisode 2 (*)
Misère du cinéma français du milieu, rentrée 2009, épisode 2 (*)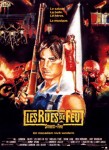 Ouf, j'ai 13 ans ! La première barrière d'interdiction est enfin franchie et je peux tranquillement aller voir par exemple Bernard Giraudeau, Valérie Kaprisky et Caroline Cellier s'entre-déchirer sur les plages de Saint-Tropez pendant L'année des méduses (Christopher Frank). La fable urbaine de Walter Hill, Les rues de feu, contrairement à ce que ma mémoire (et la réputation de son auteur) me soufflait, ne fut pas soumis à la même restriction. Hill était alors considéré comme une nouvelle pointure... A la question du passage du temps, l'ami Mariaque a déjà apporté quelques éléments de réponse
Ouf, j'ai 13 ans ! La première barrière d'interdiction est enfin franchie et je peux tranquillement aller voir par exemple Bernard Giraudeau, Valérie Kaprisky et Caroline Cellier s'entre-déchirer sur les plages de Saint-Tropez pendant L'année des méduses (Christopher Frank). La fable urbaine de Walter Hill, Les rues de feu, contrairement à ce que ma mémoire (et la réputation de son auteur) me soufflait, ne fut pas soumis à la même restriction. Hill était alors considéré comme une nouvelle pointure... A la question du passage du temps, l'ami Mariaque a déjà apporté quelques éléments de réponse 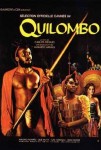 En ce temps-là, Jerry Lewis tentait à nouveau une expérience française mais, après Michel Gérard (Retenez-moi ou je fais un malheur), tombait sur Philippe Clair (Par où t'es rentré, on t'as pas vu sortir). Les comédies américaines du mois, Le convoi des casseurs (de Charles B. Griffith, une histoire de poursuites en voitures) et Moscou à New York (de Paul Mazursky, sur un émigrant soviétique en Amérique, interprété par Robin Williams), n'éveillent pas plus de désir. Avec Quilombo, Carlos Diegues suscitait moins d'enthousiasme qu'aux grandes heures du Cinema novo brésilien. Autres sorties du mois : Reuben, Reuben, ou la vie d'artiste (de Robert Ellis Miller avec Tom Conti), Rocking silver (d'Erik Clausen, chronique rock danoise), Archie Shepp, Je suis jazz... C'est ma vie (documentaire de Franck Cassenti), Cal (de Pat O'Connor, sur l'Irlande du Nord), Christmas story (de Bob Clark), Matagi, le vieux chasseur d'ours (de Toshio Gotoh), Un amour interdit (drame historique de Jean-Pierre Dougnac), Et la vie... et les larmes... et l'amour (Nikolai Goubenko, chronique d'une maison de retraite soviétique). Une fois n'est pas coutume, peut-être faut-il alors se tourner vers Hong Kong : Mad mission est une parodie d'espionnage concoctée par un Tsui Hark en pleine ascension et Le dernier seigneur de Shaolin, de Woo Ming Hung, est un film de kung-fu à l'honnête réputation (contrairement à La main de fer de Chao de Luk Tang, présenté au même moment).
En ce temps-là, Jerry Lewis tentait à nouveau une expérience française mais, après Michel Gérard (Retenez-moi ou je fais un malheur), tombait sur Philippe Clair (Par où t'es rentré, on t'as pas vu sortir). Les comédies américaines du mois, Le convoi des casseurs (de Charles B. Griffith, une histoire de poursuites en voitures) et Moscou à New York (de Paul Mazursky, sur un émigrant soviétique en Amérique, interprété par Robin Williams), n'éveillent pas plus de désir. Avec Quilombo, Carlos Diegues suscitait moins d'enthousiasme qu'aux grandes heures du Cinema novo brésilien. Autres sorties du mois : Reuben, Reuben, ou la vie d'artiste (de Robert Ellis Miller avec Tom Conti), Rocking silver (d'Erik Clausen, chronique rock danoise), Archie Shepp, Je suis jazz... C'est ma vie (documentaire de Franck Cassenti), Cal (de Pat O'Connor, sur l'Irlande du Nord), Christmas story (de Bob Clark), Matagi, le vieux chasseur d'ours (de Toshio Gotoh), Un amour interdit (drame historique de Jean-Pierre Dougnac), Et la vie... et les larmes... et l'amour (Nikolai Goubenko, chronique d'une maison de retraite soviétique). Une fois n'est pas coutume, peut-être faut-il alors se tourner vers Hong Kong : Mad mission est une parodie d'espionnage concoctée par un Tsui Hark en pleine ascension et Le dernier seigneur de Shaolin, de Woo Ming Hung, est un film de kung-fu à l'honnête réputation (contrairement à La main de fer de Chao de Luk Tang, présenté au même moment).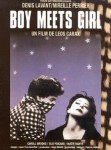 Après un excellent mois d'octobre, novembre flirterait donc avec le néant si trois titres ne relevaient le niveau. La sortie tardive d'un mélodrame de 1959, Fleurs de papier, permettait la découverte de Guru Dutt, grande figure du cinéma indien. L'Anglais Michael Radford s'attaquait courageusement à Orwell en donnant sa version de 1984. De son étonnante réussite, nous vous avons déjà entretenu
Après un excellent mois d'octobre, novembre flirterait donc avec le néant si trois titres ne relevaient le niveau. La sortie tardive d'un mélodrame de 1959, Fleurs de papier, permettait la découverte de Guru Dutt, grande figure du cinéma indien. L'Anglais Michael Radford s'attaquait courageusement à Orwell en donnant sa version de 1984. De son étonnante réussite, nous vous avons déjà entretenu  L'Amadeus de Forman étant sorti le dernier jour du mois d'octobre, plusieurs revues le choisissent pour illustrer leur numéro de novembre : Positif (285), La revue du Cinéma (399) et les Cahiers du Cinéma (365). Cinéma 84 (311) fait de même mais avec L'amour par terre de Rivette. Cinématographe (104) consacre sa livraison mensuelle aux "enfants sauvages" (Le voleur de Bagdad de Berger, Powell et Whelan en couverture) et Jeune Cinéma (162) revient sur l'œuvre de Boris Barnet (La jeune fille au carton à chapeau). La "conquérante" Valérie Kaprisky est à la une de Première (92) et Sophie Marceau sur celle de Starfix (20), en prévision de la sortie de L'amour braque. Finalement, seul L'Écran Fantastique (50) met en avant l'un des films évoqués plus haut, Les rues de feu.
L'Amadeus de Forman étant sorti le dernier jour du mois d'octobre, plusieurs revues le choisissent pour illustrer leur numéro de novembre : Positif (285), La revue du Cinéma (399) et les Cahiers du Cinéma (365). Cinéma 84 (311) fait de même mais avec L'amour par terre de Rivette. Cinématographe (104) consacre sa livraison mensuelle aux "enfants sauvages" (Le voleur de Bagdad de Berger, Powell et Whelan en couverture) et Jeune Cinéma (162) revient sur l'œuvre de Boris Barnet (La jeune fille au carton à chapeau). La "conquérante" Valérie Kaprisky est à la une de Première (92) et Sophie Marceau sur celle de Starfix (20), en prévision de la sortie de L'amour braque. Finalement, seul L'Écran Fantastique (50) met en avant l'un des films évoqués plus haut, Les rues de feu.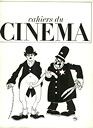
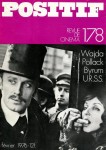 1976 : L'événement, dans notre optique de confrontation, c'est le retour des Cahiers à la couverture illustrée (par le biais d'un Charlot menacé par la censure, dessiné par Willem). On trouve cette année-là dans la revue un dossier sur le cinéma algérien, de nombreux textes sur la photographie (numéro spécial en été) et surtout un certain cinéma français (ou francophone) qui se taille la part du lion, à travers les analyses des films de Godard, Ivens, Comolli (qui était alors toujours au comité de rédaction), Tanner, Benoît Jacquot (L'assassin musicien), André Téchiné (Souvenirs d'en France), René Féret (Histoire de Paul), René Allio (Moi, Pierre Rivière...), Chantal Akerman (Jeanne Dielman..., premier texte de Danièle Dubroux). Deux entretiens avec Michel Foucault sont publiés, ainsi que le premier volet d'une série sur la "fiction de gauche".
1976 : L'événement, dans notre optique de confrontation, c'est le retour des Cahiers à la couverture illustrée (par le biais d'un Charlot menacé par la censure, dessiné par Willem). On trouve cette année-là dans la revue un dossier sur le cinéma algérien, de nombreux textes sur la photographie (numéro spécial en été) et surtout un certain cinéma français (ou francophone) qui se taille la part du lion, à travers les analyses des films de Godard, Ivens, Comolli (qui était alors toujours au comité de rédaction), Tanner, Benoît Jacquot (L'assassin musicien), André Téchiné (Souvenirs d'en France), René Féret (Histoire de Paul), René Allio (Moi, Pierre Rivière...), Chantal Akerman (Jeanne Dielman..., premier texte de Danièle Dubroux). Deux entretiens avec Michel Foucault sont publiés, ainsi que le premier volet d'une série sur la "fiction de gauche".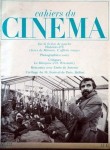
 Quitte à choisir : Le retour des Cahiers n'est pas encore gagnant, malgré Ivens et Tanner (La ligne générale est un Eisenstein un peu encombré). La Cecilia, Nationalité : immigré et Six fois deux ne sont pas des plus faciles à voir. De toute manière, en 1976, la question est : que pourrait-on bien enlever en face ? Sans connaître le Monicelli, je ne vois que le Bergman (et encore... c'est l'un des films-opéras les plus intéressants). Les neuf autres titres sont indispensables. Allez, pour 1976 : Avantage Positif.
Quitte à choisir : Le retour des Cahiers n'est pas encore gagnant, malgré Ivens et Tanner (La ligne générale est un Eisenstein un peu encombré). La Cecilia, Nationalité : immigré et Six fois deux ne sont pas des plus faciles à voir. De toute manière, en 1976, la question est : que pourrait-on bien enlever en face ? Sans connaître le Monicelli, je ne vois que le Bergman (et encore... c'est l'un des films-opéras les plus intéressants). Les neuf autres titres sont indispensables. Allez, pour 1976 : Avantage Positif.
 Joies matrimoniales (dorénavant diffusé sous son titre original, Mr. and Mrs. Smith, sans doute moins vieillot) est l'un des rares Hitchcock parlant qu'il me restait à découvrir. Je n'étais pas spécialement pressé car sa réputation n'a jamais été très flatteuse, le cinéaste lui-même ne faisant rien pour la réhausser. Et en effet, nous avons là le plus faible des films américains du cinéaste.
Joies matrimoniales (dorénavant diffusé sous son titre original, Mr. and Mrs. Smith, sans doute moins vieillot) est l'un des rares Hitchcock parlant qu'il me restait à découvrir. Je n'étais pas spécialement pressé car sa réputation n'a jamais été très flatteuse, le cinéaste lui-même ne faisant rien pour la réhausser. Et en effet, nous avons là le plus faible des films américains du cinéaste. L'œuf du serpent (The serpent's egg) titre mal-aimé de la filmographie bergmanienne, est une œuvre impure, soumise à une étonnante série de tiraillements qui nous retiennent de la placer aux côtés des plus grandes mais qui la rendent dans le même temps absolument captivante. Bien que le scénario fut écrit avant l'exil de Suède d'un Bergman poursuivi par l'administration fiscale et traîté sans ménagement par la presse de son pays, le tournage, effectué en Allemagne, sous les auspices généreux du producteur Dino de Laurentiis, permit au cinéaste de faire passer toute l'inquiétude que lui inspirait son déséquilibre mental de l'époque. Jamais il n'avait bénéficié d'un budget aussi conséquent, d'un temps de tournage aussi long et de moyens techniques aussi importants, notamment en termes de décors. En contrepartie, la limite la plus contraignante fut sans doute pour lui de tourner en anglais (et en allemand dans une moindre mesure).
L'œuf du serpent (The serpent's egg) titre mal-aimé de la filmographie bergmanienne, est une œuvre impure, soumise à une étonnante série de tiraillements qui nous retiennent de la placer aux côtés des plus grandes mais qui la rendent dans le même temps absolument captivante. Bien que le scénario fut écrit avant l'exil de Suède d'un Bergman poursuivi par l'administration fiscale et traîté sans ménagement par la presse de son pays, le tournage, effectué en Allemagne, sous les auspices généreux du producteur Dino de Laurentiis, permit au cinéaste de faire passer toute l'inquiétude que lui inspirait son déséquilibre mental de l'époque. Jamais il n'avait bénéficié d'un budget aussi conséquent, d'un temps de tournage aussi long et de moyens techniques aussi importants, notamment en termes de décors. En contrepartie, la limite la plus contraignante fut sans doute pour lui de tourner en anglais (et en allemand dans une moindre mesure). Parfait antidote au consternant
Parfait antidote au consternant