(Mike Leigh / Grande-Bretagne / 2008)
□□□□
 Poppy, 30 ans, est une institutrice londonienne délurée et fêtarde. Elle partage son appartement avec sa fidèle colocataire, prend des leçons de conduite, s'essaie au flamenco et tombe amoureuse. Poppy est un moulin à paroles qui s'évertue à désamorcer toutes les crises en riant de tout et qui tente de redonner le sourire à tous ceux qu'elle croise.
Poppy, 30 ans, est une institutrice londonienne délurée et fêtarde. Elle partage son appartement avec sa fidèle colocataire, prend des leçons de conduite, s'essaie au flamenco et tombe amoureuse. Poppy est un moulin à paroles qui s'évertue à désamorcer toutes les crises en riant de tout et qui tente de redonner le sourire à tous ceux qu'elle croise.
Be happy (Happy-go-lucky) est censé être le rayon de soleil de notre rentrée. Avec son affiche pétante et son titre volontariste, cette comédie doit nous redonner la pêche. La presse nous le dit aussi, même les contempteurs habituels de Mike Leigh se faisant bienveillant. Et bien, au risque de passer pour un pisse-froid, je vous avoue que devant le film, le même mot m'est revenu toutes les cinq minutes : pathétique.
Après un générique désuet, très années 60, les trois premières séquences sont catastrophiques. On pense à un mauvais début, mais cela ne s'arrangera en fait jamais. Dans la première, Poppy entre dans une librairie et essaie de dérider l'employé de la boutique, qui ne décroche pas un mot (ni un bonjour, ni rien). Voici déjà mis en évidence l'un des gros soucis du film. Mike Leigh, pour faire des étincelles, ne confronte sa Poppy qu'à des cas spéciaux : ici le libraire qui fait la gueule, plus tard la prof de danse espagnole bien allumée, le moniteur d'auto-école raciste et violent ou le clochard qui perd la boule. Dans la deuxième séquence, on voit Poppy et ses amies s'éclater en discothèque. Seul intérêt pour le cinéaste : montrer les jeunes femmes désinhibées, assumant l'exubérance de leur tenue et de leurs gestes. L'ambiance, la musique, il s'en contrefout : une scène pour rien. Dans la troisième, le summum est atteint avec un long délire entre les cinq copines, bien bourrées et affalées dans le salon. Blagues vaseuses à gogo, rires forcés et ivresse surjouée. Il reste encore 1h45 de projection.
Tenues voyantes de Poppy, décorations d'appartements chargées, salles de classes chaleureuses : les couleurs vives sont là, mais comme délavées. Comme un Londres sans soleil, comme une comédie sans gag. Ah si, je crois qu'une dame dans la salle a ri à un moment (loin de la banane affichée par les critiques, les spectateurs s'exprimant sur le site allociné, auxquels on ne peut en général pas reprocher de ne pas être bon public, donnent à peine la moyenne au film). Leigh ne compte que sur deux choses pour faire naître le comique : des dialogues endiablés et des caractères bien trempés. L'incessant ping-pong verbal est fatigant, souvent souligné par de très moches gros plans sur les visages. A chaque instant, on croit entendre le cinéaste diriger ses comédiens : "Dis le plus vite !", "Accentue l'intonation !". Les caractères sont eux, je l'ai déjà dit, tous poussés à la limite (sauf bien sûr, l'amoureux).
La comédie ne marche pas, la mise en scène non plus, reste donc le message : Poppy devrait de temps à autre se calmer et faire face à la réalité du monde. En gros, et la scène finale nous l'explique au cas où : trop bonne, trop conne. Bien sûr, la prise de conscience se fait progressivement. Poppy commence à rire jaune, puis plus du tout. Un enfant de la classe frappe ses petits camarades (on comprend dès le début ce que le récit met dix minutes à traiter au travers d'un entretien avec un assistant social : l'enfant est battu à la maison), l'homme de l'auto-école est de plus en plus inquiétant et dangereux... Pour mettre en scène un vrai tournant "original", Leigh en appelle au bon vieux théâtre lors d'une séquence ahurissante entre Poppy et un brave clochard. Tout cela va donc la changer, la délester de son immaturité, la poser un peu. Elle saura contenir la fureur de son moniteur raciste et pourra l'entendre lui dire ses quatre vérités, si justes au fond (puisque tout le monde est humain, n'est-ce pas ?).
La plupart des critiques défenseurs du film font mine de s'étonner que Mike Leigh signe une comédie, manière grossière de se mettre le lecteur dans la poche. Deux filles d'aujourd'hui, en 97, en était déjà une et ses autres films, même parmi les plus noirs, contiennent nombre de saynètes comiques ou ironiques. Non, la surprise, si il y en a une, c'est bien de voir l'auteur de fables caustiques (High hopes), de solides mélodrames (Secrets et mensonges, Vera Drake) et de grands films désespérés (Naked, All or nothing), réaliser une oeuvrette aussi laborieuse.
 En plein coeur de l'Asie Centrale, Bair, un jeune Mongol, doit quitter la yourte familiale pour aller vendre ses peaux de bêtes au marché de la ville. Arnaqué par un tout puissant acheteur étranger (la région est sous domination anglaise), il provoque un esclandre et doit fuir. Dans les montagnes, il croise alors la route d'un groupe de partisans rouges, qui luttent contre l'occupant. Plus tard, il tombera aux mains des Anglais. Ces derniers, après avoir eu l'intention de l'abattre, s'aperçoivent qu'il est le descendant de Gengis-Khan. Ils décident alors de s'en servir comme homme de paille, le proclamant souverain d'un pays qu'ils veulent contrôler en sous-main.
En plein coeur de l'Asie Centrale, Bair, un jeune Mongol, doit quitter la yourte familiale pour aller vendre ses peaux de bêtes au marché de la ville. Arnaqué par un tout puissant acheteur étranger (la région est sous domination anglaise), il provoque un esclandre et doit fuir. Dans les montagnes, il croise alors la route d'un groupe de partisans rouges, qui luttent contre l'occupant. Plus tard, il tombera aux mains des Anglais. Ces derniers, après avoir eu l'intention de l'abattre, s'aperçoivent qu'il est le descendant de Gengis-Khan. Ils décident alors de s'en servir comme homme de paille, le proclamant souverain d'un pays qu'ils veulent contrôler en sous-main. Lorsque l'on s'attend à une simple adaptation par Murnau (et Carl Mayer) de la pièce de Molière, la surprise est de taille. Avec son Tartuffe (Herr Tartüff), le cinéaste allemand offre à la fois le texte et son explication, du moins l'une des leçons que l'on peut en tirer. Un bourgeois, âgé et malade, se fait cajoler par sa gouvernante qui lorgne sur sa fortune. Au moment où le vieillard se décide enfin à écrire au notaire en faveur de celle-ci, son petit-fils, mal-aimé car vivant une vie dissolue de comédien, débarque et s'aperçoit vite du manège. Mis à la porte, il s'adresse soudain à nous (par carton interposé), face à la caméra, pour nous prévenir que les choses ne se passeront pas comme cela. Il revient le lendemain, grimé, et parvient à organiser dans le salon de son grand-père, à l'attention des deux occupants des lieux, la projection d'un film de cinéma, titré Tartuffe. C'est ainsi qu'après vingt minutes, un nouveau film, celui attendu, commence.
Lorsque l'on s'attend à une simple adaptation par Murnau (et Carl Mayer) de la pièce de Molière, la surprise est de taille. Avec son Tartuffe (Herr Tartüff), le cinéaste allemand offre à la fois le texte et son explication, du moins l'une des leçons que l'on peut en tirer. Un bourgeois, âgé et malade, se fait cajoler par sa gouvernante qui lorgne sur sa fortune. Au moment où le vieillard se décide enfin à écrire au notaire en faveur de celle-ci, son petit-fils, mal-aimé car vivant une vie dissolue de comédien, débarque et s'aperçoit vite du manège. Mis à la porte, il s'adresse soudain à nous (par carton interposé), face à la caméra, pour nous prévenir que les choses ne se passeront pas comme cela. Il revient le lendemain, grimé, et parvient à organiser dans le salon de son grand-père, à l'attention des deux occupants des lieux, la projection d'un film de cinéma, titré Tartuffe. C'est ainsi qu'après vingt minutes, un nouveau film, celui attendu, commence.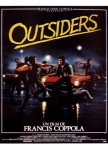 Si je vous dis que La ballade de Narayamade Shohei Imamura est le film qui m'a le plus marqué à ce moment-là, vous ne me croirez pas et vous aurez bien raison. Car pour tout ado, la grande affaire de cette rentrée était le Outsidersde Francis Ford Coppola. Cette vision romantique de bandes qui s'affrontent dans une petite ville américaine ne pouvait que nous séduire, ma petite soeur et moi, jusqu'à nous faire apprendre les noms de tous les interprètes du film pour pouvoir suivre ensuite leurs carrières futures. Que vaut Outsiders, maintenant ? Je n'ose trop me pencher dessus. Nul doute qu'il doit être bien écrasé par les autres oeuvres du grand barbu.
Si je vous dis que La ballade de Narayamade Shohei Imamura est le film qui m'a le plus marqué à ce moment-là, vous ne me croirez pas et vous aurez bien raison. Car pour tout ado, la grande affaire de cette rentrée était le Outsidersde Francis Ford Coppola. Cette vision romantique de bandes qui s'affrontent dans une petite ville américaine ne pouvait que nous séduire, ma petite soeur et moi, jusqu'à nous faire apprendre les noms de tous les interprètes du film pour pouvoir suivre ensuite leurs carrières futures. Que vaut Outsiders, maintenant ? Je n'ose trop me pencher dessus. Nul doute qu'il doit être bien écrasé par les autres oeuvres du grand barbu.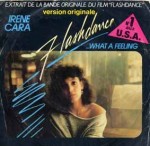 Flashdance(Adrian Lyne) est l'autre grosse machine hollywoodienne arrivée ce mois-là. Moins tourneboulé par Jennifer Beals que Nanni Moretti, je me rappelle cependant avoir suivi avec grand plaisir ses aventures transpirantes sur les dance floors et avoir acheté le 45 tours qui allait avec.
Flashdance(Adrian Lyne) est l'autre grosse machine hollywoodienne arrivée ce mois-là. Moins tourneboulé par Jennifer Beals que Nanni Moretti, je me rappelle cependant avoir suivi avec grand plaisir ses aventures transpirantes sur les dance floors et avoir acheté le 45 tours qui allait avec.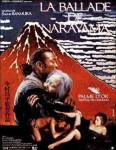 Si je devais hiérarchiser aujourd'hui les sorties, en tenant compte des oeuvres découvertes bien plus tard, je placerai au plus haut La ballade de Narayama(qui arrivait auréolée de sa Palme d'or). N'en déplaise à Woody Allen et son cru 1983 : Zelig, aussi brillant soit-il.
Si je devais hiérarchiser aujourd'hui les sorties, en tenant compte des oeuvres découvertes bien plus tard, je placerai au plus haut La ballade de Narayama(qui arrivait auréolée de sa Palme d'or). N'en déplaise à Woody Allen et son cru 1983 : Zelig, aussi brillant soit-il.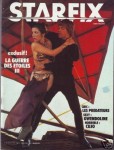 Du côté des revues, Positif (n°271) et La Revue du Cinéma(n°386) choisissaient de mettre Imamura en vedette et les Cahiers du Cinéma(n°351) regardaient eux aussi vers l'Orient avec un dossier sur le cinéma chinois (en couverture : Boat peoplede Ann hui, qui allait sortir, avec succès, quelques semaines plus tard). Cinéma 83(n°297) s'entretenait avec Fanny Ardant et Premiere(n°78) avec Miou-Miou, quand Starfix (n°7) anticipait sur le troisième volet de La guerre des étoiles. Enfin, Cinématographe (n°92) rendait hommage à Luis Bunuel, qui venait de s'éteindre.
Du côté des revues, Positif (n°271) et La Revue du Cinéma(n°386) choisissaient de mettre Imamura en vedette et les Cahiers du Cinéma(n°351) regardaient eux aussi vers l'Orient avec un dossier sur le cinéma chinois (en couverture : Boat peoplede Ann hui, qui allait sortir, avec succès, quelques semaines plus tard). Cinéma 83(n°297) s'entretenait avec Fanny Ardant et Premiere(n°78) avec Miou-Miou, quand Starfix (n°7) anticipait sur le troisième volet de La guerre des étoiles. Enfin, Cinématographe (n°92) rendait hommage à Luis Bunuel, qui venait de s'éteindre. L'insoumisdémarre en Kabylie en 1959 avec une embuscade dans laquelle des soldats sont pris sous le feu de tireurs algériens. Thomas, l'un des légionnaires, tente un coup d'éclat en allant porter secours à un camarade amoché en contrebas. Arrivé difficilement à ses côtés, il s'aperçoit que l'homme est déjà mort. Le deuxième long-métrage d'Alain Cavalier, dès son introduction, annonce la couleur : noire. A ses débuts, le cinéaste, comme Claude Sautet à la même époque, oeuvrait dans le film noir (avec Le combat dans l'île en 1962, puis Mise à sac en 1967). L'insoumisest en plein dans le genre, mais son argument de départ, lié à la guerre d'Algérie, change déjà beaucoup de choses (et ce film, avec d'autres, tord encore le cou à la légende tenace selon laquelle le cinéma français aurait traîné pour traiter de la question).
L'insoumisdémarre en Kabylie en 1959 avec une embuscade dans laquelle des soldats sont pris sous le feu de tireurs algériens. Thomas, l'un des légionnaires, tente un coup d'éclat en allant porter secours à un camarade amoché en contrebas. Arrivé difficilement à ses côtés, il s'aperçoit que l'homme est déjà mort. Le deuxième long-métrage d'Alain Cavalier, dès son introduction, annonce la couleur : noire. A ses débuts, le cinéaste, comme Claude Sautet à la même époque, oeuvrait dans le film noir (avec Le combat dans l'île en 1962, puis Mise à sac en 1967). L'insoumisest en plein dans le genre, mais son argument de départ, lié à la guerre d'Algérie, change déjà beaucoup de choses (et ce film, avec d'autres, tord encore le cou à la légende tenace selon laquelle le cinéma français aurait traîné pour traiter de la question).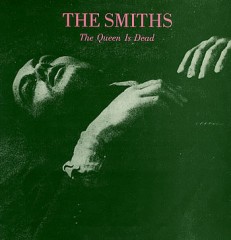
 Une fois encore, les frères Dardenne m'ont eu à l'arrache.
Une fois encore, les frères Dardenne m'ont eu à l'arrache. The crazies a été baptisé lors de sa sortie en France La nuit des fous vivants, afin de le rattacher bien sûr au classique de son auteur : La nuit des morts-vivants. Si déplorable soit ce titre, il faut admettre que de multiples points communs caractérisent les deux oeuvres, au point que The craziespeut facilement être pris pour un codicille à la célèbre série sur les zombies. Même approche réaliste, même fond politique, mêmes cibles (militaires et scientifiques), même emploi d'inserts gores (pas forcément justifiés ici) et toujours l'attachement à un petit groupe de personnes pris au piège. Si il s'agit cette fois encore de combattre une contagion mortelle, son origine est cependant connue : la pollution accidentelle d'une rivière par une arme bactériologique à l'essai a provoqué une épidémie de folie furieuse au sein d'une ville de Pennsylvanie de 3000 habitants. L'armée envoie plusieurs compagnies pour boucler la zone et mettre en quarantaine toute la population. Les responsables politiques et militaires envisagent le pire pour régler le problème (le recours à une bombe atomique) alors que les soldats sur place accumulent les bavures et doivent faire face à des mouvements de révolte armés.
The crazies a été baptisé lors de sa sortie en France La nuit des fous vivants, afin de le rattacher bien sûr au classique de son auteur : La nuit des morts-vivants. Si déplorable soit ce titre, il faut admettre que de multiples points communs caractérisent les deux oeuvres, au point que The craziespeut facilement être pris pour un codicille à la célèbre série sur les zombies. Même approche réaliste, même fond politique, mêmes cibles (militaires et scientifiques), même emploi d'inserts gores (pas forcément justifiés ici) et toujours l'attachement à un petit groupe de personnes pris au piège. Si il s'agit cette fois encore de combattre une contagion mortelle, son origine est cependant connue : la pollution accidentelle d'une rivière par une arme bactériologique à l'essai a provoqué une épidémie de folie furieuse au sein d'une ville de Pennsylvanie de 3000 habitants. L'armée envoie plusieurs compagnies pour boucler la zone et mettre en quarantaine toute la population. Les responsables politiques et militaires envisagent le pire pour régler le problème (le recours à une bombe atomique) alors que les soldats sur place accumulent les bavures et doivent faire face à des mouvements de révolte armés. Un Roger Corman pour enfants ? Quasiment. Et il y a, malheureusement, peu de choses à ajouter à propos de ce tout petit Corbeau (The raven). Comptant parmi les nombreuses adaptations d'Edgar Allan Poe écrites par Richard Matheson pour le pape de la série B, celle-ci est ouvertement comique et aussi peu inquiétante que possible. On y trouve bien des châteaux imposants, des cercueils qu'il faut rouvrir, une main qui s'aggrippe à une épaule et un dénouement dans les flammes, mais ces éléments ont plus valeur de clin d'oeil qu'autre chose.
Un Roger Corman pour enfants ? Quasiment. Et il y a, malheureusement, peu de choses à ajouter à propos de ce tout petit Corbeau (The raven). Comptant parmi les nombreuses adaptations d'Edgar Allan Poe écrites par Richard Matheson pour le pape de la série B, celle-ci est ouvertement comique et aussi peu inquiétante que possible. On y trouve bien des châteaux imposants, des cercueils qu'il faut rouvrir, une main qui s'aggrippe à une épaule et un dénouement dans les flammes, mais ces éléments ont plus valeur de clin d'oeil qu'autre chose. Tout en privilégiant, comme la plupart de ses prédécesseurs cinéastes-enquêteurs, un regard documentaire, il ne s'agit plus maintenant pour Matteo Garrone de décrire les rouages de la mafia (plus précisément de la Camorra napolitaine) mais bien de se placer au centre et d'observer, médusé, les dégâts. Aux études verticales passées qui mettaient l'accent sur la structure pyramidale de l'organisation, Gomorrasubstitue une succession de visions horizontales. Cinq histoires parallèles se jouent, autour de Naples, à cinq niveaux différents : le très jeune Toto entre dans la bande qui contrôle son quartier; Marco et Ciro se veulent indépendants et n'arrêtent pas de "foutre la merde" dans la zone réservée; Don Ciro sillonne les barres d'immeubles, chargé par l'organisation de dédommager les familles des mafieux emprisonnés; Franco est un entrepreneur empoisonnant la terre avec ses décharges; et Pasquale est un tailleur remarquable qui ne se satisfait pas de son travail au sein d'un atelier clandestin et se lie, au péril de sa vie, à des collègues Chinois.
Tout en privilégiant, comme la plupart de ses prédécesseurs cinéastes-enquêteurs, un regard documentaire, il ne s'agit plus maintenant pour Matteo Garrone de décrire les rouages de la mafia (plus précisément de la Camorra napolitaine) mais bien de se placer au centre et d'observer, médusé, les dégâts. Aux études verticales passées qui mettaient l'accent sur la structure pyramidale de l'organisation, Gomorrasubstitue une succession de visions horizontales. Cinq histoires parallèles se jouent, autour de Naples, à cinq niveaux différents : le très jeune Toto entre dans la bande qui contrôle son quartier; Marco et Ciro se veulent indépendants et n'arrêtent pas de "foutre la merde" dans la zone réservée; Don Ciro sillonne les barres d'immeubles, chargé par l'organisation de dédommager les familles des mafieux emprisonnés; Franco est un entrepreneur empoisonnant la terre avec ses décharges; et Pasquale est un tailleur remarquable qui ne se satisfait pas de son travail au sein d'un atelier clandestin et se lie, au péril de sa vie, à des collègues Chinois. Salvatore Giuliano, film-enquête de Francesco Rosi, se base tout entier sur un mouvement analytique. Un mouvement de rapprochement allant du général au particulier, du paysage aux individus. Mais contrairement à l'habitude, ce resserrement ne fait qu'épaissir et complexifier le mystère de départ. Démarrant sur la découverte du cadavre du célèbre bandit sicilien au cours de l'été 1950, le récit se déploie en deux lignes temporelles. De la fin de la guerre, où lui et ses hommes, instruments des indépendantistes, se battent contre l'armée italienne, à son assassinat, nous suivons les principales étapes du parcours de Giuliano, dont le massacre de Portella delle Ginestre (une dizaine de personnes assistant à une réunion organisée par les communistes, le 1er mai 1947, abattue par la bande à Giuliano, sur demande d'un commanditaire resté inconnu). Parallèlement, nous sont montrés quelques événements suivant sa mort, jusqu'au procès de ses compagnons.
Salvatore Giuliano, film-enquête de Francesco Rosi, se base tout entier sur un mouvement analytique. Un mouvement de rapprochement allant du général au particulier, du paysage aux individus. Mais contrairement à l'habitude, ce resserrement ne fait qu'épaissir et complexifier le mystère de départ. Démarrant sur la découverte du cadavre du célèbre bandit sicilien au cours de l'été 1950, le récit se déploie en deux lignes temporelles. De la fin de la guerre, où lui et ses hommes, instruments des indépendantistes, se battent contre l'armée italienne, à son assassinat, nous suivons les principales étapes du parcours de Giuliano, dont le massacre de Portella delle Ginestre (une dizaine de personnes assistant à une réunion organisée par les communistes, le 1er mai 1947, abattue par la bande à Giuliano, sur demande d'un commanditaire resté inconnu). Parallèlement, nous sont montrés quelques événements suivant sa mort, jusqu'au procès de ses compagnons.