

****/****
Voir Polisse et prendre connaissance, au-delà de son succès public, des réactions de la presse, majoritairement très enthousiaste (*), amène à penser, même si l'on ne se sent guère proche des Cassandre annonçant régulièrement sa mort, que le cinéma a perdu la bataille, qu'il a été absorbé, qu'il n'y a plus que l'étiquette qui le distingue de la télévision. A quoi sert le "grand film" de Maïwenn ? Quelle est sa finalité ? Quel point de vue le soutient ? Sa seule utilité, à mon sens, est de permettre la tenue de débats sociologiques à l'issue des projections (celui auquel j'ai assisté était intéressant, bien plus que le film lui-même). Partout où ils sont organisés, probablement, les intervenants ont le même jugement, positif, sur l'authenticité de ce qui est montré à l'écran (une fois exprimées quelques légères réserves concernant la condensation du récit, l'aspect spectaculaire de certains dialogues ou l'adaptation parfois défaillante des propos adressés aux plus jeunes). Mais à quoi bon être authentique si l'on n'a que cela à proposer ? Il suffit, pour s'informer sur le sujet, pour être édifié, de regarder n'importe quel document télévisé sur l'enfance en souffrance. Polisse n'est pas un film, c'est la reconstitution d'un reportage de France 2.
Une fois ceci établi, se pose alors aussitôt le problème de la représentation et du défilé d'acteurs connus singeant des douleurs d'anonymes. Cette bourgeoise qui pleure sous le feu des questions de l'enquêtrice, ce n'est que Sandrine Kiberlain qui joue la détresse. Cette femme flic qui se fige devant un fœtus posé sur une table d'hopital, ce n'est que Marina Foïs qui fait sa grande scène choc. Cet écart est donc, déjà, trop grand, entre le réel et les figures supposées le débusquer. Il devient parfois abyssal lorsque Maïwenn s'enquiert de désamorcer ce qui serait trop douloureux ou dévalorisant pour l'image de cette police des mineurs. Le regroupement des enfants roms séparés de leurs parents se termine en comédie musicale rieuse, la crise de larmes d'un gamin laissé par sa mère est l'occasion de faire accéder Joey Starr au rang de "grand acteur", la grosse baffe que donne le même Joey soulage tout le monde car elle atteint un notable dégueulasse... Rendre compte d'une réalité complexe, ce n'est pas faire défiler les victimes comme autant de cas, ni coller l'une à l'autre une séquence sur un intégriste et une séquence sur une formidable famille cosmopolite, ni dérouler à la cantine une discussion entre pro- et anti-Sarkozy. Tout cela ne sert qu'à contenter tout le monde (sauf les pédophiles).
Pour ce qui est de l'énergie (tant vantée depuis la présentation du film à Cannes), Maïwenn pense qu'elle naît de l'entassement dans le cadre et de la caméra portée. Certes, ça bouge mais aucune dynamique cinématographique n'est créée. Si Maïwenn a pour modèle Pialat ou, plus près de nous, Cantet ou Kechiche, qu'en est-il des notions de temps, de flux et d'épuisement du plan ?
Surtout, sur quoi et comment porte son regard ? L'actrice-réalisatrice s'est réservée le rôle d'une photographe intégrée provisoirement à la brigade (inutile de penser à Depardon, la piste ne mène nulle part). Or, son personnage ne sort pas un mot, ou presque, de tout le film. Cette fille n'est là que, d'une part, pour jouer la love story avec Joey et, d'autre part, pour servir de relai au spectateur découvrant ce monde particulier. Et encore le fait-elle mollement, sans conviction. Ses photos ? Nous n'en verrons aucune. L'absence cruelle de point de vue se ressent également à un autre niveau. La caméra colle tout d'abord aux basques des policiers, puis ce pacte est brisé lorsque sont mis en scène des moments qui sont extérieurs à la vie de l'équipe, des représentations d'abus s'intercalant alors jusqu'au dénouement, ahurissant point d'orgue en montage alterné d'une entreprise perdue d'avance puisque son initiatrice n'avait finalement rien d'autre à dire que "détruire l'enfance, c'est mal" et "le métier de policier est difficile".
Polisse est un reportage mal dramatisé soumis au nivellement formel et moral télévisuel. L.627 est un film de cinéma. Il y a près de vingt ans de cela, il suscita lui aussi nombre de débats et son authenticité fut également saluée par les policiers. Mais Bertrand Tavernier, lui, ne s'arrêtait pas là. Sur la représentation de la police (et des délinquants) à l'écran, sur la frontière poreuse entre documentaire et fiction, sur la valeur d'une image, le cinéaste exprime des choses que Maïwenn est à cent lieues de laisser percevoir tant son abdication sur la forme est totale.
Ici aussi le spectateur trouve un relai avec le personnage joué par un excellent Didier Bezace. Mais le respect de ce point de vue est strict et devient clairement celui de Tavernier. L'introduction à un groupe n'a rien d'artificiel : notre homme n'est pas un "bleu", c'est un nom connu dans la police, la première demi-heure étant d'ailleurs consacrée, de façon assez audacieuse sur le plan narratif, à illustrer ses déboires, ses renvois d'une brigade à l'autre, avant qu'il ne se pose à l'endroit attendu. Et cet endroit, il est vu à travers son regard seulement (ajoutons que l'homme est passionné de vidéo et que nous le voyons, à un moment, en mission, s'arrêter de filmer une scène de rue parce que son acte tourne au voyeurisme). Tavernier n'éclaire qu'une intimité, celle de son personnage principal, sans pour autant tout en dire, tout expliquer. Des zones d'ombre subsistent partout, des histoires ne sont pas bouclées.
La progression dramaturgique est remarquable, ménageant des pauses musicales et s'appuyant sur un découpage judicieux. Le professionnel et l'intime alternent à l'écran et l'un influe sur l'autre souterrainement et non pas lourdement pour fournir des explications faciles à des situations inconfortables (pas d'équivalent chez Tavernier au "fœtus de Marina"). De belle manière ces deux flux se rejoindront dans la dernière scène, ponctuant la montée d'une sensation de pessimisme et de lassitude.
Les dérives, pour Tavernier, ne tiennent pas seulement au manque de moyens, à la compétition entre les polices et à la pesanteur hiérarchique. Les hommes ne sont pas dédouanés. Chez lui, la complexité et l'ambivalence doivent être dans le plan lui-même et non pas advenir par l'assemblage scolaire de deux séquences opposées. Par exemple, les bons mots, qui encombrent un peu, il est vrai, le début du film (l'argot parlé par les policiers sonne plus ou moins bien selon les acteurs), le cinéaste s'abstient de toujours les mettre en avant, de toujours finir ses plans avec eux. De plus, il laisse ceux qui, assurément, sont navrants. Plus significativement encore, on peut différencier la façon dont Maïwenn court immédiatement vers les moments les plus forts, les plus édifiants, de celle dont Tavernier garde les séquences qui ne font rien avancer dramatiquement et qui n'ont aucune valeur d'exemple. Les scènes d'action (et il y en a plusieurs dans L.627) sont filmés à la bonne distance et ne sont pas "dramatisées" : ce n'est jamais un seul personnage qui en porte la charge, aucun n'est mis ainsi en valeur par un coup de scénario.
Enfin, disons que filmer la brigade de protection des mineurs est peut-être plus douloureux sur le plan personnel mais bien moins périlleux sur ceux de la morale, du social et du politique, que s'attacher à décrire le travail des stups. Dans Polisse, un sale pédophile friqué se prend une torgnole. Dans L.627, des dealers, noirs et arabes, ne cessent d'encaisser des coups. Maïwenn termine son film avec un beau slogan en image : "Un flic s'éteint. Un enfant renaît." Tavernier, lui, le fait en laissant la route et la ville s'éloigner sous les yeux de son personnage noyé dans la pénombre à l'arrière de son Trafic.
(*) : On appréciera d'autant plus la détonnante sortie de Pierre Murat dans le Télérama de cette semaine, à l'occasion de la sortie de la comédie Intouchables : "Décidément, 2011 risque d'être une sale année pour les fans du cinéma français qui croient encore à la mise en scène. Il y en avait peu dans La guerre est déclarée. Presque pas dans Polisse. Et plus du tout ici. D'accord, on a parfaitement le droit de prôner, désormais, un cinéma où le cinéma n'a plus de raison d'être. Mais alors, il faut se l'avouer et le dire."
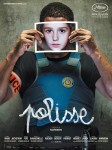
 POLISSE
POLISSE
de Maïwenn Le Besco
(France / 127 min / 2011)
L.627
de Bertrand Tavernier
(France / 145 min / 1992)

 FOXY BROWN
FOXY BROWN
 DRIVE
DRIVE

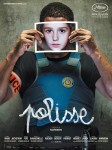
 POLISSE
POLISSE
 J'AI RENCONTRÉ LE DIABLE (Akmareul boatda)
J'AI RENCONTRÉ LE DIABLE (Akmareul boatda)
 LA PIEL QUE HABITO
LA PIEL QUE HABITO
 ANIMAL KINGDOM
ANIMAL KINGDOM
 L'ENFER EST A LUI (White heat)
L'ENFER EST A LUI (White heat) Mais commençons par l'agréable. A qui découvre Zodiac sans connaître David Fincher, il ne viendrait pas à l'esprit de qualifier ce cinéma-là de tape-à-l'œil. En effet, pour une fois, la mise en scène du réalisateur de Fight Club n'excède jamais son sujet. Elle se déploie majestueusement dans la durée, afin d'embrasser les nombreuses années que recouvrent le récit mais également afin de plonger le spectateur dans un temps et un espace de plus en plus flottant, cela malgré la précision, jamais prise en défaut, de la datation et de la géographie. Zodiac a bien un personnage principal, le dessinateur Robert Graysmith, mais celui-ci peut être congédié temporairement de l'écran (comme il lui est demandé plusieurs fois par ses supérieurs hiérarchiques de quitter la salle de rédaction dans laquelle ils doivent avoir une discussion importante), l'assemblage des différents blocs structurant le récit en devenant totalement imprévisible.
Mais commençons par l'agréable. A qui découvre Zodiac sans connaître David Fincher, il ne viendrait pas à l'esprit de qualifier ce cinéma-là de tape-à-l'œil. En effet, pour une fois, la mise en scène du réalisateur de Fight Club n'excède jamais son sujet. Elle se déploie majestueusement dans la durée, afin d'embrasser les nombreuses années que recouvrent le récit mais également afin de plonger le spectateur dans un temps et un espace de plus en plus flottant, cela malgré la précision, jamais prise en défaut, de la datation et de la géographie. Zodiac a bien un personnage principal, le dessinateur Robert Graysmith, mais celui-ci peut être congédié temporairement de l'écran (comme il lui est demandé plusieurs fois par ses supérieurs hiérarchiques de quitter la salle de rédaction dans laquelle ils doivent avoir une discussion importante), l'assemblage des différents blocs structurant le récit en devenant totalement imprévisible. Des abîmes, The social network, film lisse et impénétrable, ne s'en approche pas. Contrairement à ce que semble penser l'écrasante majorité des spectateurs, je trouve personnellement que David Fincher ne parvient pas à dépasser la banalité et l'absence de cinégénie de son sujet, pas plus qu'il ne réussit à racheter la médiocrité morale de ses personnages. Le monde décrit ici (le monde réel et non virtuel) m'apparaît détestable en tous points. Mark Zuckerberg et ses congénères de Harvard s'ébattent dans un univers régi par les lois de l'argent, de la compétition, de la sélection. Même la démarche rebelle s'y dissout, le créateur de Facebook, présenté comme un caractère si atypique, en acceptant secrètement toutes les règles, poursuivant le long d'un chemin à peine détourné les mêmes rêves que les autres : intégrer un Club privé et devenir milliardaire grâce à une simple idée. Jamais Fincher ne critique cette idéologie de l'ascension sociale jalonnée de petits bizutages et de grandes trahisons, le regard moqueur qu'il lance sur les jumeaux Winklevoss n'existant que pour faire oublier la complaisance de celui portant sur les véritables héros de l'histoire, Zuckerberg et ses partenaires Saverin et Parker.
Des abîmes, The social network, film lisse et impénétrable, ne s'en approche pas. Contrairement à ce que semble penser l'écrasante majorité des spectateurs, je trouve personnellement que David Fincher ne parvient pas à dépasser la banalité et l'absence de cinégénie de son sujet, pas plus qu'il ne réussit à racheter la médiocrité morale de ses personnages. Le monde décrit ici (le monde réel et non virtuel) m'apparaît détestable en tous points. Mark Zuckerberg et ses congénères de Harvard s'ébattent dans un univers régi par les lois de l'argent, de la compétition, de la sélection. Même la démarche rebelle s'y dissout, le créateur de Facebook, présenté comme un caractère si atypique, en acceptant secrètement toutes les règles, poursuivant le long d'un chemin à peine détourné les mêmes rêves que les autres : intégrer un Club privé et devenir milliardaire grâce à une simple idée. Jamais Fincher ne critique cette idéologie de l'ascension sociale jalonnée de petits bizutages et de grandes trahisons, le regard moqueur qu'il lance sur les jumeaux Winklevoss n'existant que pour faire oublier la complaisance de celui portant sur les véritables héros de l'histoire, Zuckerberg et ses partenaires Saverin et Parker. Le Britannique Michael Winterbottom est un réalisateur moyen, dont les résultats oscillent entre le pas terrible et le pas mal, du moins pour ce que j'en sais, celui-ci tenant en effet une cadence de production impressionnante et difficile à suivre (une vingtaine de titres accumulés depuis le début des années 90). Précédé d'une légère odeur de souffre, essentiellement due à la sauvagerie de quelques meurtres (notre homme aimant se faire parfois provocateur comme lorsqu'il réalisa ce 9 songs alternant scènes de sexe et captations de performances rock, expérience au final plus ennuyeuse qu'autre chose, si l'on en croit la très grande majorité des spectateurs y ayant goûté), The killer inside me ne change en rien la position du cinéaste, ce dernier opus en date, bien que s'assurant l'une des meilleures places au sein de la filmographie, drainant en quantités égales qualités et défauts, habiletés et maladresses.
Le Britannique Michael Winterbottom est un réalisateur moyen, dont les résultats oscillent entre le pas terrible et le pas mal, du moins pour ce que j'en sais, celui-ci tenant en effet une cadence de production impressionnante et difficile à suivre (une vingtaine de titres accumulés depuis le début des années 90). Précédé d'une légère odeur de souffre, essentiellement due à la sauvagerie de quelques meurtres (notre homme aimant se faire parfois provocateur comme lorsqu'il réalisa ce 9 songs alternant scènes de sexe et captations de performances rock, expérience au final plus ennuyeuse qu'autre chose, si l'on en croit la très grande majorité des spectateurs y ayant goûté), The killer inside me ne change en rien la position du cinéaste, ce dernier opus en date, bien que s'assurant l'une des meilleures places au sein de la filmographie, drainant en quantités égales qualités et défauts, habiletés et maladresses. Quels que soient leur sujet et leur degré de réussite, les films de Roman Polanski, du Couteau dans l'eau au Ghost writer ressemblent tous énormément à leur époque - précisons aussitôt qu'ils ne courent pas pour autant après la mode. Par conséquent, autant que la mise en avant (plutôt que le "retour") des thèmes favoris du cinéaste, il convient de saluer ses capacités de renouvellement formel, dans un cadre à la fois classique et très actuel.
Quels que soient leur sujet et leur degré de réussite, les films de Roman Polanski, du Couteau dans l'eau au Ghost writer ressemblent tous énormément à leur époque - précisons aussitôt qu'ils ne courent pas pour autant après la mode. Par conséquent, autant que la mise en avant (plutôt que le "retour") des thèmes favoris du cinéaste, il convient de saluer ses capacités de renouvellement formel, dans un cadre à la fois classique et très actuel.