FIN DU RECENSEMENT
*****
RESULTAT FINAL, BILAN ET COMMENTAIRES ICI

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
FIN DU RECENSEMENT
*****
RESULTAT FINAL, BILAN ET COMMENTAIRES ICI

Ce blog ne deviendra jamais un blog musical. La musique y restera toujours à l'état de traces. Je crois bien que jamais je n'écrirai ici (ou ailleurs) la moindre chronique de disque. Le cinéma, je vois comment c'est fait. La musique, elle, m'échappe depuis toujours. Je suis par conséquent incapable d'en parler.
A l'inverse de ce qui s'est passé pour les films, l'envie de proposer un top des meilleurs albums des années 2000 ne m'a guère titillé. Elle est même totalement passée lorsque j'ai jeté un œil sur la masse de disques qu'il m'aurait fallu soupeser et écarter.

Cependant, en balayant des yeux ma discothèque, j'en ai tiré cette série de noms qui m'ont accompagné durant ces dix dernières années, qui ont compté à un moment ou à un autre - que cet attachement tienne à un seul disque ou à la totalité de leur production-, et qui me tiennent toujours à cœur aujourd'hui :
Dominique A - Arcade Fire - At the Drive-in - Badly Drawn Boy - Bonnie 'Prince' Billy - Camille - Cat Power - Manu Chao - The Dandy Warhols - Expérience - Franz Ferdinand - PJ Harvey [*] - Hot Hot Heat - Interpol - The Kills - Kings of Convenience - Lambchop - Sondre Lerche - Lift to Experience - The Little Rabbits - M83 - Mendelson - Mogwai - Stina Nordenstam - Programme - Radiohead - Hope Sandoval - Smog - Sonic Youth - Sufjan Stevens - The Strokes - Vampire Weekend - Vitesse - The White Stripes
Et s'il ne fallait en garder qu'un ([*] à côté d'Elle), ce serait lui, ce James Murphy qui, entre l'enchaînement génial de morceaux imparables et l'affichage d'un "non-look" salutaire, représente un peu mes Pixies de l'an 2000 :
(Johnnie To / Hong-Kong / 2003)
■■■□
 PTU, c'est l'espace, la durée (le temps), la surprise (le contretemps).
PTU, c'est l'espace, la durée (le temps), la surprise (le contretemps).
A l'arrière d'un véhicule blindé se font face deux rangées de policiers. Ensuite, se déroule sous nos yeux l'un de ces morceaux de bravoure dont Johnnie To est coutumier, morceaux qui ne s'annoncent pourtant pas d'entrée comme tels. Quatre marlous font la loi au restaurant, forçant l'un des clients à changer de table. Le jeu est classique, binaire, et pourrait s'arrêter là. Un troisième intervenant entre pourtant en scène, produisant un nouveau bouleversement jusqu'à ce qu'un équilibre triangulaire soit trouvé, ponctué visuellement par un plan d'ensemble. S'arrêter pour de bon, cette fois-ci ? Non, le triangle éclate à son tour, de manière totalement inattendue, en renversant les rapports de force instaurés jusque là.
Il y a, dans le cinéma de Johnnie To, une jouissance de l'espace. PTU est tourné en format large (2,35:1) et l'horizontalité y est accentuée : marche le long des rues, trottoirs, files de voitures, panneaux publicitaires et duel final en position allongée. Néanmoins, les bords du cadre, sans qu'ils soient négligés, sont souvent plongés dans le noir et le regard se concentre sur les points lumineux du centre. L'œil est attiré par ce qui s'arrache à la pénombre : le téléphone portable sous film plastique, le pistolet au milieu des détritus, les torches dans l'escalier et bien sûr les visages.
Le récit se concentrant sur quelques heures, PTU nous convie à une virée nocturne dans Hong-Kong. Et il s'agit vraiment de sentir la nuit. Le montage alterne plans très larges et plans serrés, la caméra collant aux personnages pour mieux s'en éloigner aussitôt et insister sur leur solitude et leur engloutissement. L'ambiance sonore qui envahit une ville la nuit est aussi magistralement retranscrite avec ces sauts d'intensité, ces bruits lointains de moteur, ces plages de silence, ces ronronnements derrière les portes des boîtes de nuit. Par le suivi des déplacements, une fascinante topographie de la ville est détaillée. Mais si Johnnie To enseigne la géographie, son cours n'a rien de barbant, sous-tendu qu'il est par un fil ludique. Ainsi, un passage à tabac se déroule dans une salle de jeux vidéos, redoublant les concours de bastons virtuelles. Plus tard, après que de la techno soit parvenu aux oreilles dans la rue, à peine en sourdine, l'un des thèmes musicaux du film déboule au moment où l'on lit le mot "Music" sur une enseigne.
De nombreux personnages répartis en différents groupes se croisent. Du côté de l'ordre, ils font partie d'une unité de police mobile, de l'antigang ou de la brigade criminelle. De l'autre côté de la frontière de la loi, on distingue trois gangs. Entre les deux, des indics et des petites frappes locales. L'intrigue se résume en quelques mots : un inspecteur a perdu son arme de service et la recherche toute la nuit, avec l'aide du responsable d'une petite brigade. Des personnages principaux, nous saurons très peu de chose sinon quelles relations ils semblent entretenir entre eux. Ce qui nous est montré, avant tout, ce sont leurs trajectoires dans la nuit. De cette façon, Johnnie To débarasse le film choral de ses lourdeurs habituelles, n'en gardant que le squelette. L'écheveau est compliqué à souhait mais il tient grâce à des croisements très simples et toujours surprenants. Cet étonnement étant quasiment généré par chaque fin de séquence (la "résurrection" du voyou tabassé en est l'exemple le plus parlant), tous les brusques virages pris par le récit deviennent acceptables.
Chose très caractéristique du cinéma de Johnnie To, la surprise peut aussi venir du report d'un événement narratif, au point que le cinéaste puisse parfois paraître se complaire dans l'étirement gratuit des séquences. Celles-ci (à l'image de celle où les policiers montent un à un les escaliers d'un immeuble) n'ont d'abord pour elles que leur attrait esthétique ou leur modulation rythmique. Elles ne servent à rien, pourrait-on dire... jusqu'à ce qu'en bout de course, l'intérêt du chemin parcouru pour arriver à telle composition ou telle ponctuation devienne évident.
Tant de virtuosité, tant de jeux formels et narratifs : cela pourrait lasser. Or il n'en est rien (PTU est, pour moi, sur bien des points, un anti-Collateral). Le plaisir est intense, tenant aussi à l'idée de troupe d'acteurs (incarnant des personnages qui sont poussés à agir avant de discourir), à celle de retrouvailles de film en film. Même dans le désordre, il est assez jubilatoire de piocher dans la pléthorique filmographie de Johnnie To (24 longs-métrages rien que pour les dix dernières années). Personnellement, j'ai pu, entre l'ébouriffante découverte de The mission en 2001 et celle d'hier soir, cocher sur la liste Breaking news, Fulltime killer et les deux volets d'Election, avec le même enthousiasme.
(Jean-Marie Straub et Danièle Huillet / Allemagne / 1963 & 1965)
■■■□ / ■■■□
 Machorka-Muff est un court-métrage de 16 minutes, le premier film du couple Straub-Huillet. Il est présenté, par un carton, comme "un rêve symboliquement abstrait, pas une histoire". Ce rêve, c'est celui d'Oberst Erich von Machorka-Muff, un général allemand attendant avec impatience la reprise en main du pays par un pouvoir militaire lavé de l'affront de 39-45. Frappent déjà dans ce premier geste cinématographique un art du montage déconcertant, ainsi qu'une organisation extrêmement rigoureuse des plans (y compris pour ce qui est des scènes d'extérieurs, qui ne jurent absolument pas au milieu des autres).
Machorka-Muff est un court-métrage de 16 minutes, le premier film du couple Straub-Huillet. Il est présenté, par un carton, comme "un rêve symboliquement abstrait, pas une histoire". Ce rêve, c'est celui d'Oberst Erich von Machorka-Muff, un général allemand attendant avec impatience la reprise en main du pays par un pouvoir militaire lavé de l'affront de 39-45. Frappent déjà dans ce premier geste cinématographique un art du montage déconcertant, ainsi qu'une organisation extrêmement rigoureuse des plans (y compris pour ce qui est des scènes d'extérieurs, qui ne jurent absolument pas au milieu des autres).
Plutôt qu'une violente provocation, Straub et Huillet lancent un défi ironique. Quand Godard, trois ans auparavant, fonce bille en tête, se moquant bien de perdre en route certains de ses spectateurs ("Allez vous faire foutre !"), eux semblent avoir au contraire une haute estime de ceux qui reçoivent leur discours. La confiance qu'ils ont dans la capacité de ces derniers à saisir tous les enjeux de leur récit est parfois excessive (certains éléments restent obscurs) mais gratifiante.
Une absurdité, un humour grinçant et discret, jamais placé au premier plan mais souvent présent, enrobent cette présentation de la journée d'un militaire. Des coupures de journaux posent le contexte, celui d'un appel au réarmement de l'Allemagne, à la réintégration de ses cadres, à l'évacuation d'un passé dans lequel Hitler ferait à peine figure de malencontreux accident, tout cela avec la bénédiction de l'Eglise. Les cinéastes ont fait de leur général un homme parfaitement moderne : un séducteur entre deux âges portant impeccablement le costume et la cravate, se fondant avec aisance dans l'agitation de la rue, comme il évolue au milieu de l'architecture futuriste de son ministère. Le fantastique, voire la science-fiction, ne sont pas loin et Machorka-Muff sonne comme une vigoureuse mise en garde.
 Les qualités du premier ouvrage des Straub se retrouvent dans le deuxième, rendues plus évidentes encore par l'élargissement du champ historique considéré et la plus grande durée (Non réconciliés va jusqu'à 49 minutes). Le soin apporté à la forme impressionne là aussi mais, à nouveau, une attention très soutenue est demandée. La compréhension du récit nécessite en effet, à la première vision, un effort certain.
Les qualités du premier ouvrage des Straub se retrouvent dans le deuxième, rendues plus évidentes encore par l'élargissement du champ historique considéré et la plus grande durée (Non réconciliés va jusqu'à 49 minutes). Le soin apporté à la forme impressionne là aussi mais, à nouveau, une attention très soutenue est demandée. La compréhension du récit nécessite en effet, à la première vision, un effort certain.
Les dialogues sont dits par des voix monocordes. Des propos de première importance sont enoncés mais sans émotion visible. En écho, la mise en scène vise l'épure visuelle tout en se rechargeant continuellement de significations. Chaque plan semble vibrer sous l'effet de quelque chose qui le dépasse. C'est la culture ou bien sûr l'Histoire, sujet premier du film. C'est la société qui vit dans le hors-champ du défilé ou qui est captée par un travelling circulaire au bas d'un immeuble.
Les séquences s'empilent les unes sur les autres et l'on a tendance à oublier, à recouvrir en partie des noms, des images ou des visages. Nos raccords ne se font pas facilement. Cependant, chaque plan est riche de ce qui l'a précédé et malgré le brouillard relatif dans lequel se déroule le récit, l'intérêt ne s'évapore pas. Les personnages sont assez nombreux et, leurs apparitions se limitant parfois à quelques secondes, sont réduits à des figures. Leurs différences de statut n'implique pas une modulation de la mise en scène. Peu importe que leur rôle narratif soit décisif ou pas : du barman au général, tous se trouvent au centre de la représentation. Choix d'égalité, déstabilisant pour le spectateur mais permettant au film d'accéder à une ampleur insoupçonnée.
S'attachant au parcours d'une famille allemande sur une cinquantaine d'années (des prémices de la première guerre mondiale aux années 60), Non réconciliés propose moins un va-et-vient temporel qu'une progression où se mêlent inextricablement le passé et le présent. La narration se déploie en flash-backs qui y ressemblent si peu, rien ne les distinguant vraiment du reste, du point de vue du style. Seuls un habit, un élément du décor ou une phrase signalent leur nature. Ainsi, le propos du film est idéalement relayé par la mise en scène : 1914 ou 1962, les mêmes peurs et les mêmes dangers guettent l'Allemagne.
Devant Non réconciliés, on pense au Fritz Lang américain et aux fantômes du muet (cette étrange femme qui répète : "Quel imbécile cet Empereur"), tout en se disant que cet objet assez passionnant, ne serait-ce que dans sa réflexion sur l'Histoire, est éminemment personnel et cohérent. Sa complexité et sa brièveté incitent à le revoir.
Suite du flashback.

 1981 : Aux Cahiers, les regards se tournent vers l'Orient : Bonitzer écrit sur Mizoguchi, un dossier Inde et Chine(s) paraît en février, Lino Brocka est interviewé. Au cours de l'année, sont proposés des entretiens avec Kubrick, David Lynch (Eraserhead et Elephant man), Fassbinder (Lili Marleen et Berlin Alexanderplatz), Zulawski (Possession), Rivette, Oliveira, Bertolucci, et des hommages sont rendus à Glauber Rocha et Jean Eustache. A l'occasion des trente ans de la revue, deux numéros spéciaux sont consacrés au cinéma français. Assayas parle de Lucas et Spielberg. Serge Toubiana devient seul rédacteur en chef, Charles Tesson entre au comité de rédaction et la signature de Michel Chion apparaît.
1981 : Aux Cahiers, les regards se tournent vers l'Orient : Bonitzer écrit sur Mizoguchi, un dossier Inde et Chine(s) paraît en février, Lino Brocka est interviewé. Au cours de l'année, sont proposés des entretiens avec Kubrick, David Lynch (Eraserhead et Elephant man), Fassbinder (Lili Marleen et Berlin Alexanderplatz), Zulawski (Possession), Rivette, Oliveira, Bertolucci, et des hommages sont rendus à Glauber Rocha et Jean Eustache. A l'occasion des trente ans de la revue, deux numéros spéciaux sont consacrés au cinéma français. Assayas parle de Lucas et Spielberg. Serge Toubiana devient seul rédacteur en chef, Charles Tesson entre au comité de rédaction et la signature de Michel Chion apparaît.Janvier : Le salon de musique (Satyajit Ray, Cahiers du Cinéma n°319) /vs/ Eugenio (Luigi Comencini, Positif n°238)
Mars : Raging Bull (Martin Scorsese, C321) /vs/ Un étrange voyage (Alain Cavalier, P240)
Avril : La femme de l'aviateur (Eric Rohmer, C322) /vs/ Raging Bull (Martin Scorsese, P241)
Mai : Situation du cinéma français (I) (C323-324) /vs/ Excalibur (John Boorman, P242)
Juin : Situation du cinéma français (II) (C325) /vs/ Show bus (Jerry Schatzberg, P243)
Eté : Haut les mains (Jerzy Skolimowski, C326) /vs/ Décor de Max Douy pour Marguerite de la nuit de Claude Autant-Lara (P244-245)
Septembre : Le Pont du Nord (Jacques Rivette, C327) /vs/ La porte du Paradis (Michael Cimino, P246)
Octobre : La femme d'à côté (François Truffaut, C328) /vs/ Stalker (Andreï Tarkovski, P247)
Novembre : La tragédie d'un homme ridicule (Bernardo Bertolucci, C329) /vs/ La tragédie d'un homme ridicule (Bernardo Bertolucci, P248)
Décembre : Francisca (Manoel de Oliveira, C330) /vs/ Popeye (Robert Altman, P249)
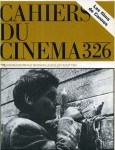

A suivre...
Sources : Calindex & Cahiers du Cinéma
(Clint Eastwood / Etats-Unis / 2009)
■■□□
 Lors de "leur" coupe du monde de rugby, qui arrivait, en 1995, trois ans après la fin du boycott international consécutif à la politique d'apartheid, l'Afrique du Sud a commencé par un coup d'éclat en battant l'Australie (27-18), ce qui leur assura un quart de finale facile (les deux autres matchs de poule n'étant qu'une formalité, contre la Roumanie [21-8] et le Canada [20-0]). Au stade suivant, les Samoa ne pesèrent effectivement pas bien lourd et s'inclinèrent 42 à 14. L'adversaire en demi-finale était d'un autre calibre puisqu'il s'agissait des Français. Les Springboks (surnom des locaux) gagnèrent 19-15 et eurent donc l'occasion de défier les All-Blacks, grands favoris du tournoi, en finale. Devant leurs supporters et leur président Nelson Mandela, ils réussissèrent l'exploit de l'emporter 15 à 12 (aucun essai ne fut marqué de part et d'autre).
Lors de "leur" coupe du monde de rugby, qui arrivait, en 1995, trois ans après la fin du boycott international consécutif à la politique d'apartheid, l'Afrique du Sud a commencé par un coup d'éclat en battant l'Australie (27-18), ce qui leur assura un quart de finale facile (les deux autres matchs de poule n'étant qu'une formalité, contre la Roumanie [21-8] et le Canada [20-0]). Au stade suivant, les Samoa ne pesèrent effectivement pas bien lourd et s'inclinèrent 42 à 14. L'adversaire en demi-finale était d'un autre calibre puisqu'il s'agissait des Français. Les Springboks (surnom des locaux) gagnèrent 19-15 et eurent donc l'occasion de défier les All-Blacks, grands favoris du tournoi, en finale. Devant leurs supporters et leur président Nelson Mandela, ils réussissèrent l'exploit de l'emporter 15 à 12 (aucun essai ne fut marqué de part et d'autre).
Si l'Afrique du Sud créa la surprise, elle n'arrivait toutefois pas de nulle part, étant, depuis longtemps, une grande nation de rugby. Elle est considérée comme la troisième meilleure équipe de l'hémisphère sud, derrière la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Cependant, il me semble qu'elle a l'image d'une équipe de qualité mais rarement géniale (les véritables connaisseurs me contrediront peut-être car je suis en effet plus compétent en ballon rond qu'ovale) .
Et bien le film d'Eastwood a les mêmes caractéristiques, collant par-là parfaitement à son sujet. Le jeu est sans surprise mais c'est solide, ça avance, ça défend remarquablement bien et ça joue au pied (le cinéaste a l'honnêteté de faire dire à l'entraîneur des Springboks : "Nous n'aurons peut-être pas le plus beau jeu mais nous serons les mieux préparés physiquement"). En comparaison des autres équipes, on est loin du style imprévisible des Français (pour le meilleur et pour le pire : un jour Les herbes folles, l'autre Les regrets) et du train d'enfer néo-zélandais lancé vers la modernité (Peter Jackson ?).
On ne s'embarrasse donc pas de fioritures. Pour la dramaturgie, la menace All-Black se réduit à la figure de Jonah Lomu. Mais après tout, pour la plupart des gens, le quinze de France d'aujourd'hui se limite à Sébastien Chabal. Même chez les pros, si l'on change momentanément de sport pour parler football, on se demande d'abord, lorsque l'on va jouer en Champions League contre Barcelone, comment stopper Messi et, si l'on joue à Boulogne ou à Nice, on se dit que pour avoir une chance de battre les Girondins, il faut avant tout museler Gourcuff. Eastwood, comme beaucoup, croit en l'homme providentiel, au guide de la nation. Sa vision de la démocratie intègre la notion de leader indiscuté (avec les risques que cela implique).
L'homme politique au destin hors du commun, comme tout grand sportif, n'oublie pas cependant les fondamentaux. Dans Invictus, les meilleures scènes sont les plus simples et les plus posées, celles, par exemple, des conversations entre Mandela et le capitaine des Springboks (Morgan Freeman et Matt Damon sont bons, crédibles). Eastwood sait tisser des relations entre les personnages. C'est un cinéaste des plans longs, pas un cinéaste de l'insert. Les plans de coupe qu'il place ici où là sont redondants et inutiles, qu'ils visent à accompagner le mouvement d'ensemble vers la réconciliation ou qu'ils servent de fausses pistes (les feintes de corps sont donc un peu téléphonées, dirons-nous).
Comme dans toutes les cérémonies d'avant-match, la musique du film est assez abominable et, au bout d'un récit plutôt agréable, dix minutes de rugby au ralenti (alors que le jeu n'était, jusque là, pas trop mal filmé malgré une football-américanisation excessive dans le rendu des chocs) et dix minutes de liesse populaire inter-raciale nous font piquer du nez. En revanche, la description d'un usage politique du sport intéresse, la représentation de l'exercice du pouvoir est convaincante et le contrepoint sur l'équipe de garde du corps poussée vers la mixité est habile. L'aspect conventionnel d'Invictuspousse à en juger chaque élément constitutif en fonction de sa subtilité ou de sa grossièreté, à les mettre en balance. Au football, on parle de différence de buts. Elle est ici égale à zéro (autant de buts marqués que d'encaissés). Le Eastwood de 2010 est une équipe de milieu de tableau. Invictus, c'est le PSG.
J'ai lu quelque part ce commentaire lapidaire, écrit par un internaute déçu : "Les séquences de match n'ont rien à voir avec le rugby". Quant à vous, mes chers lecteurs, je vous entend déjà dire : "Cette note n'a rien à voir avec une critique de film". Et bien peu m'importe... Je reste, comme Clint Eastwood, Bernard Laporte ou Raymond Domenech, droit dans mes bottes.
(Patrice Chéreau / France / 2009)
■■■□
 Il est une poignée de cinéastes jadis portés aux nues (parfois à juste titre) et qui se retrouvent traités dorénavant avec dédain ou irritation par la critique et le public. Les deux cas les plus exemplaires sont ceux de Lars Von Trier et d'Emir Kusturica et il me semble que Patrice Chéreau a rejoint à son corps défendant ce petit groupe depuis quelque temps. Une conséquence étrange de ce retour de bâton est de me rendre paradoxalement ces artistes plus attachants et de faire naître en moi une certaine curiosité face à leurs nouveaux travaux. Cette envie, qui équivaut en fait à celle de tomber sur le fameux film "que-personne-n'aime-sauf-moi", n'est pas toujours, avouons-le, satisfaite au final (Ô Gabrielle, que tu fus pénible !).
Il est une poignée de cinéastes jadis portés aux nues (parfois à juste titre) et qui se retrouvent traités dorénavant avec dédain ou irritation par la critique et le public. Les deux cas les plus exemplaires sont ceux de Lars Von Trier et d'Emir Kusturica et il me semble que Patrice Chéreau a rejoint à son corps défendant ce petit groupe depuis quelque temps. Une conséquence étrange de ce retour de bâton est de me rendre paradoxalement ces artistes plus attachants et de faire naître en moi une certaine curiosité face à leurs nouveaux travaux. Cette envie, qui équivaut en fait à celle de tomber sur le fameux film "que-personne-n'aime-sauf-moi", n'est pas toujours, avouons-le, satisfaite au final (Ô Gabrielle, que tu fus pénible !).
Globalement très mal reçu à sa sortie, au début du mois de décembre (*), Persécution est un excellent Chéreau, auteur qui n'est à son meilleur niveau que lorsqu'il se coltine au contemporain et qu'il se borne à suivre un nombre restreint de personnages. Il nous fait rentrer cette fois-ci dans la tête de Daniel, jeune homme ayant une relation passionnée, distendue et tumultueuse avec la prénommée Sonia et se sentant harcelé par un "dingo" qui le suit partout et se déclare amoureux de lui. Si le film accroche dès le départ, notamment grâce à un saisissant prologue, les deux premiers empiètements du fou sur le territoire privé de Daniel, sensés apporter mystère et inquiétude, laissent sur un sentiment bizarre, celui que, encore une fois, Chéreau veut forcer sa nature. Fort heureusement, à l'image des apparitions suivantes du persécuteur, plus directes, le cinéaste revient tout de suite à ce qu'il sait faire le mieux : filmer des corps qui parlent.
Les dialogues de Persécution sont remarquables (le scénario est d'Anne-Louise Trividic et de Chéreau). Le registre est familier mais légèrement ré-haussé, de façon à couler naturellement et ne paraître ni trop anodin, ni trop superficiellement intellectualisé. Les mots sont surtout dits de manière extraordinaire. Entendre la logorrhée de Romain Duris est absolument fascinant, cela d'autant plus qu'elle se superpose à un prodigieux travail sur le corps, sur les postures, sur les vêtements. Voir jouer cet acteur, qui m'avait déjà totalement bluffé chez Audiard, m'a passionné. Son Daniel semble réfléchir à haute voix. Lui qui peut paraître verser dans la paranoïa laisse pourtant sortir toutes ses pensées, leur flot charriant nombre de contradictions mais ne manquant pas d'interpeller. A travers la complexe relation Daniel-Sonia, se dégage une réflexion profonde sur l'amour, sur la difficulté de l'amour, sur l'altérité, sur la différence fondamentale entre la présence et l'absence, sur l'emprise de l'un sur l'autre (cette relation doit bien sûr se voir en miroir de celle que tisse le fou avec Dianel, ce dernier s'introduisant d'ailleurs chez Sonia de la même façon que son persécuteur le fit chez lui).
Daniel se croit le centre du monde, ne cesse de regarder les gens, d'un regard qui juge. Le personnage aspire donc le film et tous ne se définissent que par rapport à lui et successivement, indépendamment les uns des autres. Il ne se consacre toujours qu'à une personne à la fois et lorsqu'il parle devant un groupe, son registre devient celui du monologue. Cette compartimentation des rapports par le personnage, qui peut être prise pour une tentative de voir plus clair dans un esprit tourmenté, Chéreau se garde bien de la réduire à un procédé : les amis et l'amoureuse se croisent bel et bien au bar, se connaissent, échangent, s'étonnant juste que Daniel ait si peu parlé de l'un(e) à l'autre. L'exploration est donc poussée et on l'attend violente (Persécution se pose parfois en petit frère de Keane, Chéreau ayant apparemment beaucoup d'estime pour Lodge Kerrigan). Cependant, la courbe ne prend pas la forme que l'on croit : nul crescendo, plutôt des larmes et une sorte d'apaisement.
Pour finir, sans insister sur l'interprétation (autour de Duris, la troupe est mémorable, Charlotte Gainsbourg en tête), rappelons que Chéreau est l'un des rares cinéastes français à savoir utiliser une source musicale et à savoir filmer une scène d'amour dans toute sa crudité et sa beauté.
(*) : On peut se reporter aux baromètres presse et spectateurs du site AlloCiné et à celui de l'Imdb qui, tous, donnent au film à peine la moyenne.
(Patty Jenkins / Etats-Unis / 2004)
■■□□
 Monster tente de se frayer un chemin sur un territoire bien encombré du cinéma américain, celui de la chronique criminelle. Pour retracer le parcours violent d'Aileen Wuornos, une fille se prostituant à l'occasion (afin de subvenir aux besoins du couple lesbien qu'elle formait avec la jeune Selby) et qui commit plusieurs meurtres de "clients", Patty Jenkins a emprunté à divers genres, ce qui donne à son ouvrage une équilibre précaire entre le road movie et le film de serial killer, entre le cinéma indépendant US et le "véhicule" pour star.
Monster tente de se frayer un chemin sur un territoire bien encombré du cinéma américain, celui de la chronique criminelle. Pour retracer le parcours violent d'Aileen Wuornos, une fille se prostituant à l'occasion (afin de subvenir aux besoins du couple lesbien qu'elle formait avec la jeune Selby) et qui commit plusieurs meurtres de "clients", Patty Jenkins a emprunté à divers genres, ce qui donne à son ouvrage une équilibre précaire entre le road movie et le film de serial killer, entre le cinéma indépendant US et le "véhicule" pour star.
Le fait que les meurtres en série soient perpétrés par une femme assure l'originalité, redoublée par le choix de décrire le quotidien de ce singulier duo. L'ombre du Macadam cowboy de Schlesinger plane sur Monster, notamment à cause du travail qu'effectue Jenkins autour des oppositions corporelles, aspect sans doute le plus intéressant du film. Cette dimension physique est rendue par la mise en scène, proche des corps et organisant clairement les positions de chacun.
Cependant, si l'on se penche un peu plus sur le jeu des deux actrices principales, le sentiment est plus mitigé, surtout en ce qui concerne la "monstrueuse" performance d'une Charlize Theron grossie et enlaidie (à la clé, forcément : prix à Berlin, Golden Globe, Oscar et tutti quanti). Sans être insupportable, le maniérisme de son jeu ne manque pas de gêner ça et là. Travaillant son explosivité et sa nervosité, elle propose un énième dérivé des inventions du Pacino des années 70 (chez Lumet ou Schatzberg, références évidentes de Patty Jenkins). Sur la durée, Christina Ricci s'en sort un peu mieux.
La volonté de la cinéaste est évidemment de ne pas porter de jugement. Elle y parvient dans la première moitié, en se cantonnant à un naturalisme évitant les explications trop simples. Mais la tentation de juger refait pourtant surface. La façon dont sont traités les scènes des meurtres est en effet trop signifiante. Des sept crimes dont s'est rendue coupable Aileen Wuornos, nous n'en voyons que quatre. Les deux premiers punissent deux salauds (un violeur et un pédophile). Ensuite, un brave type est épargné au dernier moment. Les deux autres concernent deux gars "normaux" et ce sont ceux-là qui vont perdre Aileen. Le procédé est quelque peu facile et a tendance à rendre trop confortable un récit potentiellement vecteur de trouble, sinon de malaise.
(Edgar G. Ulmer / Etats-Unis / 1946)
■■■□
 Une bourgade de la région de Boston, au début du XIXème. Jenny est une petite fille pauvre, se débrouillant comme elle peut avec son ivrogne de père. Elle ne rêve que d'une chose : épouser un homme riche. Devenue une très belle femme, elle n'a pas beaucoup de mal à y parvenir. Elle se jettera successivement dans les bras du plus gros entrepreneur de la ville, de son fils et de son contremaître, les deux premiers y laissant la vie.
Une bourgade de la région de Boston, au début du XIXème. Jenny est une petite fille pauvre, se débrouillant comme elle peut avec son ivrogne de père. Elle ne rêve que d'une chose : épouser un homme riche. Devenue une très belle femme, elle n'a pas beaucoup de mal à y parvenir. Elle se jettera successivement dans les bras du plus gros entrepreneur de la ville, de son fils et de son contremaître, les deux premiers y laissant la vie.
Il est rare que l'on nous présente au cinéma une fillette aussi délibérement méchante. On voit lors du prologue du Démon de la chair (The strange woman) la petite Jenny jouer de façon douteuse avec la vie d'un camarade en le poussant dans la rivière alors qu'il ne sait pas nager puis mentir effrontément aux adultes affolés, jusqu'à se faire passer pour celle qui a sauvé le garçon de la noyade. Passé cet épisode, elle annonce solennellement à son père qu'elle finira bientôt par être très riche.
L'arrivisme éhonté du personnage et sa jouissance à réussir tout en provoquant la perte de ses proches sont ainsi posés dès le début et il sera, jusqu'à la fin, bien difficile de trouver le moindre signe d'infléchissement moral. Cette capacité à s'élever en piétinant les autres sans aucun scrupule est pour le spectateur assez fascinante. S'il nous arrive parfois de croire à la sincérité de quelques sanglots, sans doute parce que nous sommes conditionnés par les codes du mélodrame, en un clin d'œil, le double jeu de l'héroïne nous est ré-affirmé pour clore la séquence. Autre source d'étonnement : la jeune femme, sachant pertinemment ce qu'il faut faire pour devenir populaire, accumule les bonnes actions (dons à l'église, reprise d'une entreprise à l'abandon) pour mieux mener à bien sa conquète maladive du pouvoir. Très intelligemment, Ulmer filme les scènes de visites aux pauvres et aux malades sans dénoncer la "bienfaitrice", ce qui permet de préserver dans le récit une certaine ambiguïté.
Le scénario du Démon de la chairse rapproche par bien de aspects de celui du film de John Stahl, Pêché mortel(1945), ce qui est parfaitement logique lorsque l'on sait qu'un même romancier est à l'origine des deux récits : Ben Ames Williams. Hedy Lamarr est certes moins mystérieuse que Gene Tierney, ses variations de registre apparaissant plus tranchées. Mais ce très léger "sur-jeu" sied bien au film d'Ulmer. En effet, la qualité de l'œuvre est de ne rien cacher et de rester constamment honnête avec le spectateur. Il ne s'agit toutefois pas de rendre tout évident dès le premier plan : lorsqu'un personnage dissimule quelque temps un sentiment ou un projet, sa duperie ne doit pas paraître d'emblée au spectateur alors que ses interlocuteurs sont abusés. Des images (et des mots) du film naissent un fort effet de réalisme : actions suspendues, gestes et postures crédibles, mains qui se touchent (Jenny prend toujours l'initiative, à un moment ou à un autre, de poser la sienne sur celle de sa prochaine "proie", afin de mieux la troubler) et réactions sensées. Dans un genre très codé, ce soin apporté à la vraisemblance ménage une agréable surprise, quasiment pour chaque séquence, et de ce fait, la mise en scène d'Ulmer paraît aussi belle dans les moments de transition narrative que dans les temps forts et les passages obligés (fort bien réalisés, notamment en faisant passer la contraction du temps découlant d'une succession rapide d'événements par des articulations parfaites) . Le film, assez long, faiblit quelque peu sur le dernier tiers (Georges Sanders n'y est pas à son meilleur niveau) et Ulmer expédie son dénouement. Il n'en a pas moins réalisé là un excellent mélodrame.
(Roger Corman / Etats-Unis / 1962)
■■■□
 Écrire sur L'enterré vivant (Premature burial) est une torture. Il est en effet bien difficile d'en rendre compte sans en dévoiler la fin, qui remet brutalement en cause notre jugement sur le récit que l'on vient de nous conter (le film fait bien sûr partie du "cycle Edgar Poe" de Roger Corman). Marchons donc précautionneusement (d'autant plus que le brouillard est dense) et prenons les choses dans l'ordre.
Écrire sur L'enterré vivant (Premature burial) est une torture. Il est en effet bien difficile d'en rendre compte sans en dévoiler la fin, qui remet brutalement en cause notre jugement sur le récit que l'on vient de nous conter (le film fait bien sûr partie du "cycle Edgar Poe" de Roger Corman). Marchons donc précautionneusement (d'autant plus que le brouillard est dense) et prenons les choses dans l'ordre.
Guy Carrell vit avec sa sœur Kate dans le château familial et va bientôt se marier avec la douce Emily. Il se dit sujet à des crises de catalepsie et lutte contre la peur d'être un jour enterré vivant, comme il croit que son père l'a été. Malgré la présence à ses côtés de sa jeune épouse, Guy devient prisonnier de cette obsession (amplifiée qu'elle est par un traumatisme plus récent, présenté dans un formidable prologue), refusant de quitter sa demeure même pour un voyage de noces. Lui qui ne veut pas être enterré alors qu'il vit encore s'impose en fait une morbide claustration.
En accord avec l'habituelle économie Corman, il n'y a, dans le film, que deux lieux à arpenter : la grande bâtisse des Carrell et le vaste jardin. Dans la première, l'espace s'organise verticalement, de la crypte aux chambres, en passant par les salles de réception, et il est investi dans toute sa profondeur. Les reflets des miroirs creusent les plans, les perspectives s'étirent, les travellings avant suivent magnifiquement les personnages dans les couloirs, les montées et les descentes d'escaliers se succédent. A l'extérieur, là où la brume omniprésente et la végétation brouillent quelque peu les repères, le jardin se transforme en marais pour mener à un petit cimetière. Ici, la dynamique est horizontale, la progression des personnages étant accompagnée par une série de panoramiques et de travellings latéraux. La mise en scène (et une très belle photographie) fait vivre magistralement ces décors pourtant chargés de sens et de signes et rend sensible l'influence néfaste du lieu sur la psychologie du héros.
Dans son jardin, Guy va jusqu'à construire un caveau duquel divers mécanismes sophistiqués lui permettraient de "s'évader" au cas où ses amis l'y laisseraient pour mort alors qu'il ne l'est pas. La scène dans laquelle il détaille ces astuces devant Emily et son ami, le docteur Miles Archer, tous deux éberlués, mêle le comique et le pathétique. Elle semble sur le coup trop longue, presque laborieuse. Mais Corman nous en offre plus tard une remarquable variation, sous forme de cauchemar dans lequel Guy se retrouve pris au piège dans son propre caveau, activant des mécanismes qui refusent tous de fonctionner, dans une atmosphère de pourrissement généralisé. Comme lorsqu'il s'appuie sur le cliché du ciel orageux et zébré d'éclairs pour le décaler légèrement mais suffisamment (lors des séquences du mariage, le tonnerre semble dialoguer avec Guy), Corman navigue entre convention et singularité.
Nous en étions donc là, à apprécier le travail plastique et l'interprétation sans faille du quatuor formé par Hazel Court, Richard Ney, Heather Angel et Ray Milland (préféré par Corman, pour une fois, à un Vincent Price moins romantique et plus âgé), tout en n'arrivant pas tout à fait à partager l'angoisse du héros, en devinant un peu trop facilement quelle est la part respective de mystère inexplicable et de manipulation psychique probable, bref en étant porté vers un dénouement attendu et une explication sans surprise... Croyait-on...
Car s'opère soudain un renversement total. L'édifice se brise et s'affaisse en pliure sur tout ce qui avait été construit précédemment. Tout a changé. Les actions deviennent violentes et les mouvements rapides. Guy Carrell est toujours vivant mais n'est plus tout à fait le même (y compris physiquement). Miles, le scientifique, perd totalement pied. Et en un instant, Emily libère un érotisme à couper le souffle, chevelure flamboyante tombant sur ses épaules nues et dents prêtes à croquer. Tout est retourné. La vengeance n'est pas verbalisée, elle est mise en forme, en espace. Guy s'est extrait de son cercueil et y fait basculer quelqu'un d'autre, avant de tomber, lui aussi, mais du côté opposé, à la renverse. Deux trépas. Et un être en peine au-dessus de chaque victime. Tout est à reconsidérer. Il faut, dans l'urgence, ré-interpréter tous les indices, revenir sur les éléments du récit les plus anodins. Le film est fini, Corman m'a bien eu.