
****
Dans les premières minutes de Hadewijch, il y a ce plan montrant l'héroïne prier dans sa chambre, au couvent. Elle est agenouillée et prend appui sur son lit placé contre le mur. Elle est cadrée de dos mais l'axe est assez décalé pour que l'on voit aussi la fenêtre sur la droite. A travers la vitre nous remarquons que la levée par une grue d'une lourde palette s'arrête soudain, laissant la charge en suspension le temps du recueillement de la jeune femme, pour ne reprendre son mouvement qu'à l'instant où cette dernière se redresse.
Je ne comprends pas ce plan. Certes, je sens bien qu'il visualise peut-être la diffusion d'une aura, celle de cette jeune Hadewijch/Céline (selon que l'on utilise son prénom de novice ou celui de l'état civil), une fille qui veut ne laisser sa vie et son corps qu'entre les mains du Christ. Sans doute, commence-t-il aussi à tisser un lien entre deux parcours destinés à se rejoindre (celui d'Hadewijch et celui de l'ouvrier travaillant dans la cour du couvent). Mais vraiment, je ne comprends pas pourquoi il a été conçu comme cela, pourquoi il cherche à nous dire les choses de cette façon...
Le problème que m'a posé le dernier film en date de Bruno Dumont est de taille car le plan que je viens de décrire n'est pas une exception, il est symptomatique : tous ceux qui l'accompagnent, ou presque, m'ont laissé aussi perplexe. L'auteur de La vie de Jésus est un adepte de la mise en scène frontale, captant sans apprêt des types taillés à la serpe et supposés imposer ainsi leur présence irréfutable. Or lorsqu'il montre ici un Arabe voler un scooter dès qu'il le peut, insulter les automobilistes et provoquer des accidents sans s'en soucier, on tique et on s'inquiète quelque peu. Devant ces réticences, Dumont répondrait certainement : "Mais je ne vais pas m'empêcher de filmer ces choses qui existent. Elles sont là, présentes, évidentes". Nous serions d'accord, à la condition de ne pas en faire un cliché et de ne pas les faire suivre par d'autres clichés encore, mais il se trouve que devant sa caméra, et compte tenu de son style de mise en scène très particulier, "une" vérité devient "la" vérité. Dans Hadewijch, nous ne nous sommes pas en compagnie de personnages incarnés mais devant la Racaille, le Terroriste, la Sainte, le Ministre, la Bourgeoise et l'Ouvrier. L'idée prend toute la place et les acteurs ont toutes les peines du monde à s'arracher à la pesanteur de leurs caractères. Il est dès lors extrêmement difficile de ne pas voir dans ce film l'histoire d'une petite catholique qui se frotte à la délinquance puis au terrorisme islamique à cause de ses amis Arabes et qui revient à la vraie vie grâce à un Français issu du bon peuple.
Sans aller jusqu'à accuser Dumont d'irresponsabilité, je trouve qu'il se dédouane trop aisément de ce qu'il filme. Ce n'est pas qu'il laisse le spectateur se positionner lui-même, c'est qu'il le laisse se débrouiller tout seul avec les images politiquement ambigües qu'il donne à voir. Je soupçonne le cinéaste de s'être dit : "Les gens vraiment intelligents sauront prendre du recul et faire la part des choses. Pour ce qui est des autres, ce n'est pas mon problème..."
Hadewijch m'a donc mis assez mal à l'aise (ce qui est, il est vrai, parfois mieux que de susciter l'indifférence) et tout ce qui peut éventuellement échapper au trouble social et politique n'est selon moi guère plus convaincant. La présence/absence de Dieu, bien d'autres cinéastes l'ont interrogé avant Dumont, de manière plus inspirée et subtile. Le choix d'illuminer régulièrement le visage de la jeune Julie Sokolowski et, à certains moments, de projeter littéralement cette lumière émanant d'elle vers les décors qui l'entourent ne me paraît pas être un choix très heureux. Ce type d'effet, sans même revenir sur les clichés sociologiques évoqués plus haut, disqualifierait d'office tout film de cinéaste plus "populaire" que Dumont alors que celui-ci semble protégé par son statut d'auteur.
En repensant à l'impasse de Twentynine Palms, j'ai décidément l'impression que Bruno Dumont n'est à la hauteur de sa réputation de grand cinéaste français contemporain que lorsqu'il filme sa région, lorsqu'il pousse ses acteurs à incarner réellement des personnages qui lui sont familiers, lorsqu'il ne place pas la réflexion philosophique au premier plan, comme un écran. Lorsqu'il réalise donc La vie de Jésus, L'humanité ou Flandres.
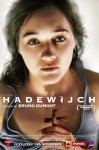 HADEWIJCH
HADEWIJCH
de Bruno Dumont
(France / 105 mn / 2009)


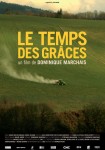 LE TEMPS DES GRÂCES
LE TEMPS DES GRÂCES
 AVATAR
AVATAR
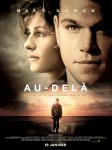 AU-DELÀ (Hereafter)
AU-DELÀ (Hereafter)
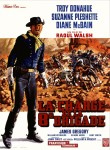 LA CHARGE DE LA 8ème BRIGADE (A distant trumpet)
LA CHARGE DE LA 8ème BRIGADE (A distant trumpet)
 SERBIS
SERBIS
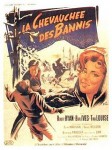 LA CHEVAUCHÉE DES BANNIS (Day of the outlaw)
LA CHEVAUCHÉE DES BANNIS (Day of the outlaw)
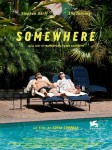 SOMEWHERE
SOMEWHERE
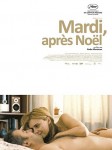 MARDI, APRÈS NOËL (Marti, dupa craciun)
MARDI, APRÈS NOËL (Marti, dupa craciun)
 DU PLOMB POUR L'INSPECTEUR (Pushover)
DU PLOMB POUR L'INSPECTEUR (Pushover)