En zappant, un soir d'été :
"- Eh, Papa, attend, on dirait Louis de Funès...
- Oui, c'est lui. C'est un film de la série du Gendarme de Saint-Tropez. Ils sont en train de la passer tout l'été, je crois. Un par semaine.
- Je veux les regarder !
- Oh, non...
- Allez, s'il te plait...
- Heu, de toute façon, c'est l'un des derniers celui-là. Il ne doit en rester qu'un ou deux après.
- Ça fait rien, laisse. Je veux le voir... et l'autre aussi la semaine prochaine.
- Bon, si tu veux... Mais je ne les regarde pas avec toi. Je vais faire autre chose à côté.
- Pourquoi ?
- Parce que je connais et je sais que ce n'est pas terrible.
- Mais c'est drôle !... Pffff... T'aimes jamais rien toi...
- Si : tu as vu que j'aimais bien la série de la Panthère Rose par exemple..."
*****
 Inutile de perdre du temps à évoquer les deux derniers Gendarmes, suivis du coin de l'œil, toujours aussi minables. Mais pour rester avec De Funès, on peut dire quelques mots d'Oscar. Si il est moins catastrophique dans sa réalisation et moins idiot dans son registre comique que les pitreries baclées par Jean Girault sous le soleil de Saint-Tropez, le film de Molinaro ne satisfait guère plus et rarement spectacle comique m'aura autant épuisé. Partant d'une pièce de théâtre de boulevard (adaptée pour l'occasion, entre autres, par De Funès lui-même, qui la joua plusieurs fois sur scène), le scénario accumule, en une seule journée et en un seul lieu, des surprises, des révélations, des tromperies et des méprises toutes plus improbables les unes que les autres. Cette succession effrénée (à chaque séquence son ou ses rebondissements) est rendue plus sensible encore par des choix de mise en scène visant à augmenter la vitesse du récit : claquements de portes, déplacements continus des personnages d'une pièce à l'autre, montage très sérré des actions, donnant l'impression que les acteurs déboulent dans le champ, voire qu'ils sont en avance sur le plan (on se demande par exemple, parfois, si Claude Rich quitte vraiment les lieux comme il est censé le faire en plusieurs occasions, avant de revenir). Cet emballement mécanique serait à la limite supportable si le fond n'était si déplaisant (médiocrité générale des caractères, misogynie et cupidité utilisés comme ressorts comiques essentiels) et surtout si il n'était pas ponctué toutes les dix secondes d'éclats de voix crispants dûs à De Funès, à Rich ou à la jeune Agathe Natanson qui, bien que légèrement vêtue, a l'hystérie horripilante. Le premier cité, attraction de tous les plans ou presque, est en colère de la première à la dernière scène. En caracolant ainsi, sans jamais atteindre une dimension absurde qui réhausserait le vaudeville de base, le film laisse les rares bons mots et les sympathiques trouvailles se faire oublier aussitôt, emportés qu'ils sont par le courant de ces échanges-mitraillette, de ces cris et de ces grimaces incessantes. Épuisant, vraiment.
Inutile de perdre du temps à évoquer les deux derniers Gendarmes, suivis du coin de l'œil, toujours aussi minables. Mais pour rester avec De Funès, on peut dire quelques mots d'Oscar. Si il est moins catastrophique dans sa réalisation et moins idiot dans son registre comique que les pitreries baclées par Jean Girault sous le soleil de Saint-Tropez, le film de Molinaro ne satisfait guère plus et rarement spectacle comique m'aura autant épuisé. Partant d'une pièce de théâtre de boulevard (adaptée pour l'occasion, entre autres, par De Funès lui-même, qui la joua plusieurs fois sur scène), le scénario accumule, en une seule journée et en un seul lieu, des surprises, des révélations, des tromperies et des méprises toutes plus improbables les unes que les autres. Cette succession effrénée (à chaque séquence son ou ses rebondissements) est rendue plus sensible encore par des choix de mise en scène visant à augmenter la vitesse du récit : claquements de portes, déplacements continus des personnages d'une pièce à l'autre, montage très sérré des actions, donnant l'impression que les acteurs déboulent dans le champ, voire qu'ils sont en avance sur le plan (on se demande par exemple, parfois, si Claude Rich quitte vraiment les lieux comme il est censé le faire en plusieurs occasions, avant de revenir). Cet emballement mécanique serait à la limite supportable si le fond n'était si déplaisant (médiocrité générale des caractères, misogynie et cupidité utilisés comme ressorts comiques essentiels) et surtout si il n'était pas ponctué toutes les dix secondes d'éclats de voix crispants dûs à De Funès, à Rich ou à la jeune Agathe Natanson qui, bien que légèrement vêtue, a l'hystérie horripilante. Le premier cité, attraction de tous les plans ou presque, est en colère de la première à la dernière scène. En caracolant ainsi, sans jamais atteindre une dimension absurde qui réhausserait le vaudeville de base, le film laisse les rares bons mots et les sympathiques trouvailles se faire oublier aussitôt, emportés qu'ils sont par le courant de ces échanges-mitraillette, de ces cris et de ces grimaces incessantes. Épuisant, vraiment.
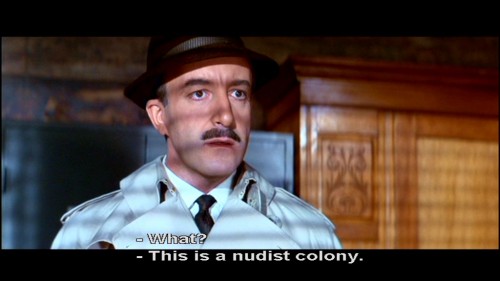
Débutant au même moment que celle des Gendarmes, la série de la Panthère Rose s'élève à des hauteurs inconnues de son concurrent français. Signalons tout d'abord que cette dernière a des limites assez fluctuantes, que le coffret dvd édité par la MGM en 2003 ne précise que très imparfaitement. Cinq épisodes y sont en effet compilés. Le septième, L'héritier de la Panthère Rose (Curse of the Pink Panther, 1983), et le huitième, Le fils de la Panthère Rose (Son of the Pink Panther, 1993, avec Roberto Benigni), n'y figurent pas. Ce n'est pas forcément une aberration puisque ce sont là des suites dans lesquelles nous ne pouvions pas retrouver, et pour cause, l'acteur principal de la série, Peter Sellers. Il faut noter, d'ailleurs, qu'elles n'ont, ni l'une ni l'autre, été distribuées en salles en France et qu'elles ont très mauvaise réputation (L'héritier de la Panthère Rose n'apparaissant même pas dans certaines filmographies de Blake Edwards). Beaucoup moins compréhensible, sauf à invoquer des problèmes de droits, est l'absence du troisième épisode, Le retour de la Panthère Rose (The return of the Pink Panther, 1975). Fort heureusement, le deuxième, Quand l'inspecteur s'emmêle (A shot in the dark, 1964) est présent... bien que, contrairement aux autres, ni son titre, ni son générique, ni son intrigue, ne mentionnent la Panthère Rose (le fameux animal dessiné qui devient en fait, dans les scénarios, un bijou). Se démarquant du premier mais imposant la plupart des thèmes comiques des suivants, cet opus est à la fois en dehors et en plein dedans. Vous suivez toujours ? Oui ? Alors je peux, afin d'être exhaustif, évoquer pour finir l'existence de L'infaillible Inspecteur Clouseau (Inspector Clouseau, 1968), un hors-série non signé par Edwards mais par Bud Yorkin et non interprété par Sellers mais par Alan Arkin, et celle des deux récents "remakes" ayant pour vedette Steve Martin (La Panthère Rose / The Pink Panther de Shawn Levy, 2006, et La Panthère Rose 2 / The Pink Panther 2 de Harald Zwart, 2009).
La Panthère Rose de 1963 est un mélange comique et plaisant, bien que parfois languissant, de burlesque, de policier et de romance. C'est en fait un véritable film choral qui montre une poignée d'escrocs internationaux de haut vol échaffauder tous les stratagèmes possibles destinés à dérober à une princesse orientale le plus beau bijou du monde, cela au nez et à la moustache d'un inspecteur de police français. Il est certain que Claudia Cardinale, en descendante de royale lignée skiant dans les Alpes, ne manque pas de charme mais son duo amoureux avec David Niven a tendance à traîner en longueur. Heureusement, le fil du récit subit à intervalles réguliers de salvatrices déflagrations dues à l'Inspecteur Jacques Clouseau. Portées par le génie burlesque de Peter Sellers, ces scènes se détachent nettement du reste. Quand il s'agit d'accompagner les gestes maladroitement destructeurs ou ridiculement emphatiques du personnage, d'orchestrer d'invraisemblables chassés-croisés dans une chambre d'hôtel (il s'agit de cacher deux amants au mari) ou d'organiser un délirant bal costumé dans un château, la mise en scène d'Edwards marche à merveille. Le ballet automobile final, réglé avec précision et dans un rythme parfaitement dosé, disqualifie toutes les productions franchouillardes à la Oury que l'on peut trouver à la même époque.
Quand l'inspecteur s'emmêle est, de loin, le meilleur film de la série, touchant au chef d'œuvre au même titre que The Party (1968), l'autre joyau du couple Edwards-Sellers. Le cinéaste ne garde de la première trame que le personnage de Clouseau. Celui-ci est chargé d'enquêter sur un meurtre commis dans la vaste demeure de Mr Ballon. La suspecte est la domestique Maria Gambrelli (Elke Sommer, à croquer), qui semble provoquer une mort violente dans chaque endroit où elle passe. Cependant, contre toute logique, Clouseau décide à chaque fois de la remettre en liberté, persuadé de son innocence. En simplifiant l'intrigue et en se concentrant sur la puissance comique de son acteur principal, Edwards réalise un ouvrage très cohérent, échappant aux ruptures de rythme qui handicapent les autres épisodes et provoquant l'hilarité d'un bout à l'autre (chaque séquence repose sur un ou deux gags qui fonctionnent idéalement). Peter Sellers est ici à son sommet, grandiose dans la maladresse, le geste avorté, raté, contrarié, et peut-être plus encore dans la réaction désinvolte ou d'une impeccable mauvaise foi. La scène de la confrontation dans le salon, organisée dans le but de démasquer l'assassin, atteint, grâce au travail de l'acteur, le burlesque le plus pur et rivalise dans l'invention corporelle avec l'extraordinaire final de Dr Folamour. Ajoutons que plusieurs figures imposées développées le long de la série trouvent leur origine ici : la folie du Commissaire Dreyfus, le supérieur de Clouseau, la séduction paradoxale qu'exerce ce dernier sur les belles femmes qu'il croise, son goût pour le travestissement et l'étrange contrat qui le lie à son serviteur Kato, chargé de l'attaquer à n'importe quel moment, de façon à l'aider à parfaire ses techniques de combat.
Quand la Panthère Rose s'emmêle est le plus référentiel du lot, le récit (et les génériques de début et de fin) étant parsemé de clins d'œil cinématographiques. La première moitié est assez éblouissante, qui retrace une irrésistible enquête londonienne de Clouseau. La reprise des motifs (l'armure, le pyjama, le kimono, les chambres) et des scènes-clés (réunion de suspects, flirts) s'accompagne de variations souvent brillantes. Peu à peu, toutefois, avec l'internationalisation de l'intrigue, les gags ont tendance à retomber et le virage effectué vers la parodie de science-fiction, avec machine à faire disparaître monuments et populations, n'est pas très heureux, ni en termes rythmiques, ni en termes esthétiques. Le grimaçant Herbert Lom, dans le rôle de Dreyfus, devient envahissant et le recours au déguisement devient la règle (Clouseau y recourait seulement en de brèves occasions dans le deuxième épisode et le voir guindé et satisfait dans son costume d'inspecteur était finalement beaucoup plus drôle). La farce s'alourdit donc, heureusement sauvée par la traversée impossible des douves du château par Clouseau et par son strip tease final.
La malédiction de la Panthère Rose faiblit de même à l'approche de son terme (une escapade cartoonesque à Hong Kong). Edwards et Sellers fatiguent quelque peu et les jeux sur le corps burlesque doivent ici beaucoup à Burt Kwouk (dans le rôle de Kato). Plusieurs passages réussis rendent le film encore appréciable (la rituelle et très longue scène d'entraînement-destruction, l'enquête du côté du port et du club privé, la remise de la médaille...).
A la recherche de la Panthère Rose est l'un des projets les plus singuliers qui soient. Réalisé deux ans après la mort de Peter Sellers, il fait pourtant apparaître amplement ce dernier à l'écran. Blake Edwards utilise en effet des scènes inédites résultant des précédents tournages, qu'il monte de façon à ce qu'elles s'intègrent à une nouvelle histoire de vol du diamant. Puis, il reprend quelques moments connus qu'il relie à une enquête menée auprès de plusieurs témoins par une journaliste, suite à l'annonce de la disparition en pleine mer de l'inspecteur. L'hommage du cinéaste à son acteur est touchant mais la construction du film est très faible. Les séquences exhumées se révèlent de bonne facture, ce qui rend le début agréable. Mais l'intérêt se dissout lorsque l'inévitable Dreyfus arrive au premier plan. Quand le troisième personnage principal débarque, en la personne de la journaliste, le récit n'avance plus, la jeune femme se contentant de récolter quelques souvenirs (on retrouve notamment David Niven endossant à nouveau, pour l'occasion, son rôle de Sir Charles créé pour le premier épisode). Ce patchwork, aussi sincère soit-il, ne fait malheureusement pas un film à part entière...
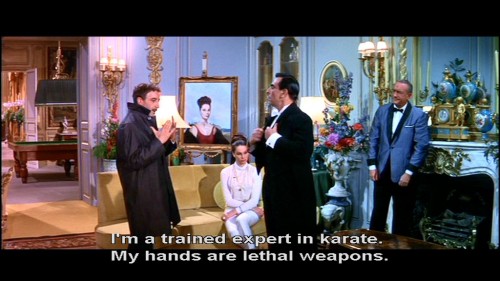
*****
Le gendarme et les extra-terrestres (Jean Girault / France / 1979) / □□□□ / Le gendarme et les gendarmettes (Jean Girault / France / 1982) / □□□□
Oscar (Edouard Molinaro / France / 1967) / □□□□
La Panthère Rose (The Pink Panther) (Blake Edwards / Etats-Unis / 1963) / ■■□□ / Quand l'inspecteur s'emmêle (A shot in the dark) (Blake Edwards / Etats-Unis - Grande-Bretagne / 1964) / ■■■■ / Quand la Panthère Rose s'emmêle (The Pink Panther strikes again) (Blake Edwards / Etats-Unis - Grande-Bretagne / 1975) / ■■□□ / La malédiction de la Panthère Rose (Revenge of the Pink Panther) (Blake Edwards / Etats-Unis - Grande-Bretagne / 1978) / ■■□□ / A la recherche de la Panthère Rose (Trail of the Pink Panther) (Blake Edwards / Etats-Unis - Grande-Bretagne / 1982) / ■□□□


 Revoir sur grand écran Les Vikings (The Vikings) c'est apprécier le savoir-faire technique de Richard Fleischer et son emploi efficace du Scope (des panoramiques sur les fjords aux gros plans sur les visages), c'est baigner dans les belles images de Jack Cardiff (en particulier lors des remarquables scènes de navigation dans la brume), c'est relever par endroits un louable souci d'authenticité (et un tournage en décors réels), c'est être saisi par quelques fulgurances stylistiques (les vigoureuses entrées dans le champ, les contre-plongées du duel final) et plusieurs pointes de sauvagerie (l'attaque du faucon, le jeu de la hache, la fosse aux loups, la main tranchée), c'est profiter des bonnes interprétations de Tony Curtis, d'Ernest Borgnine, de Janet Leigh et de Kirk Douglas, star et producteur, dont le personnage d'Einar, nous dit-on, refuse de se laisser pousser la barbe, à l'inverse de tous ses camarades vikings, mais se voit dans la foulée à moitié défiguré...
Revoir sur grand écran Les Vikings (The Vikings) c'est apprécier le savoir-faire technique de Richard Fleischer et son emploi efficace du Scope (des panoramiques sur les fjords aux gros plans sur les visages), c'est baigner dans les belles images de Jack Cardiff (en particulier lors des remarquables scènes de navigation dans la brume), c'est relever par endroits un louable souci d'authenticité (et un tournage en décors réels), c'est être saisi par quelques fulgurances stylistiques (les vigoureuses entrées dans le champ, les contre-plongées du duel final) et plusieurs pointes de sauvagerie (l'attaque du faucon, le jeu de la hache, la fosse aux loups, la main tranchée), c'est profiter des bonnes interprétations de Tony Curtis, d'Ernest Borgnine, de Janet Leigh et de Kirk Douglas, star et producteur, dont le personnage d'Einar, nous dit-on, refuse de se laisser pousser la barbe, à l'inverse de tous ses camarades vikings, mais se voit dans la foulée à moitié défiguré... En décembre 1937, dans la guerre qui l'oppose à la Chine, l'armée impériale japonaise remporte la bataille de Nankin. Après avoir massacré les soldats chinois fait prisonniers, elle commet pendant des semaines des atrocités sur les civils : viols collectifs, tortures, exécutions de masse... Le nombre de 300 000 morts est celui qui est le plus souvent avancé.
En décembre 1937, dans la guerre qui l'oppose à la Chine, l'armée impériale japonaise remporte la bataille de Nankin. Après avoir massacré les soldats chinois fait prisonniers, elle commet pendant des semaines des atrocités sur les civils : viols collectifs, tortures, exécutions de masse... Le nombre de 300 000 morts est celui qui est le plus souvent avancé. Impossible pour moi, à le découvrir aujourd'hui, de ne pas juger Infernal affairs (Mou gaan dou) à l'aune de son remake de 2006, Les infiltrés (à mon sens le meilleur Scorsese de la série Di Caprio en cours). Une simple donnée explique à elle seule la plupart des différences que l'on observe entre les deux œuvres : la durée des métrages. L'original, ramassé sur ses cent minutes, affiche à son compteur quasiment une heure de moins.
Impossible pour moi, à le découvrir aujourd'hui, de ne pas juger Infernal affairs (Mou gaan dou) à l'aune de son remake de 2006, Les infiltrés (à mon sens le meilleur Scorsese de la série Di Caprio en cours). Une simple donnée explique à elle seule la plupart des différences que l'on observe entre les deux œuvres : la durée des métrages. L'original, ramassé sur ses cent minutes, affiche à son compteur quasiment une heure de moins. Xavier Beauvois est tout de même un drôle de bonhomme. Voilà quelqu'un capable de signer à 24 ans un premier long-métrage assez impressionnant de sécheresse (Nord, 1991) avant de s'abîmer dans le pathos (N'oublie pas que tu vas mourir, 1995), puis, après un troisième essai que j'avais alors soigneusement évité (Selon Matthieu, 2000), de dresser un portrait anecdotique de la police française au travail (
Xavier Beauvois est tout de même un drôle de bonhomme. Voilà quelqu'un capable de signer à 24 ans un premier long-métrage assez impressionnant de sécheresse (Nord, 1991) avant de s'abîmer dans le pathos (N'oublie pas que tu vas mourir, 1995), puis, après un troisième essai que j'avais alors soigneusement évité (Selon Matthieu, 2000), de dresser un portrait anecdotique de la police française au travail ( Les deux précédents longs métrages de Lee Chang-dong, Oasis et
Les deux précédents longs métrages de Lee Chang-dong, Oasis et  Inutile de perdre du temps à évoquer les deux derniers Gendarmes, suivis du coin de l'œil, toujours aussi minables. Mais pour rester avec De Funès, on peut dire quelques mots d'Oscar. Si il est moins catastrophique dans sa réalisation et moins idiot dans son registre comique que les pitreries baclées par Jean Girault sous le soleil de Saint-Tropez, le film de Molinaro ne satisfait guère plus et rarement spectacle comique m'aura autant épuisé. Partant d'une pièce de théâtre de boulevard (adaptée pour l'occasion, entre autres, par De Funès lui-même, qui la joua plusieurs fois sur scène), le scénario accumule, en une seule journée et en un seul lieu, des surprises, des révélations, des tromperies et des méprises toutes plus improbables les unes que les autres. Cette succession effrénée (à chaque séquence son ou ses rebondissements) est rendue plus sensible encore par des choix de mise en scène visant à augmenter la vitesse du récit : claquements de portes, déplacements continus des personnages d'une pièce à l'autre, montage très sérré des actions, donnant l'impression que les acteurs déboulent dans le champ, voire qu'ils sont en avance sur le plan (on se demande par exemple, parfois, si Claude Rich quitte vraiment les lieux comme il est censé le faire en plusieurs occasions, avant de revenir). Cet emballement mécanique serait à la limite supportable si le fond n'était si déplaisant (médiocrité générale des caractères, misogynie et cupidité utilisés comme ressorts comiques essentiels) et surtout si il n'était pas ponctué toutes les dix secondes d'éclats de voix crispants dûs à De Funès, à Rich ou à la jeune Agathe Natanson qui, bien que légèrement vêtue, a l'hystérie horripilante. Le premier cité, attraction de tous les plans ou presque, est en colère de la première à la dernière scène. En caracolant ainsi, sans jamais atteindre une dimension absurde qui réhausserait le vaudeville de base, le film laisse les rares bons mots et les sympathiques trouvailles se faire oublier aussitôt, emportés qu'ils sont par le courant de ces échanges-mitraillette, de ces cris et de ces grimaces incessantes. Épuisant, vraiment.
Inutile de perdre du temps à évoquer les deux derniers Gendarmes, suivis du coin de l'œil, toujours aussi minables. Mais pour rester avec De Funès, on peut dire quelques mots d'Oscar. Si il est moins catastrophique dans sa réalisation et moins idiot dans son registre comique que les pitreries baclées par Jean Girault sous le soleil de Saint-Tropez, le film de Molinaro ne satisfait guère plus et rarement spectacle comique m'aura autant épuisé. Partant d'une pièce de théâtre de boulevard (adaptée pour l'occasion, entre autres, par De Funès lui-même, qui la joua plusieurs fois sur scène), le scénario accumule, en une seule journée et en un seul lieu, des surprises, des révélations, des tromperies et des méprises toutes plus improbables les unes que les autres. Cette succession effrénée (à chaque séquence son ou ses rebondissements) est rendue plus sensible encore par des choix de mise en scène visant à augmenter la vitesse du récit : claquements de portes, déplacements continus des personnages d'une pièce à l'autre, montage très sérré des actions, donnant l'impression que les acteurs déboulent dans le champ, voire qu'ils sont en avance sur le plan (on se demande par exemple, parfois, si Claude Rich quitte vraiment les lieux comme il est censé le faire en plusieurs occasions, avant de revenir). Cet emballement mécanique serait à la limite supportable si le fond n'était si déplaisant (médiocrité générale des caractères, misogynie et cupidité utilisés comme ressorts comiques essentiels) et surtout si il n'était pas ponctué toutes les dix secondes d'éclats de voix crispants dûs à De Funès, à Rich ou à la jeune Agathe Natanson qui, bien que légèrement vêtue, a l'hystérie horripilante. Le premier cité, attraction de tous les plans ou presque, est en colère de la première à la dernière scène. En caracolant ainsi, sans jamais atteindre une dimension absurde qui réhausserait le vaudeville de base, le film laisse les rares bons mots et les sympathiques trouvailles se faire oublier aussitôt, emportés qu'ils sont par le courant de ces échanges-mitraillette, de ces cris et de ces grimaces incessantes. Épuisant, vraiment.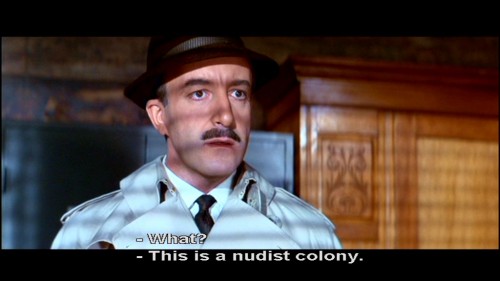
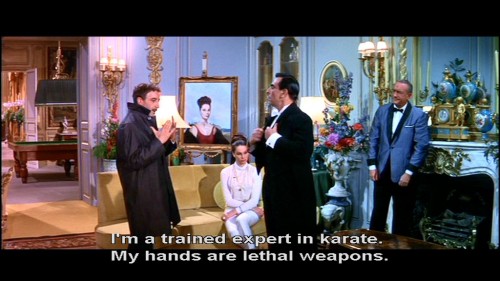
 Avec La révélation, titre français passe-partout remplaçant le Storm original mais pas forcément plus approprié, Hans-Christian Schmid a eu le mérite de se frotter à un sujet politique actuel et complexe. Développer une fiction à partir de l'activité d'une institution comme le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie n'est pas chose aisée. Le cinéaste allemand le fait sans complaisance vis à vis des magistrats y exerçant leur métier, n'hésitant pas à évoquer leur lassitude, la tentation des petits arrangements et, plus généralement, la difficulté à résister au pragmatisme politique international qu'impose, entre autres choses, la construction européenne. Tourné en 2008, le film entre en résonance avec le procès Slobodan Milosevic et l'arrestation de Radovan Karadzic et tente d'accompagner les réflexions autour de la place à donner à la Serbie dans l'U.E. Pour étoffer sa base documentaire, que l'on sent très travaillée en amont, Schmid brosse le portrait de deux femmes, l'une, véritable héroïne de cette histoire, procureure à La Haye, l'autre, victime de la guerre de Bosnie, et donne à son film l'apparence d'une enquête policière dont l'aboutissement est censé interroger les notions de responsabilité individuelle et de droiture morale.
Avec La révélation, titre français passe-partout remplaçant le Storm original mais pas forcément plus approprié, Hans-Christian Schmid a eu le mérite de se frotter à un sujet politique actuel et complexe. Développer une fiction à partir de l'activité d'une institution comme le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie n'est pas chose aisée. Le cinéaste allemand le fait sans complaisance vis à vis des magistrats y exerçant leur métier, n'hésitant pas à évoquer leur lassitude, la tentation des petits arrangements et, plus généralement, la difficulté à résister au pragmatisme politique international qu'impose, entre autres choses, la construction européenne. Tourné en 2008, le film entre en résonance avec le procès Slobodan Milosevic et l'arrestation de Radovan Karadzic et tente d'accompagner les réflexions autour de la place à donner à la Serbie dans l'U.E. Pour étoffer sa base documentaire, que l'on sent très travaillée en amont, Schmid brosse le portrait de deux femmes, l'une, véritable héroïne de cette histoire, procureure à La Haye, l'autre, victime de la guerre de Bosnie, et donne à son film l'apparence d'une enquête policière dont l'aboutissement est censé interroger les notions de responsabilité individuelle et de droiture morale.
 Le Britannique Michael Winterbottom est un réalisateur moyen, dont les résultats oscillent entre le pas terrible et le pas mal, du moins pour ce que j'en sais, celui-ci tenant en effet une cadence de production impressionnante et difficile à suivre (une vingtaine de titres accumulés depuis le début des années 90). Précédé d'une légère odeur de souffre, essentiellement due à la sauvagerie de quelques meurtres (notre homme aimant se faire parfois provocateur comme lorsqu'il réalisa ce 9 songs alternant scènes de sexe et captations de performances rock, expérience au final plus ennuyeuse qu'autre chose, si l'on en croit la très grande majorité des spectateurs y ayant goûté), The killer inside me ne change en rien la position du cinéaste, ce dernier opus en date, bien que s'assurant l'une des meilleures places au sein de la filmographie, drainant en quantités égales qualités et défauts, habiletés et maladresses.
Le Britannique Michael Winterbottom est un réalisateur moyen, dont les résultats oscillent entre le pas terrible et le pas mal, du moins pour ce que j'en sais, celui-ci tenant en effet une cadence de production impressionnante et difficile à suivre (une vingtaine de titres accumulés depuis le début des années 90). Précédé d'une légère odeur de souffre, essentiellement due à la sauvagerie de quelques meurtres (notre homme aimant se faire parfois provocateur comme lorsqu'il réalisa ce 9 songs alternant scènes de sexe et captations de performances rock, expérience au final plus ennuyeuse qu'autre chose, si l'on en croit la très grande majorité des spectateurs y ayant goûté), The killer inside me ne change en rien la position du cinéaste, ce dernier opus en date, bien que s'assurant l'une des meilleures places au sein de la filmographie, drainant en quantités égales qualités et défauts, habiletés et maladresses. Le grand retour de Blier ? Mon cul, oui !
Le grand retour de Blier ? Mon cul, oui !