
Le film commence dans une agitation toute dardennienne, captée par une caméra collée à un gamin fouillant dans des sacs et des vêtements de touristes skieurs, mais son intérêt ne se limite pas à sa portée réaliste, loin de là. L'enfant d'en haut, son titre le dit assez, repose sur la notion d'espace. Un espace qui est clairement délimité : en bas la vallée, en haut les pistes de ski, et entre les deux ce qui permet le passage. Bien sûr, cette façon de décrire ces lieux séparés s'accompagne d'une vision sociale : en haut les riches vacanciers de différentes nationalités glissent et bronzent en se foutant bien que quelqu'un leur vole leurs affaires puisqu'ils peuvent en acheter d'autres aussitôt (c'est le petit voleur qui le dit) tandis qu'en bas les pauvres vivotent dans des tours, illusions d'une élévation.
La réussite de L'enfant d'en haut tient à son équilibre tenu entre ce symbolisme et ce réalisme. Ursula Meier soumet ainsi le quotidien, peu enviable, à de légères dérives menant quelques fois aux abords du conte, ce qui assure aux séquences un déroulement inattendu. Du côté social donc, nous notons la circulation incessante de l'argent et la reconduction de rapports de dépendance entre les personnes, très bien rendues. De l'autre, nous remarquons une mise en scène très centrée, au point d'être exclusive, à la limite de la vraisemblance. L'enfant, dont le regard guide le nôtre, est toujours seul lorsqu'il effectue ses passages d'un endroit à l'autre (il déroge une seule fois à cette règle et, bien sûr, des ennuis en découlent, qui lui font sentir à quel point il représente un déchet pour cette société voulant garder sa poudreuse immaculée). Sa sœur, par exemple, ne monte pas là haut (pas de nom de lieu ici, on dit habiter "en bas"), préférant voyager "à l'horizontale". On est surpris également de ne croiser aucune figure d'autorité parentale ni même institutionnelle. A nouveau, cette absence a moins une valeur de constat, représente moins une volonté de pointer une carence, qu'elle n'instaure une certaine étrangeté. Si l'inquiétude de la chute du couperet au-dessus du petit voleur est toujours présente lors de ses larcins, il y a aussi l'intuition que quelque chose de plus existe, qu'une dimension autre élève au dessus du réalisme noir et de son fatalisme.
Tout ceci est rendu possible par la capacité qu'a la cinéaste d'établir un cadre et de le rendre expressif sans vouloir à tout prix imposer la belle image. Mais je retiens surtout son travail sur le son, dans tous les sens du terme. C'est le bruit des télécabines qui impressionne par l'alternance entre le silence (suspension temporelle et spatiale) et le vacarme des câbles et poulies au passage de chaque pylône. C'est aussi le mélange des langues dans ce lieu touristique. Ce respect d'une donnée sociologique a l'avantage ici d'alléger les dialogues, la barrière linguistique imposant la simplicité des phrases et permettant d'aller à l'essentiel sans paraître pompeux ou conventionnel. C'est enfin la musique, qui nous fait dire qu'une personne faisant appel à John Parish pour confectionner sa bande originale ne peut que nous être sympathique.
****
 L'ENFANT D'EN HAUT
L'ENFANT D'EN HAUT
de Ursula Meier
(France - Suisse / 100 min / 2012)

 CECI N'EST PAS UN FILM (In film nist)
CECI N'EST PAS UN FILM (In film nist)
 2 DAYS IN NEW YORK
2 DAYS IN NEW YORK
 DARK SHADOWS
DARK SHADOWS
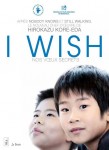 I WISH, NOS VŒUX SECRETS (Kiseki)
I WISH, NOS VŒUX SECRETS (Kiseki)

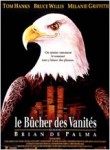 LE BÛCHER DES VANITÉS (The bonfire of vanities)
LE BÛCHER DES VANITÉS (The bonfire of vanities)
 BELLFLOWER
BELLFLOWER
 LE POLICIER (Ha-shoter)
LE POLICIER (Ha-shoter)
 DU JOUR AU LENDEMAIN (Von heute auf morgen)
DU JOUR AU LENDEMAIN (Von heute auf morgen)