
Le revoyant cette semaine sur Arte, je me suis dit que pour un monument figé au milieu du paysage cinématographique français, pour un film réalisé par un homme au style réputé lourd et rigide, Les enfants du paradis était une œuvre bien vivante, vigoureuse et vivifiante. Dès les premiers plans, les rues de studio de cinéma s'animent sans fausseté ni application apparente. Carné, à la technique infaillible (ne lui a-t-on pas suffisamment reproché...), fond parfaitement ses acteurs dans la foule et les accompagne au gré des vagues qui les portent. Dans cette reconstitution de Paris à Nice, les va-et-vient entre le dehors et le dedans se font sans heurt, de manière très fluide. Dans la coupe qui sépare les plans, on ne sent pas la lourdeur de la machinerie du cinéma qui se met en marche. La source coule. Un flux se crée entre les espaces arpentés : la rue se prolonge dans la salle du théâtre qui dialogue avec la scène qui continue dans les coulisses.
Ainsi, le théâtre, dans Les enfants du paradis, ne recueille pas seulement un simple jeu de reproduction de la vie. Plusieurs séquences ont comme pivot un regard lancé faisant le lien entre scène et salle ou scène et coulisses. C'est un monde vaste (le film frappe par son ampleur, maîtrisée) et cohérent mais qui n'est pas fermé sur lui-même, malgré le fait qu'il se présente sous une forme "bouclée" de récit, début et fin se rejoignant dans l'agitation du peuple de la rue. Entre ces deux extrémités tourbillonnantes, prennent place des accès de raideur théâtrale (les visites masculines successives dans la loge de Garance, quelques scènes d'amour un peu longues), des traits saillants, des scènes enlevées, des pauses bienvenues, des éclairs (le cri d'effroi de Nathalie sur scène à la vue de Baptiste foudroyé). Derrière la technique et le travail, la vérité de certains gestes se signale : un mouvement de la main de Barrault, un sautillement de Brasseur, un jeu de canne de Herrand, un redressement de la tête de Modot. Ils accentuent l'émotion devant un spectacle déjà prenant par la façon dont il est écrit.
Le beau scénario de Prévert permet de réunir et de croiser sans dévoiler de grossiers rouages (l'arrivée impromptue de Nathalie chez la logeuse, à la fin du film, est peut-être une exception mais encore nourrit-elle classiquement le mélodrame). Si les personnages sont clairement différenciés, de l'assassin à l'idéaliste, de l'artiste à la femme libre, de l'amoureuse inébranlable à l'oiseau de mauvais augure, ils ne restent pas figés pour autant. Au contraire, l'écriture et le jeu des acteurs modulent constamment les caractères pour provoquer par endroits la sympathie envers les moins aimables et l'antipathie envers les plus vertueux, comme dans la vie même.
Prévert est aux dialogues. Ils "s'entendent" donc. Bien sûr, certains claquent de manière ostensible (dans la bouche d'Arletty surtout, sa diction aidant) mais, d'une part, ils sont pris dans un flot et, d'autre part, cet art de la répartie poétique convient tout à fait dans ce monde-là, celui des comédiens, des brigands, des aristocrates, autant de personnages en représentation constante (jusqu'aux amoureux, qui ne cessent de se lamenter de ne pas être assez aimés en retour et qui font tout, qui font trop, pour obtenir cet effet miroir désiré). L'éloignement dans le temps, les costumes, jouent aussi en faveur de ces dialogues marqués (délestés qu'ils sont, par ailleurs, de la féérie ankylosée des Visiteurs du soir).
Et souvent, ces mots coupent, sans ménagement. Plus que Jéricho, figure du Destin un peu trop évidente arborée par Pierre Renoir, c'est Lacenaire qui semble distiller son poison misanthrope. Les concessions et les compromis n'ont pas droit de cité (quand on provoque verbalement, il y a vraiment, derrière, l'envie de meurtre) et la noirceur est bien au rendez-vous. Un fort pessimisme recouvre l'ensemble (ce qui ne veut pas dire que celui-ci soit irrespirable, verrouillé ou abusivement pré-déterminé : Carné traite le duel de Frédérick par l'ellipse, ne montre pas l'arrestation de Lacenaire, ne fait pas du cri de Nathalie l'annonce de la mort de Baptiste, bref, il peut ménager des ouvertures et laisser une latitude). Le film tient en équilibre entre le pôle de l'homme blanc, Baptiste, et celui de l'homme noir, Lacenaire, mais c'est bel et bien ce dernier, lui qui choisit sa fin, qui tire le reste le plus fort vers lui.
****
 LES ENFANTS DU PARADIS
LES ENFANTS DU PARADIS
de Marcel Carné
(France / 190 min / 1945)

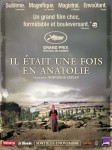 IL ÉTAIT UNE FOIS EN ANATOLIE (Bir zamanlar Anadolu'da)
IL ÉTAIT UNE FOIS EN ANATOLIE (Bir zamanlar Anadolu'da)


 LES TROIS MOUSQUETAIRES (The three musketeers)
LES TROIS MOUSQUETAIRES (The three musketeers)
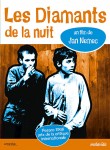 LES DIAMANTS DE LA NUIT (Démanty noci)
LES DIAMANTS DE LA NUIT (Démanty noci)
 A PERDRE LA RAISON
A PERDRE LA RAISON
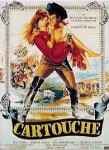 CARTOUCHE
CARTOUCHE
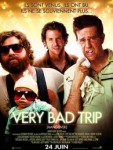 VERY BAD TRIP (The hangover)
VERY BAD TRIP (The hangover)
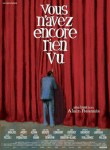 VOUS N'AVEZ ENCORE RIEN VU
VOUS N'AVEZ ENCORE RIEN VU
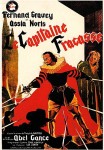 LE CAPITAINE FRACASSE
LE CAPITAINE FRACASSE
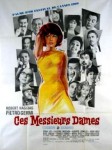 CES MESSIEURS DAMES (Signore & Signori)
CES MESSIEURS DAMES (Signore & Signori)