(Yang Ik-june / Corée du Sud / 2009)
■■■□
 Yang Ik-june, jeune réalisateur-scénariste-producteur-acteur principal, n'est pas Jean-Luc Godard. Il ne s'en réclame d'ailleurs aucunement. Mais son Breathless affiche le même air frondeur qu'A bout de souffle et les points communs entre les deux films ne sont pas rares. Ces deux premiers longs métrages réalisés comme en contrebande et lancés sans ménagement à la figure des spectateurs partagent notamment, au-delà d'une entrée en matière fracassante, une envie d'en découdre avec le monde environnant, une figure centrale de petite frappe, une rencontre décisive avec une jeune femme, une vulgarité provocatrice dans les dialogues, une prédilection pour la cigarette et une fin tragique...
Yang Ik-june, jeune réalisateur-scénariste-producteur-acteur principal, n'est pas Jean-Luc Godard. Il ne s'en réclame d'ailleurs aucunement. Mais son Breathless affiche le même air frondeur qu'A bout de souffle et les points communs entre les deux films ne sont pas rares. Ces deux premiers longs métrages réalisés comme en contrebande et lancés sans ménagement à la figure des spectateurs partagent notamment, au-delà d'une entrée en matière fracassante, une envie d'en découdre avec le monde environnant, une figure centrale de petite frappe, une rencontre décisive avec une jeune femme, une vulgarité provocatrice dans les dialogues, une prédilection pour la cigarette et une fin tragique...
Car fin tragique il y a. Rassurez-vous, cette révélation ne tient pas vraiment du spoiler (pour parler dans la langue universelle, à l'instar des distributeurs de films asiatiques, ceux du présent ouvrage ne faisant pas exception à la règle en rebaptisant, certes de manière habile comme nous venons de le remarquer, Ddongpari, soit "Mouche à merde", en Breathless, "A bout de souffle" donc), tant le dénouement semble écrit dès l'entame du récit. Il n'y a qu'à voir la teneur de ces moments arrachés à la violence du quotidien, ceux où Sang-hoon, la racaille toujours prête à taper sur tout ce qui bouge un peu trop, et Yeon-hee, la lycéenne forte tête, se baladent ensemble en ville, débarrassés pour un temps de la pression qui pèse sur eux. Au sein d'un film où tout ne semble être qu'agressions, affrontements, rapports de force, rituels de domination, défis lancés aux autres, qu'il s'agit de tenir en respect à coups de baffes, ces îlots génèrent leur propre nostalgie. Captés de loin, au téléobjectif, sans paroles audibles et seulement accompagnés d'une musique atmosphérique, alors que le reste est saisi dans une proximité extrême et sans la moindre note, ils décrivent un présent déjà passé.
Il est en effet trop tard. Un final contrasté signera le refus d'installer trop confortablement les idées d'apaisement, de réparation et de solidarité par le déplacement simple mais très efficace d'une séquence qui vient en cisailler une autre, tel un morceau de gène qui s'insèrerait dans un autre pour en modifier radicalement l'expression. Selon l'humeur, on détectera, dans le glissement presque mélodramatique qu'opère le récit, une lueur d'espoir ou bien un pessimisme radical.
Tout au long de Breathless, Yang Ik-june nous aura malmené pour mieux pointer des faillites, toutes liées les unes aux autres. Celle du système éducatif (l'école est une perte de temps et les lycéens et lycéennes sont constamment moqués par les caïds) et surtout celle des pères qui, invariablement, frappent les mères et terrorisent les enfants, leur transmettant ainsi non pas des valeurs de droiture et de respect mais bien le virus de la violence. Ces hommes en mal d'autorité se conduisent comme des dictateurs familiaux, des petits Kim Il-sung. L'insulte est proférée par Sang-hoon au cours de l'un de ses tabassages et c'est donc bien Yang Ik-june qui parle alors et qui élargit cette vision désespérante à toute la société coréenne actuelle.
Le message ainsi adressé, accentué sur la fin par l'arrivée des larmes de mélodrame peut faire craindre la leçon de morale. Mais le cheminement du film est tortueux. La progressive ouverture au monde du petit voyou à la mandale facile ne se fait pas sans détours. Les étapes les plus marquantes de cette accession à une plus grande humanité, liens renoués avec les uns, aide apportée aux autres, sont en effet suivies soit d'un déchaînement de violence plus imprévisible encore, soit d'un affaissement passager, soit de l'expression inattendue d'une douleur. Plus généralement, c'est la construction de Breathless dans son ensemble qui est paradoxale. L'espace géographique arpenté étant relativement limité (à un quartier de Séoul), les fils du scénario semblent tissés de manière évidente. Les personnages sont posés d'une telle façon que les croisements sont assez faciles à prévoir. De même, très vite, un parallèle s'établit entre l'histoire passée et présente de Sang-hoon et celle de Yeon-hee. Or, si déterminé que paraît être le récit, surprises et ruptures, contre-pieds et contretemps abondent.
Cela confère au film son incroyable énergie et cela caractérise aussi la vision de la violence qu'a Yang Ik-june. Nous l'avons dit, celui-ci cadre serré. A deux ou trois reprises, il se sert de cette absence de recul pour décupler l'effet d'une soudaine intrusion dans le cadre. Ailleurs, il peut faire preuve d'un certain humour à froid, désamorçant la violence par des trouvailles de montage rappelant celles dont est friand Takeshi Kitano (d'un pugilat, nous pouvons passer en une coupe à un repas apaisé avec les mêmes protagonistes). Breathless, acte rageur et malpoli de cinéma, impressionne finalement par sa maîtrise sur ce plan-là, qui l'empêche constamment de tomber dans la complaisance. Ici, la violence n'a rien de sadique, elle ne procure pas de plaisir à celui qui en use (on note par ailleurs l'absence totale d'acte ou de désir sexuel), elle n'est qu'un moyen dans un univers déréglé. En la montrant de manière cyclique et irrépressible, Yang Ik-june, que l'on sent si proche de son sujet, pose la question de l'héritage (voire de l'hérédité) de cette violence et s'inquiète de trouver en si peu d'endroits l'espoir d'en stopper la contamination. Au moins, pour lui, au-delà de la catharsis, faire un film de cela, c'est déjà faire quelque chose et s'extirper du néant.

 District 9 a, depuis un an, été encensé à un tel point, par à peu près tout le monde, qu'il peut très bien supporter que l'on en dise du mal. Cette œuvrette SF faussement novatrice n'échappe selon moi à la nullité que, d'une part, par l'évidence des compétences purement techniques mises à son service (ce qui est bien le minimum que l'on puisse attendre d'une production Peter Jackson, même d'ampleur "modeste") et, d'autre part, par le développement plutôt habile de l'un des thèmes abordés, celui, kafkaïen, de la métamorphose (même si les mutations et les altérations de la chair observées ici restent très en deçà des visions d'un Cronenberg), et il me semble que, comme il arrive parfois, l'originalité de l'idée de départ (montrer le traitement "inhumain" que réservent les autorités et la population de Johannesburg à des extra-terrestres exilés de leur planète) a trop vite été prise pour l'acte de naissance d'un style, celui de Neill Blomkamp qui signe là son premier long métrage.
District 9 a, depuis un an, été encensé à un tel point, par à peu près tout le monde, qu'il peut très bien supporter que l'on en dise du mal. Cette œuvrette SF faussement novatrice n'échappe selon moi à la nullité que, d'une part, par l'évidence des compétences purement techniques mises à son service (ce qui est bien le minimum que l'on puisse attendre d'une production Peter Jackson, même d'ampleur "modeste") et, d'autre part, par le développement plutôt habile de l'un des thèmes abordés, celui, kafkaïen, de la métamorphose (même si les mutations et les altérations de la chair observées ici restent très en deçà des visions d'un Cronenberg), et il me semble que, comme il arrive parfois, l'originalité de l'idée de départ (montrer le traitement "inhumain" que réservent les autorités et la population de Johannesburg à des extra-terrestres exilés de leur planète) a trop vite été prise pour l'acte de naissance d'un style, celui de Neill Blomkamp qui signe là son premier long métrage. Le renouvellement qu'apporte Morse (Lat den rätte komma in) à un genre déjà régénéré à de nombreuses reprises est dû, plus qu'à une esthétique ou des thématiques nouvelles, à un changement de point de vue : voici un film de vampires à hauteur d'enfants (mais pas un film de vampires "pour" enfants).
Le renouvellement qu'apporte Morse (Lat den rätte komma in) à un genre déjà régénéré à de nombreuses reprises est dû, plus qu'à une esthétique ou des thématiques nouvelles, à un changement de point de vue : voici un film de vampires à hauteur d'enfants (mais pas un film de vampires "pour" enfants). Mais commençons par l'agréable. A qui découvre Zodiac sans connaître David Fincher, il ne viendrait pas à l'esprit de qualifier ce cinéma-là de tape-à-l'œil. En effet, pour une fois, la mise en scène du réalisateur de Fight Club n'excède jamais son sujet. Elle se déploie majestueusement dans la durée, afin d'embrasser les nombreuses années que recouvrent le récit mais également afin de plonger le spectateur dans un temps et un espace de plus en plus flottant, cela malgré la précision, jamais prise en défaut, de la datation et de la géographie. Zodiac a bien un personnage principal, le dessinateur Robert Graysmith, mais celui-ci peut être congédié temporairement de l'écran (comme il lui est demandé plusieurs fois par ses supérieurs hiérarchiques de quitter la salle de rédaction dans laquelle ils doivent avoir une discussion importante), l'assemblage des différents blocs structurant le récit en devenant totalement imprévisible.
Mais commençons par l'agréable. A qui découvre Zodiac sans connaître David Fincher, il ne viendrait pas à l'esprit de qualifier ce cinéma-là de tape-à-l'œil. En effet, pour une fois, la mise en scène du réalisateur de Fight Club n'excède jamais son sujet. Elle se déploie majestueusement dans la durée, afin d'embrasser les nombreuses années que recouvrent le récit mais également afin de plonger le spectateur dans un temps et un espace de plus en plus flottant, cela malgré la précision, jamais prise en défaut, de la datation et de la géographie. Zodiac a bien un personnage principal, le dessinateur Robert Graysmith, mais celui-ci peut être congédié temporairement de l'écran (comme il lui est demandé plusieurs fois par ses supérieurs hiérarchiques de quitter la salle de rédaction dans laquelle ils doivent avoir une discussion importante), l'assemblage des différents blocs structurant le récit en devenant totalement imprévisible. Des abîmes, The social network, film lisse et impénétrable, ne s'en approche pas. Contrairement à ce que semble penser l'écrasante majorité des spectateurs, je trouve personnellement que David Fincher ne parvient pas à dépasser la banalité et l'absence de cinégénie de son sujet, pas plus qu'il ne réussit à racheter la médiocrité morale de ses personnages. Le monde décrit ici (le monde réel et non virtuel) m'apparaît détestable en tous points. Mark Zuckerberg et ses congénères de Harvard s'ébattent dans un univers régi par les lois de l'argent, de la compétition, de la sélection. Même la démarche rebelle s'y dissout, le créateur de Facebook, présenté comme un caractère si atypique, en acceptant secrètement toutes les règles, poursuivant le long d'un chemin à peine détourné les mêmes rêves que les autres : intégrer un Club privé et devenir milliardaire grâce à une simple idée. Jamais Fincher ne critique cette idéologie de l'ascension sociale jalonnée de petits bizutages et de grandes trahisons, le regard moqueur qu'il lance sur les jumeaux Winklevoss n'existant que pour faire oublier la complaisance de celui portant sur les véritables héros de l'histoire, Zuckerberg et ses partenaires Saverin et Parker.
Des abîmes, The social network, film lisse et impénétrable, ne s'en approche pas. Contrairement à ce que semble penser l'écrasante majorité des spectateurs, je trouve personnellement que David Fincher ne parvient pas à dépasser la banalité et l'absence de cinégénie de son sujet, pas plus qu'il ne réussit à racheter la médiocrité morale de ses personnages. Le monde décrit ici (le monde réel et non virtuel) m'apparaît détestable en tous points. Mark Zuckerberg et ses congénères de Harvard s'ébattent dans un univers régi par les lois de l'argent, de la compétition, de la sélection. Même la démarche rebelle s'y dissout, le créateur de Facebook, présenté comme un caractère si atypique, en acceptant secrètement toutes les règles, poursuivant le long d'un chemin à peine détourné les mêmes rêves que les autres : intégrer un Club privé et devenir milliardaire grâce à une simple idée. Jamais Fincher ne critique cette idéologie de l'ascension sociale jalonnée de petits bizutages et de grandes trahisons, le regard moqueur qu'il lance sur les jumeaux Winklevoss n'existant que pour faire oublier la complaisance de celui portant sur les véritables héros de l'histoire, Zuckerberg et ses partenaires Saverin et Parker. En décembre 1937, dans la guerre qui l'oppose à la Chine, l'armée impériale japonaise remporte la bataille de Nankin. Après avoir massacré les soldats chinois fait prisonniers, elle commet pendant des semaines des atrocités sur les civils : viols collectifs, tortures, exécutions de masse... Le nombre de 300 000 morts est celui qui est le plus souvent avancé.
En décembre 1937, dans la guerre qui l'oppose à la Chine, l'armée impériale japonaise remporte la bataille de Nankin. Après avoir massacré les soldats chinois fait prisonniers, elle commet pendant des semaines des atrocités sur les civils : viols collectifs, tortures, exécutions de masse... Le nombre de 300 000 morts est celui qui est le plus souvent avancé. Impossible pour moi, à le découvrir aujourd'hui, de ne pas juger Infernal affairs (Mou gaan dou) à l'aune de son remake de 2006, Les infiltrés (à mon sens le meilleur Scorsese de la série Di Caprio en cours). Une simple donnée explique à elle seule la plupart des différences que l'on observe entre les deux œuvres : la durée des métrages. L'original, ramassé sur ses cent minutes, affiche à son compteur quasiment une heure de moins.
Impossible pour moi, à le découvrir aujourd'hui, de ne pas juger Infernal affairs (Mou gaan dou) à l'aune de son remake de 2006, Les infiltrés (à mon sens le meilleur Scorsese de la série Di Caprio en cours). Une simple donnée explique à elle seule la plupart des différences que l'on observe entre les deux œuvres : la durée des métrages. L'original, ramassé sur ses cent minutes, affiche à son compteur quasiment une heure de moins. Avec La révélation, titre français passe-partout remplaçant le Storm original mais pas forcément plus approprié, Hans-Christian Schmid a eu le mérite de se frotter à un sujet politique actuel et complexe. Développer une fiction à partir de l'activité d'une institution comme le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie n'est pas chose aisée. Le cinéaste allemand le fait sans complaisance vis à vis des magistrats y exerçant leur métier, n'hésitant pas à évoquer leur lassitude, la tentation des petits arrangements et, plus généralement, la difficulté à résister au pragmatisme politique international qu'impose, entre autres choses, la construction européenne. Tourné en 2008, le film entre en résonance avec le procès Slobodan Milosevic et l'arrestation de Radovan Karadzic et tente d'accompagner les réflexions autour de la place à donner à la Serbie dans l'U.E. Pour étoffer sa base documentaire, que l'on sent très travaillée en amont, Schmid brosse le portrait de deux femmes, l'une, véritable héroïne de cette histoire, procureure à La Haye, l'autre, victime de la guerre de Bosnie, et donne à son film l'apparence d'une enquête policière dont l'aboutissement est censé interroger les notions de responsabilité individuelle et de droiture morale.
Avec La révélation, titre français passe-partout remplaçant le Storm original mais pas forcément plus approprié, Hans-Christian Schmid a eu le mérite de se frotter à un sujet politique actuel et complexe. Développer une fiction à partir de l'activité d'une institution comme le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie n'est pas chose aisée. Le cinéaste allemand le fait sans complaisance vis à vis des magistrats y exerçant leur métier, n'hésitant pas à évoquer leur lassitude, la tentation des petits arrangements et, plus généralement, la difficulté à résister au pragmatisme politique international qu'impose, entre autres choses, la construction européenne. Tourné en 2008, le film entre en résonance avec le procès Slobodan Milosevic et l'arrestation de Radovan Karadzic et tente d'accompagner les réflexions autour de la place à donner à la Serbie dans l'U.E. Pour étoffer sa base documentaire, que l'on sent très travaillée en amont, Schmid brosse le portrait de deux femmes, l'une, véritable héroïne de cette histoire, procureure à La Haye, l'autre, victime de la guerre de Bosnie, et donne à son film l'apparence d'une enquête policière dont l'aboutissement est censé interroger les notions de responsabilité individuelle et de droiture morale. En août 2005, l'année de ses 60 ans, Neil Young remonte sur scène à Nashville après plusieurs mois d'absence, suite à une rupture d'anévrisme et un opération au cerveau. Il y joue les morceaux de Prairie wind, l'album qu'il vient de publier, ainsi qu'une poignée de ses classiques. Le concert est filmé par l'un des cinéastes sachant le mieux mettre en valeur la musique devant une caméra : Jonathan Demme.
En août 2005, l'année de ses 60 ans, Neil Young remonte sur scène à Nashville après plusieurs mois d'absence, suite à une rupture d'anévrisme et un opération au cerveau. Il y joue les morceaux de Prairie wind, l'album qu'il vient de publier, ainsi qu'une poignée de ses classiques. Le concert est filmé par l'un des cinéastes sachant le mieux mettre en valeur la musique devant une caméra : Jonathan Demme.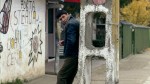 - ARGUMENT, nom. Résumé, trame narrative d'une œuvre lttéraire, théâtrale, cinématographique, chorégraphique ou lyrique.
- ARGUMENT, nom. Résumé, trame narrative d'une œuvre lttéraire, théâtrale, cinématographique, chorégraphique ou lyrique. Contre toute attente, le seul intérêt véritable de Shortbus est musical, la série de pop songs que l'on y entend étant tout à fait agréable (de Yo La Tengo à Animal Collective).
Contre toute attente, le seul intérêt véritable de Shortbus est musical, la série de pop songs que l'on y entend étant tout à fait agréable (de Yo La Tengo à Animal Collective).