
****
Le film d'Ettore Scola est récemment ressorti en DVD chez Carlotta. Deux collègues kinokiens s'en sont fait successivement l'écho, sous la forme de la sentence définitive pour l'un et de la chronique détaillée pour l'autre, se rejoignant toutefois pour placer haut l'objet dans l'échelle des valeurs. De mon côté, je souhaitais depuis un petit moment repartir, à l'occasion, à la rencontre de ces Affreux, sales et méchants zonards romains. Les deux interventions sus-citées me décidèrent d'accélérer les retrouvailles.
Ce jalon tardif mais fameux de la comédie italienne, je l'avais découvert il y a de cela un bon paquet d'années et... je n'avais pas aimé ça du tout. La révision étant aujourd'hui faite, je peux me lancer dans une critique en forme d'autocritique et en quatre points.
1. J'avais dû trouver la mise en scène de Scola inégale et approximative.
Pourtant l'utilisation du zoom ou le détail que constitue le remplacement, pour le tournage d'une séquence agitée (celle des motards), d'un nourrisson par un poupon ne sont pas les preuves d'un quelconque laisser-aller stylistique, car ce qui ressort de ces presque deux heures de film ce sont bien l'invention et la précision de la mise en scène. Celle-ci repose en grande partie sur les plans-séquences. Le premier mouvement, accompagnant une silhouette dans la pénombre, est déjà ponctué par une trouvaille bien sentie : le plan s'arrête sur le visage d'un homme ne dormant avec son fusil que d'un œil, l'autre étant seulement, pense-t-on à ce moment-là, masqué par le drap. Puis vient l'extraordinaire plan balayant la baraque de l'intérieur, au petit matin. En panoramique circulaire, la caméra ne cesse de buter sur des corps à moitié endormis ou éructant déjà. Calées sur l'image, les paroles se chevauchent, émergent puis baissent d'intensité successivement. Le tour de l'endroit est effectué trois fois, avec à chaque passage une pause un peu plus longue désignant le Roi de cette cour, le dénommé Giacinto Mazzatella. Le procédé est parfait pour atteindre le double but recherché : singulariser le personnage tout en intégrant la star qui en a la charge (Nino Manfredi) au cadre et à la troupe qui l'entoure, composée de comédiens venus du théâtre et de non professionnels. A la fin du film, ce mouvement sera bien sûr répété pour mettre en forme l'ultime gag dans une conclusion logique, aussi drôle que terrifiante.
De la technique du plan-séquence, Scola tire parti de plusieurs façons. Si elle peut induire une répétition et une circularité, la longueur du plan peut également servir à ménager la surprise. Lorsque l'adolescente passe prendre, de baraque en baraque, les enfants de chaque famille, on pense qu'elle les amène vers quelque école mais il s'avère qu'elle va en fait les regrouper pour les parquer dans un enclos en bordure du bidonville. Les plans-séquences, par leur magistrale organisation, remplissent aussi bien sûr leur mission la plus évidente : donner à voir le chaos et l'agitation perpétuelle, en faisant vivre mille micro-récits et en faisant exister un décor incroyable. Créé pour les besoins du film, le bidonville paraît avoir été trouvé sur place (la tentation initiale du documentaire a laissé des traces, tout comme la participation de Pasolini au projet, juste avant sa mort). Forcément fait de bric et de broc, il permet à Scola de jouer des touches de couleurs, des oppositions, des contrastes. Mais c'est surtout sa situation géographique qui le singularise, sur une hauteur, au-dessus des immeubles bourgeois romains et d'une voie ferrée filant vers le centre-ville. Cet arrière-plan est régulièrement présent dans l'image mais sans insistance. La discrète composition, qui ne prend jamais la place de ce qui se joue sur le devant de la scène, suffit à dire les choses.
2. J'avais dû trouver le film rempli de facilités comiques.
Or le trait est beaucoup plus vif et acéré que gras. Seule, peut-être, la séquence de voyeurisme de Giacinto surprenant l'un des ses fils, "pédé", en train de s'occuper de sa belle-fille, semble trop longue et quelque peu gâchée par des cadrages farfelus. Ailleurs, la vacherie des répliques fait très souvent rire, saisit parfois jusqu'à décontenancer, mettrait presque mal à l'aise à l'occasion. L'art de la caricature épate, comme cette idée de faire tenir le rôle de la grand-mère par un homme (et effectivement, avant d'avoir lu cette révélation, elle nous paraissait si étrange cette mamie gâteuse !).
3. J'avais dû trouver que les acteurs en faisaient des tonnes, Manfredi en tête.
C'est bien pourtant, concernant ce dernier, de grande maîtrise et d'extraordinaire présence qu'il faut parler. Manfredi est indispensable au film, il est notre vecteur. Il est la porte d'accès du spectateur au monde d'Affreux, sales et méchants. La famille élargie de Giacinto jalouse celui-ci en raison de l'existence de son "magot" obtenu suite à l'accident du travail lui ayant coûté son œil gauche et qu'il ne veut partager avec personne : cette histoire veut que tous les regards convergent vers lui et le nôtre, logiquement, suit. Le personnage est odieux, autant que ceux qui l'entourent, mais dans l'œil de Manfredi se met parfois à briller une étincelle et toute notre émotion s'y engouffre. On sait combien l'alcoolisme est difficile à jouer. Or, il y a ici ces moments magnifiques dans lesquels Scola nous montre Giacinto comme absent à lui-même, affalé devant un verre ou traversant le bidonville en titubant (ces plans donnent l'impression de commencer un peu avant et de se terminer un peu après ce que la convention imposerait).
4. J'avais dû trouver que Scola faisait son film sur le dos des pauvres.
Je l'avais mal vu : si Affreux, sales et méchants est une comédie détonnante, c'est aussi l'un des films les plus enragés qui soient. Lorsque Giacinto met le feu à sa baraque se fait sentir toute la colère du cinéaste. Le désespoir manque ici de tout brûler. L'histoire donne à voir, au final, un "statu quo en pire" et il n'y a rien ni personne à sauver. Ou plutôt si, une seule petite parcelle, celle de l'enfance. Aux gamins élevés à coups de taloches et peut-être mis à l'écart avant tout pour être protégés des adultes, Ettore Scola réserve ses seules images empathiques, façon de faire tenir un espoir infime.
Pour répercuter ce scandaleux état des choses, Affreux, sales et méchants n'en passe donc pas par l'apitoiement, pas plus qu'il ne nous montre des belles âmes à la recherche d'une dignité. Il fonctionne autrement, de façon bien plus audacieuse. De la même manière que la situation géographique du bidonville, au sommet d'une colline, est affirmée, le tournant dramatique s'effectue sur une terrasse surplombante. Nous assistons alors à la chute du Roi, au plus bas. Mais filmée de haut. Scola a tenté et réussi avec Affreux, sales et méchants un pari fou : faire que les extrêmes se rejoignent. La scène la plus forte du film en est la marque. Le sordide (le dégueulis) se mêle au sublime (la mer). Après un tel sommet (que dire de Manfredi dans cette séquence...), le fait que Scola, avant l'ultime plan déjà évoqué, patine quelque peu dans les dernières péripéties n'a pour ainsi dire que peu d'importance. Son film est impressionnant et j'avais tort de le mépriser la première fois.
 AFFREUX, SALES ET MÉCHANTS (Brutti, sporchi e cattivi)
AFFREUX, SALES ET MÉCHANTS (Brutti, sporchi e cattivi)
d'Ettore Scola
(Italie / 115 mn / 1976)

 WINTER'S BONE
WINTER'S BONE

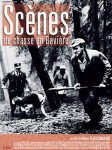 SCÈNES DE CHASSE EN BAVIÈRE (Jagdszenen aus Niederbayern)
SCÈNES DE CHASSE EN BAVIÈRE (Jagdszenen aus Niederbayern)
 LA NUIT DE SAN LORENZO (La notte di San Lorenzo)
LA NUIT DE SAN LORENZO (La notte di San Lorenzo)
 1993 : Idrissa Ouédraogo, Jane Campion, Alain Resnais et Hou Hsiao-hsien (Le maître de marionnettes) s'expriment dans les deux revues, qui ont le même intérêt pour Les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel de Laurence Ferreira Barbosa et les films de Manoel de Oliveira, Le jour du désespoir et Val Abraham. Rétrospectives et inédits font que les noms de Mizoguchi, Naruse, Buñuel, Mankiewicz, Fassbinder, Mann et Guitry se retrouvent dans les sommaires. En revanche, la comédie à la française n'est pas abordée par le même versant : alors que les Cahiers rencontrent Jean-Marie Poiré et Christian Clavier pour Les visiteurs, Positif préfère s'entretenir avec Patrice Leconte à l'occasion de Tango.
1993 : Idrissa Ouédraogo, Jane Campion, Alain Resnais et Hou Hsiao-hsien (Le maître de marionnettes) s'expriment dans les deux revues, qui ont le même intérêt pour Les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel de Laurence Ferreira Barbosa et les films de Manoel de Oliveira, Le jour du désespoir et Val Abraham. Rétrospectives et inédits font que les noms de Mizoguchi, Naruse, Buñuel, Mankiewicz, Fassbinder, Mann et Guitry se retrouvent dans les sommaires. En revanche, la comédie à la française n'est pas abordée par le même versant : alors que les Cahiers rencontrent Jean-Marie Poiré et Christian Clavier pour Les visiteurs, Positif préfère s'entretenir avec Patrice Leconte à l'occasion de Tango.
 Quitte à choisir : De belles choses de part et d'autre mais aussi quelques choix de films que je n'apprécie que modérément, voire pas du tout (le Téchiné, le Collard, le Godard, le Spike Lee, le Ouédraogo, le Miller, le Kieslowski). Je regrette de ne pas pouvoir juger le Ferrara ni le Corman (l'une des couvertures les plus marquantes des Cahiers de l'époque). Allez, pour 1993 : Match nul.
Quitte à choisir : De belles choses de part et d'autre mais aussi quelques choix de films que je n'apprécie que modérément, voire pas du tout (le Téchiné, le Collard, le Godard, le Spike Lee, le Ouédraogo, le Miller, le Kieslowski). Je regrette de ne pas pouvoir juger le Ferrara ni le Corman (l'une des couvertures les plus marquantes des Cahiers de l'époque). Allez, pour 1993 : Match nul.
 DURA LEX (Po zakonu)
DURA LEX (Po zakonu)

 LE MASSEUR (Masahista)
LE MASSEUR (Masahista)
 SA MAJESTÉ DES MOUCHES (Lord of the flies)
SA MAJESTÉ DES MOUCHES (Lord of the flies)
 TOKYO !
TOKYO !