
****
Si, parmi les films s'attachant à décrire un univers concentrationnaire ayant existé, Le fossé est l'un des plus pertinents et des moins contestables, il le doit tout d'abord à la spécificité du lieu. Le camp de rééducation maoïste de Jiabiangou, en activité du début des années 50 à 1960 (date du récit), est situé dans le désert de Gobi. Une poignée de baraques y abritait les responsables. Les prisonniers, eux, se contentaient de s'entasser dans des dortoirs creusés sous terre. La situation géographique et le climat faisaient, apparemment, qu'une délimitation stricte n'était pas nécessaire et que le nombre de gardiens pouvait être réduit au minimum. Ces caractéristiques servent le film qui peut éviter plus facilement que d'autres les écueils de ce type de reconstitution, liés à la gestion des foules et des moyens techniques qui peuvent paraître inappropriés et gênants en la circonstance. La clandestinité du tournage, sur le territoire chinois, concourt pareillement à la sobriété et à la crédibilité absolue du récit.
Mais dire cela n'enlève rien au mérite propre du cinéaste tant la validité de son film tient aussi à son approche du sujet et à ses parti pris de mise en scène. Sans surprise, Wang Bing, auteur du fort réputé A l'ouest des rails, exerce son œil de documentariste, organise des séquences souvent pas ou peu dramatisées, privilégie les plans longs, observe et restitue les faits. Il tourne autour des notions d'étirement et de répétition : le travail quotidien des fossoyeurs rythmant les journées du camp comme il rythme la narration.
Cette observation à bonne distance n'est pas synonyme de neutralité esthétique. Wang Bing utilise l'architecture rudimentaire des dortoirs, constitués d'une rangée d'une douzaine de lits accolés les uns aux autres, pour travailler la profondeur de champ. Au fond du plan, se déroulent des actions, se distinguent des mouvements ou de simples gestes. Par quelques ouvertures en hauteur, des rais de lumière complètent encore l'organisation visuelle. Passant en surface, l'œil se perd dans l'horizon et voit les silhouettes disparaître. Les hommes s'engouffrent dans les dortoirs-tombeaux. Ils sont avalés par la terre. Cet enfouissement renvoie à plusieurs choses : à la fabrication du film lui-même, au refoulement de la mémoire, à l'effacement des traces du passé, au devenir poussière de l'homme. Celui-ci, dans ce camp, ne travaille même plus et reste sur son lit, affamé. Sous les couvertures, il n'est plus qu'une forme.
Wang Bing filme les gestes quotidiens, la vie de camp dans ce qu'elle a de plus prosaïque. Et il filme l'extraordinaire, l'incroyable, l'insoutenable, qui paraissent presque irréel ou fantastique (la nuit, les galeries souterraines...). Il s'arrête aussi entre ces deux pôles, pour des scènes mettant en avant, un peu artificiellement, un peu brutalement, des récits sous forme dialoguée ou incorporée à l'action. Sans doute est-ce là un léger défaut du film, rendu voyant par la succession marquée des séquences, assemblées par larges blocs.
Cela n'entame toutefois pas la cohérence de l'organisation générale (Le fossé débute par l'arrivée d'un groupe et se termine sur des départs), ni la force de la mise en scène. On en retient par exemple ces saisissants plans séquences d'entrées dans les trous aménagés, la continuité du mouvement entre l'extérieur et l'intérieur provoquant un violent changement de lumière. Et l'on remarque que, même si ces prisonniers ont une (très) relative liberté de circulation dans le camp, jamais la caméra n'effectue de déplacement dans l'autre sens, celui de la sortie... à une exception près, pleine de sens.
 LE FOSSÉ (Jiabiangou)
LE FOSSÉ (Jiabiangou)
de Wang Bing
(Hong-Kong - France - Belgique / 110 mn / 2010)

 HA HA HA (Hahaha)
HA HA HA (Hahaha)
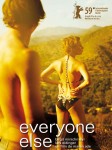 EVERYONE ELSE (Alle anderen)
EVERYONE ELSE (Alle anderen)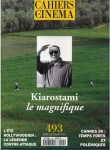
 1995 : "Deux révélations chinoises" : en avril, Cahiers et Positif présentent de la même façon à leurs lecteurs les noms de Wong Kar-wai et Tsai Ming-liang. Et les deux revues effectuent le même choix pour la couverture : ce sera Chungking express plutôt que Vive l'amour. Comme souvent, les points communs entre les sommaires sont nombreux au fil de l'année puisque l'on s'intéresse des deux côtés à Noémie Lvovsky, Chabrol, Pialat, Kusturica, Kiarostami, Burton, Kassovitz, Carpenter (L'antre de la folie) et Robert Aldrich (en rétrospective).
1995 : "Deux révélations chinoises" : en avril, Cahiers et Positif présentent de la même façon à leurs lecteurs les noms de Wong Kar-wai et Tsai Ming-liang. Et les deux revues effectuent le même choix pour la couverture : ce sera Chungking express plutôt que Vive l'amour. Comme souvent, les points communs entre les sommaires sont nombreux au fil de l'année puisque l'on s'intéresse des deux côtés à Noémie Lvovsky, Chabrol, Pialat, Kusturica, Kiarostami, Burton, Kassovitz, Carpenter (L'antre de la folie) et Robert Aldrich (en rétrospective).
 Quitte à choisir : Deux consistantes séries de couvertures que, chacune, je vois à peine entâchée d'un ratage, et cela le même mois (les très faibles Rivette et Boorman). Le seul titre qui me soit inconnu est celui de Chahine mais comme je ne peux guère dire si je défendrai encore aujourd'hui L'appât de Tavernier, un score de parité semble s'imposer. Allez, pour 1995 : Match nul.
Quitte à choisir : Deux consistantes séries de couvertures que, chacune, je vois à peine entâchée d'un ratage, et cela le même mois (les très faibles Rivette et Boorman). Le seul titre qui me soit inconnu est celui de Chahine mais comme je ne peux guère dire si je défendrai encore aujourd'hui L'appât de Tavernier, un score de parité semble s'imposer. Allez, pour 1995 : Match nul.
 PINA
PINA

 ESSENTIAL KILLING
ESSENTIAL KILLING
 LE SECRET DES POIGNARDS VOLANTS (Shi mian mai fu)
LE SECRET DES POIGNARDS VOLANTS (Shi mian mai fu)
 LES MILLE ET UNE NUITS (Il fiore delle mille e una notte)
LES MILLE ET UNE NUITS (Il fiore delle mille e una notte)
 1994 : Aux Cahiers, deux pôles structurent les sommaires. D'un côté, le cinéma américain avec la défense de L'impasse (DePalma), d'Un monde parfait (Eastwood), de Tueurs nés (Stone), des rencontres avec Avary, Cameron et Burton, avec Kathleen Turner, avec David Lynch (à propos d'Eraserhead) et un retour sur Orson Welles. De l'autre, le cinéma français particulièrement présent au fil de l'année à travers des entretiens avec Tonie Marshall, Patrice Chéreau, Pascale Ferran, Claire Denis (J'ai pas sommeil), Robert Kramer (Point de départ), Sandrine Bonnaire, Fanny Ardant, Gérard Lanvin et Bertrand Tavernier (sur la cinéphilie), des textes sur Jeanne le Pucelle (Rivette), L'enfer (Chabrol), Du fond du cœur (Doillon), Délits flagrants (Depardon), L'ange noir (Brisseau) et Lou n'a pas dit non (Miéville), un dossier Renoir, un numéro spécial concocté par Isabelle Huppert et plusieurs papiers sur la collection de téléfilms produite par Arte, Tous les garçons et les filles de leur âge. Entre ces deux tendances se glissent Almodovar, Moretti (Journal intime), Loach (Ladybird), Fellini (un entretien inédit), Shin Sang Okk, Ozu et Tarkovski, ainsi que Kiarostami et Kurosawa dont la rencontre est relatée. Le comité de rédaction accueille officiellement, entre autres, Jacques Morice et Vincent Ostria, tandis que Luc Moullet poursuit la chronique qu'il avait entamée l'année précédente.
1994 : Aux Cahiers, deux pôles structurent les sommaires. D'un côté, le cinéma américain avec la défense de L'impasse (DePalma), d'Un monde parfait (Eastwood), de Tueurs nés (Stone), des rencontres avec Avary, Cameron et Burton, avec Kathleen Turner, avec David Lynch (à propos d'Eraserhead) et un retour sur Orson Welles. De l'autre, le cinéma français particulièrement présent au fil de l'année à travers des entretiens avec Tonie Marshall, Patrice Chéreau, Pascale Ferran, Claire Denis (J'ai pas sommeil), Robert Kramer (Point de départ), Sandrine Bonnaire, Fanny Ardant, Gérard Lanvin et Bertrand Tavernier (sur la cinéphilie), des textes sur Jeanne le Pucelle (Rivette), L'enfer (Chabrol), Du fond du cœur (Doillon), Délits flagrants (Depardon), L'ange noir (Brisseau) et Lou n'a pas dit non (Miéville), un dossier Renoir, un numéro spécial concocté par Isabelle Huppert et plusieurs papiers sur la collection de téléfilms produite par Arte, Tous les garçons et les filles de leur âge. Entre ces deux tendances se glissent Almodovar, Moretti (Journal intime), Loach (Ladybird), Fellini (un entretien inédit), Shin Sang Okk, Ozu et Tarkovski, ainsi que Kiarostami et Kurosawa dont la rencontre est relatée. Le comité de rédaction accueille officiellement, entre autres, Jacques Morice et Vincent Ostria, tandis que Luc Moullet poursuit la chronique qu'il avait entamée l'année précédente.
 Quitte à choisir : Sachant que Kika, Jeanne la Pucelle, La Reine Margot et L'ange noir sont loin d'être mes titres préférés au sein des filmographies respectives de leurs auteurs, que le Tonie Marshall ne m'a pas laissé un souvenir impérissable, que ces Altman, DePalma, Kieslowski, Tarantino et Egoyan-là me semblent peu discutables, que le Pintilie et le Ferran me furent très agréables, même sans avoir vu les autres américains cités et en jouant les excellents Roseaux sauvages et Mr Jack contre le Grand (petit) saut (ou ce Ripstein un peu raide), les Cahiers sont pour moi, cette année, mal barrés. Allez, pour 1994 : Avantage Positif.
Quitte à choisir : Sachant que Kika, Jeanne la Pucelle, La Reine Margot et L'ange noir sont loin d'être mes titres préférés au sein des filmographies respectives de leurs auteurs, que le Tonie Marshall ne m'a pas laissé un souvenir impérissable, que ces Altman, DePalma, Kieslowski, Tarantino et Egoyan-là me semblent peu discutables, que le Pintilie et le Ferran me furent très agréables, même sans avoir vu les autres américains cités et en jouant les excellents Roseaux sauvages et Mr Jack contre le Grand (petit) saut (ou ce Ripstein un peu raide), les Cahiers sont pour moi, cette année, mal barrés. Allez, pour 1994 : Avantage Positif.