 Le Corniaud n'est pas désagréable dans sa première heure y compris sous son aspect touristique (la séquence documentaire de la cadillac avançant au pas au milieu de la foule des ruelles napolitaines, les vues de Rome...), du moins jusqu'à ce qu'il se rapproche des personnages italiens, aussitôt traînés dans les pires clichés. Reconnaissons aussi que quelques gags portent.
Le Corniaud n'est pas désagréable dans sa première heure y compris sous son aspect touristique (la séquence documentaire de la cadillac avançant au pas au milieu de la foule des ruelles napolitaines, les vues de Rome...), du moins jusqu'à ce qu'il se rapproche des personnages italiens, aussitôt traînés dans les pires clichés. Reconnaissons aussi que quelques gags portent.
La mise en scène est purement fonctionnelle lorsqu'il s'agit de faire rire, elle est transparente, voire calamiteuse, dans les transitions. La poursuite automobile entre les deux groupes de truands est ainsi montée en dépit du bon sens et composée d'images en accéléré, d'horribles raccords et de plans tournés alternativement de jour et de nuit ! Elle débouche heureusement sur la scène de l'affrontement nocturne dans le parc, plutôt réussie, grâce à deux ou trois heureuses trouvailles comiques (De Funès se croyant tenu en joue par son adversaire alors qu'il n'a fait que reculer vers une statue pointant son doigt, meilleur gag du film, ou le chassé-croisé à la Tex Avery dans le tronc creux d'un arbre).
Au bout d'un moment, le film devient tout de même franchement médiocre, jusqu'à la fin, le "retournement" vengeur du personnage de Bourvil à l'égard de ses poursuivants et de celui qui l'a trompé étant parfaitement nul. Tout du long, l'acteur est lui-même peu supportable (De Funès est inégal mais a ses intuitions). Ses scènes d'amourettes sont d'une grande niaiserie, parfois même d'une bêtise confondante.
Mais le film fait rire allègrement les plus jeunes...
 Comme on me le fit remarquer à son terme, La chevauchée fantastique ne propose finalement "pas beaucoup d'aventures", seule l'anthologique attaque de la diligence par les Indiens pouvant être décrite comme telle. Le classique de Ford dispose une série de figures comme autant d'archétypes : la façon dont chaque voyageur est présenté au début de l'histoire, en le caractérisant avec beaucoup de vigueur et de netteté, est en cela très significative, sans même parler du cadre (la petite ville puis le désert), de la simplicité de l'argument, des différents évènements parsemant le périple.
Comme on me le fit remarquer à son terme, La chevauchée fantastique ne propose finalement "pas beaucoup d'aventures", seule l'anthologique attaque de la diligence par les Indiens pouvant être décrite comme telle. Le classique de Ford dispose une série de figures comme autant d'archétypes : la façon dont chaque voyageur est présenté au début de l'histoire, en le caractérisant avec beaucoup de vigueur et de netteté, est en cela très significative, sans même parler du cadre (la petite ville puis le désert), de la simplicité de l'argument, des différents évènements parsemant le périple.
Du point de vue narratif, cela rend parfois le déroulement un peu mécanique mais au niveau des personnages, ces hommes et ces femmes si "typés" au départ se voient magistralement "humanisés" par John Ford. Il n'y a qu'à voir la scène du repas lors de la première halte. Ringo Kid installe en bout de table Dallas mais Mrs Mallory et son "protecteur", le trouble Hatfield, se lèvent aussitôt pour s'éloigner. Une dame de la bonne société ne saurait se retrouver assise à côté d'une prostituée. Nous voilà choqués par cet ostracisme (d'autant plus qu'au sein de ce couple attachant qui est en train de se former, Ringo pense, à tort, que c'est lui, le fugitif, que l'on repousse) et prêts à mépriser ces Sudistes sans cœur. Or, après les plaintes, dents serrées, de Ringo et Dallas, que nous montre Ford ? Mrs Mallory et Hatfield à l'autre bout de la table, évocant avec émotion et retenue un passé commun que l'on imagine douloureux même si leurs propos restent flous pour le spectateur. Le recours à l'archétype n'implique pas forcément le manichéisme.
John Wayne en Ringo Kid apparaît jeune mais en quelque sorte déjà mûr. Le regard qu'il porte sur Dallas (Claire Trevor), fille de mauvaise vie, n'est pas naïf mais droit (il a décidé de l'aimer et ce n'est pas ce qu'il pourra apprendre de sa condition réelle qui le fera changer d'avis). Toutes les scènes, y compris les premières, les réunissant dégagent une incroyable émotion.
La chevauchée fantastique est célèbre pour l'attaque déjà évoquée (qui garde, il est vrai, toute sa force aujourd'hui encore) et pour ses plans de Monument Valley. On y trouve aussi du théâtre avec une orchestration rigoureuse dans des espaces réduits et, en certains endroits, de beaux exemples plastiques de l'expressionnisme fordien. On y trouve aussi, dans le final, ce mouvement incroyable de Wayne plongeant à terre pour tirer, lors de son face à face avec les trois frères Plummer et une ellipse foudroyante différant notre connaissance du dénouement.
 Toy story 3 est une source de plaisir continu. Il s'agit d'abord d'un film d'évasion mené à un rythme époustouflant (tout en gardant une lisibilité totale de l'action et l'espace nécessaire à l'approfondissement des personnages). Ensuite, il propose quelques images stupéfiantes, notamment lors de la longue séquence de la décharge avec ses sublimes visions de l'Enfer. La projection en 3D ne donne pas exactement le vertige mais la technique se révèle tout à fait appropriée pour ce film jouant sur l'animation de jouets et donc sur les changements d'échelle. Cette différence de perception autorise à trouver de la beauté et de l'étrangeté à un décor à priori banal ou criard comme le sont les salles de la garderie Sunnyside. Une machine vulgaire, telle un distributeur de friandises, peut de la même façon devenir un fantastique refuge à explorer.
Toy story 3 est une source de plaisir continu. Il s'agit d'abord d'un film d'évasion mené à un rythme époustouflant (tout en gardant une lisibilité totale de l'action et l'espace nécessaire à l'approfondissement des personnages). Ensuite, il propose quelques images stupéfiantes, notamment lors de la longue séquence de la décharge avec ses sublimes visions de l'Enfer. La projection en 3D ne donne pas exactement le vertige mais la technique se révèle tout à fait appropriée pour ce film jouant sur l'animation de jouets et donc sur les changements d'échelle. Cette différence de perception autorise à trouver de la beauté et de l'étrangeté à un décor à priori banal ou criard comme le sont les salles de la garderie Sunnyside. Une machine vulgaire, telle un distributeur de friandises, peut de la même façon devenir un fantastique refuge à explorer.
C'est également un film de groupe, le formidable travail d'écriture et l'invention dans l'animation permettant de développer les différents caractères sans qu'aucun protagoniste ne donne l'impression de faire son numéro au détriment de l'équipe, même lorsqu'il a son "temps fort" (et il y en a, parmi lesquels l'irrésistible histoire d'amour entre les fashion victims Ken et Barbie). Dans la duplicité de certains, dans la volonté de faire d'un nounours et d'un poupon les méchants de l'histoire, de filmer des bambins comme des monstres détruisant tout sur leur passage et de faire de Sunnyside une prison, se niche l'idée d'un retournement. Ces renversements sont grâcieusement réalisés et ne font pas verser le récit dans le second degré et l'ironie facile à destination unique des adultes.
Dernier tour de force réalisé : développer un discours sensible sur l'adieu à l'enfance, sur la séparation nécessaire, sur la transmission et sur les valeurs d'une communauté sans tomber dans la mièvrerie. Message à tendance conservatrice, certes... comme chez Ford.
PS : Je me souviens très mal du premier volet et je n'avais pas vu le deuxième.
*****
Le Corniaud (Gérard Oury / France - Italie / 1965) / ■□□□
La chevauchée fantastique (Stagecoach) (John Ford / Etats-Unis / 1939) / ■■■□
Toy Story 3 (Lee Unkrich / Etats-Unis / 2010) / ■■■□




 Tout est disjoint, rien ne raccorde. Cinéma de poésie m'objectera-t-on. Mais encore faudrait-il parvenir à créer un choc ou un flux. Or il ne subsiste ici qu'un déséquilibre entre chaque chose et finalement, une faille, un vide, un ennui. En premier lieu, le montage ne fait qu'heurter les plans les uns aux autres dans le sens où, même lorsqu'est posé un simple champ-contrechamp, même lorsqu'est organisé un échange de regards, jamais les personnages ne semblent se situer dans le même espace, dans le même temps. Le film débute dans une cour, au milieu du peuple, et dès la première séquence, le découpage échoue à établir une continuité spatiale et à décrire visuellement les liens qui unissent les personnages.
Tout est disjoint, rien ne raccorde. Cinéma de poésie m'objectera-t-on. Mais encore faudrait-il parvenir à créer un choc ou un flux. Or il ne subsiste ici qu'un déséquilibre entre chaque chose et finalement, une faille, un vide, un ennui. En premier lieu, le montage ne fait qu'heurter les plans les uns aux autres dans le sens où, même lorsqu'est posé un simple champ-contrechamp, même lorsqu'est organisé un échange de regards, jamais les personnages ne semblent se situer dans le même espace, dans le même temps. Le film débute dans une cour, au milieu du peuple, et dès la première séquence, le découpage échoue à établir une continuité spatiale et à décrire visuellement les liens qui unissent les personnages. Alberto Nardi est un industriel milanais poursuivi par ses créanciers et méprisé par sa femme qui l'appelle Cretinetti et qui refuse de lui donner le moindre sou, bien qu'elle possède une gigantesque fortune. En tant que bénéficiaire testamentaire, ses affaires semblent s'arranger le jour où cette dernière est portée disparue, suite à une catastrophe ferroviaire.
Alberto Nardi est un industriel milanais poursuivi par ses créanciers et méprisé par sa femme qui l'appelle Cretinetti et qui refuse de lui donner le moindre sou, bien qu'elle possède une gigantesque fortune. En tant que bénéficiaire testamentaire, ses affaires semblent s'arranger le jour où cette dernière est portée disparue, suite à une catastrophe ferroviaire. Rapidité et élégance sont les mots qui reviennent le plus souvent pour qualifier l'œuvre de Donen en général et Charade en particulier. Le lieu commun a forcément son fond de vérité. Il demande toutefois à être nuancé.
Rapidité et élégance sont les mots qui reviennent le plus souvent pour qualifier l'œuvre de Donen en général et Charade en particulier. Le lieu commun a forcément son fond de vérité. Il demande toutefois à être nuancé. Connaissez-vous Michele Apicella ? Vous devez au moins le revoir en jeune député adepte du water-polo (Palombella rossa, 1989)... Avec ce coffret, les Editions Montparnasse ont eu la bonne idée de nous permettre de remonter la piste jusqu'aux premières "vies" de notre homme, qui en connut beaucoup. On le découvre donc ici en comédien de théâtre d'avant-garde, en acteur de cinéma underground puis en cinéaste à la mode. Oui, celui-là même qui sera plus tard professeur de mathématiques (Bianca, 1984) et curé, sous le nom de Don Giulio (La messe est finie, 1985).
Connaissez-vous Michele Apicella ? Vous devez au moins le revoir en jeune député adepte du water-polo (Palombella rossa, 1989)... Avec ce coffret, les Editions Montparnasse ont eu la bonne idée de nous permettre de remonter la piste jusqu'aux premières "vies" de notre homme, qui en connut beaucoup. On le découvre donc ici en comédien de théâtre d'avant-garde, en acteur de cinéma underground puis en cinéaste à la mode. Oui, celui-là même qui sera plus tard professeur de mathématiques (Bianca, 1984) et curé, sous le nom de Don Giulio (La messe est finie, 1985). Je suis un autarcique laisse ainsi mitigé. Soumis aux contraintes du super-8 (brièveté des plans, fixité du cadre et absence de son direct), il prouve qu'avec peu, on peut arriver à faire sinon beaucoup, du moins quelque chose. Il est certain qu'entre deux blagues de potaches (très cultivés), Moretti parvient à capter un air du temps et, par moments, un mouvement réellement cinématographique mais son film est avant tout une succession de sketchs donnant une (fausse) impression d'improvisation entre amis. Peu séduisante esthétiquement, l'œuvre donne à voir plusieurs tentatives burlesques peu vigoureuses et mal assurées. Si l'on sourit assez souvent devant cette satire du théâtre d'avant-garde, on s'ennuie aussi parfois, comme lors d'un interminable stage en plein air. De plus, Je suis un autarcique est un film qui s'auto-analyse constamment, via l'aventure théâtrale qu'il raconte, qui s'auto-critique et qui finit par épuiser en quelque sorte la capacité personnelle du spectateur à juger par lui-même.
Je suis un autarcique laisse ainsi mitigé. Soumis aux contraintes du super-8 (brièveté des plans, fixité du cadre et absence de son direct), il prouve qu'avec peu, on peut arriver à faire sinon beaucoup, du moins quelque chose. Il est certain qu'entre deux blagues de potaches (très cultivés), Moretti parvient à capter un air du temps et, par moments, un mouvement réellement cinématographique mais son film est avant tout une succession de sketchs donnant une (fausse) impression d'improvisation entre amis. Peu séduisante esthétiquement, l'œuvre donne à voir plusieurs tentatives burlesques peu vigoureuses et mal assurées. Si l'on sourit assez souvent devant cette satire du théâtre d'avant-garde, on s'ennuie aussi parfois, comme lors d'un interminable stage en plein air. De plus, Je suis un autarcique est un film qui s'auto-analyse constamment, via l'aventure théâtrale qu'il raconte, qui s'auto-critique et qui finit par épuiser en quelque sorte la capacité personnelle du spectateur à juger par lui-même.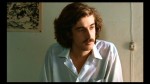 Ecce Bombo, qui pourrait être la suite du précédent, permet de retrouver les mêmes acteurs, regroupés ici en un club d'auto-conscience. L'observation d'un milieu est toujours la principale qualité du film mais la vision s'élargit, se faisant plus générationnelle, moins chargée de références et donc moins soumise à l'incompréhension due à l'éloignement dans le temps. La construction se fait à nouveau par saynètes mais celles-ci sont plus harmonieusement liées et plus fermement mises en scène. La distanciation de certaines est appréciable, Moretti entamant presque un dialogue direct avec le spectateur et utilisant la musique, la télévision et le cinéma comme autant d'éléments médiateurs de sa réflexion. Le désœuvrement et l'apathie de la jeunesse qu'il dépeint sont savoureusement moqués sans toutefois parvenir à éviter totalement un certain affaissement du récit. Le glissement vers la gravité qui s'opère alors donne au film de l'ampleur mais en diminue la vigueur. Le meilleur d'Ecce Bombo est à chercher en fait là où Nanni-Michele est le plus insupportable : en famille, entre les cris et les giffles.
Ecce Bombo, qui pourrait être la suite du précédent, permet de retrouver les mêmes acteurs, regroupés ici en un club d'auto-conscience. L'observation d'un milieu est toujours la principale qualité du film mais la vision s'élargit, se faisant plus générationnelle, moins chargée de références et donc moins soumise à l'incompréhension due à l'éloignement dans le temps. La construction se fait à nouveau par saynètes mais celles-ci sont plus harmonieusement liées et plus fermement mises en scène. La distanciation de certaines est appréciable, Moretti entamant presque un dialogue direct avec le spectateur et utilisant la musique, la télévision et le cinéma comme autant d'éléments médiateurs de sa réflexion. Le désœuvrement et l'apathie de la jeunesse qu'il dépeint sont savoureusement moqués sans toutefois parvenir à éviter totalement un certain affaissement du récit. Le glissement vers la gravité qui s'opère alors donne au film de l'ampleur mais en diminue la vigueur. Le meilleur d'Ecce Bombo est à chercher en fait là où Nanni-Michele est le plus insupportable : en famille, entre les cris et les giffles. Moretti a réalisé avec beaucoup plus de moyens Sogni d'oro. A lui Cinecitta, la Dolly et les mouvements d'appareils complexes... Le ton et les thèmes restent pourtant globalement les mêmes : difficultés à communiquer avec les autres autrement que par la violence des mots et des gestes, douleur de filmer, douleur de vivre. Entre les rires diffuse une tristesse certaine qui, alliée à une critique dévastatrice de la télévision, libère un parfum fellinien, le cinéaste des Vitelloni et de Ginger et Fred étant d'ailleurs le seul grand nom cité, explicitement ou pas, dans ces trois films de Moretti, sans aucune méchanceté. Avantageusement, le jeu avec les codes du cinéma remplace souvent, dans Sogni d'oro, les allusions à telle ou telle personnalité culturelle de l'époque. Le propos s'approfondit et la narration se complexifie. Des chutes de tension persistent mais se font moins brutales que par le passé et, gagnant en fluidité, le récit se fait enfin totalement cinématographique. Il reste à Moretti encore un peu de chemin à faire, à éviter notamment que certains gags ne tombent à plat. Avec Sogni d'oro, son cinéma est tout de même, cette fois, bien en place.
Moretti a réalisé avec beaucoup plus de moyens Sogni d'oro. A lui Cinecitta, la Dolly et les mouvements d'appareils complexes... Le ton et les thèmes restent pourtant globalement les mêmes : difficultés à communiquer avec les autres autrement que par la violence des mots et des gestes, douleur de filmer, douleur de vivre. Entre les rires diffuse une tristesse certaine qui, alliée à une critique dévastatrice de la télévision, libère un parfum fellinien, le cinéaste des Vitelloni et de Ginger et Fred étant d'ailleurs le seul grand nom cité, explicitement ou pas, dans ces trois films de Moretti, sans aucune méchanceté. Avantageusement, le jeu avec les codes du cinéma remplace souvent, dans Sogni d'oro, les allusions à telle ou telle personnalité culturelle de l'époque. Le propos s'approfondit et la narration se complexifie. Des chutes de tension persistent mais se font moins brutales que par le passé et, gagnant en fluidité, le récit se fait enfin totalement cinématographique. Il reste à Moretti encore un peu de chemin à faire, à éviter notamment que certains gags ne tombent à plat. Avec Sogni d'oro, son cinéma est tout de même, cette fois, bien en place. Le jour de la première de Close-up est une amusante pastille (déjà présente dans l'édition dvd du film d'Abbas Kiarostami), une poignée de scènes comiques, basées sur le perfectionnisme de Nanni Moretti directeur de salle de cinéma. Ce court souffre tout de même quelque peu d'un tournage en vidéo plutôt "relâché". Les trois minutes du Journal d'un spectateur (l'un des segments du programme collectif Chacun son cinéma) sont plus rigoureuses. Assis au milieu de salles vides, Moretti se rappelle de quelques projections mémorables, de celle du Ciel peut attendre à celle de Rocky Balboa. S'affirment là son sens du cadrage et son don pour la chute. Le cri d'angoisse de l'oiseau prédateur est lui un montage de 25 minutes réalisé à partir de séquences non retenues pour Aprile (1998). Malgré la recherche d'une chronologie, ce bout à bout peine à se muer en récit véritable. Le long métrage était lui-même construit de manière assez libre et son appendice propose une série de scènes et d'allusions pas toujours faciles à saisir. Il faut donc y picorer, souvent avec bonheur, comme lorsque l'on retrouve cette image restée dans les mémoires de Moretti tenant son bébé endormi sur son épaule et qui discoure cette fois sur le nouveau gouvernement de centre-gauche fraîchement installé au pouvoir.
Le jour de la première de Close-up est une amusante pastille (déjà présente dans l'édition dvd du film d'Abbas Kiarostami), une poignée de scènes comiques, basées sur le perfectionnisme de Nanni Moretti directeur de salle de cinéma. Ce court souffre tout de même quelque peu d'un tournage en vidéo plutôt "relâché". Les trois minutes du Journal d'un spectateur (l'un des segments du programme collectif Chacun son cinéma) sont plus rigoureuses. Assis au milieu de salles vides, Moretti se rappelle de quelques projections mémorables, de celle du Ciel peut attendre à celle de Rocky Balboa. S'affirment là son sens du cadrage et son don pour la chute. Le cri d'angoisse de l'oiseau prédateur est lui un montage de 25 minutes réalisé à partir de séquences non retenues pour Aprile (1998). Malgré la recherche d'une chronologie, ce bout à bout peine à se muer en récit véritable. Le long métrage était lui-même construit de manière assez libre et son appendice propose une série de scènes et d'allusions pas toujours faciles à saisir. Il faut donc y picorer, souvent avec bonheur, comme lorsque l'on retrouve cette image restée dans les mémoires de Moretti tenant son bébé endormi sur son épaule et qui discoure cette fois sur le nouveau gouvernement de centre-gauche fraîchement installé au pouvoir. Dans le corpus mis en avant ici, La Cosa est un morceau de choix, par sa longueur et sa singularité. Il s'agit d'un "pur" documentaire, sans intervention du cinéaste à l'image ou sur la bande son, qui s'attache à enregistrer la parole des militants du Parti Communiste Italien pendant l'hiver 1989, au moment où ont lieu les secousses que l'on sait du côté de l'Europe de l'Est et où la question se pose d'un changement de nom et d'un glissement vers la sociale-démocratie. Le film, commençant de manière plutôt frustrante (les interventions sont coupées très courtes, au risque du catalogue), trouve peu à peu son rythme, s'appuyant sur les différences d'élocution, de parcours et de ressentis, éclairant le poids du passé et les craintes de l'avenir. Il faut accepter une certaine répétition et un dispositif rudimentaire et attendre les quelques secondes finales pour que Moretti laisse enfin sa patte sur le travail. Ce n'est pas grand chose : un brouhaha soudain après tant de discours posés, des bribes de conversation véhémentes, inaudibles. Cela suffit pour brouiller les pistes, pour glisser du scepticisme, pour garder cette position du poil à gratter de la gauche. Cela suffit aussi, dans notre optique, pour faire le lien avec les débuts du cinéaste, pour boucler la boucle de ce voyage chez Nanni Moretti.
Dans le corpus mis en avant ici, La Cosa est un morceau de choix, par sa longueur et sa singularité. Il s'agit d'un "pur" documentaire, sans intervention du cinéaste à l'image ou sur la bande son, qui s'attache à enregistrer la parole des militants du Parti Communiste Italien pendant l'hiver 1989, au moment où ont lieu les secousses que l'on sait du côté de l'Europe de l'Est et où la question se pose d'un changement de nom et d'un glissement vers la sociale-démocratie. Le film, commençant de manière plutôt frustrante (les interventions sont coupées très courtes, au risque du catalogue), trouve peu à peu son rythme, s'appuyant sur les différences d'élocution, de parcours et de ressentis, éclairant le poids du passé et les craintes de l'avenir. Il faut accepter une certaine répétition et un dispositif rudimentaire et attendre les quelques secondes finales pour que Moretti laisse enfin sa patte sur le travail. Ce n'est pas grand chose : un brouhaha soudain après tant de discours posés, des bribes de conversation véhémentes, inaudibles. Cela suffit pour brouiller les pistes, pour glisser du scepticisme, pour garder cette position du poil à gratter de la gauche. Cela suffit aussi, dans notre optique, pour faire le lien avec les débuts du cinéaste, pour boucler la boucle de ce voyage chez Nanni Moretti.
 Une révision de la première trilogie Star Wars confirme entièrement l'impression laissée des années auparavant : les deux premiers épisodes sont bons, le troisième beaucoup moins. Jouant à la fois sur une trame classique et sur des nouveautés techniques et rythmiques, La guerre des étoiles, tient bien le coup, notamment dans la conduite du récit. Sans doute meilleur encore, L'Empire contre-attaque suit très habilement deux lignes narratives (l'apprentissage de Luke et les aventures de Leia et Solo) se croisant en peu d'endroits mais liées par un montage parallèle aux transitions soignées (le passage d'une scène à l'autre se fait harmonieusement en s'appuyant sur des postures, des situations ou des ambiances comparables). Se concluant par une série d'échecs, ce volet est de loin le plus sombre et le moins superficiel de la trilogie. En revanche, Le retour du Jedi, en ciblant un plus jeune public, s'enlise plus d'une fois dans la niaiserie, non seulement en multipliant les gentils gags autour des Ewoks mais aussi en faisant évoluer les rapports du trio Leia/Skywalker/Solo de manière angélique. La violence, y compris morale, est totalement absente. Ce troisième épisode, appliquant conventionnellement son programme, n'a pour lui que ses compétences techniques, indéniables et toujours grisantes. L'insertion postérieure, par George Lucas, dans les trois films, de quelques images de synthèse est une aberration esthétique brisant la cohérence parfaite de ces objets. Cette bêtise annonce le naufrage de la trilogie suivante, un sommet de laideur.
Une révision de la première trilogie Star Wars confirme entièrement l'impression laissée des années auparavant : les deux premiers épisodes sont bons, le troisième beaucoup moins. Jouant à la fois sur une trame classique et sur des nouveautés techniques et rythmiques, La guerre des étoiles, tient bien le coup, notamment dans la conduite du récit. Sans doute meilleur encore, L'Empire contre-attaque suit très habilement deux lignes narratives (l'apprentissage de Luke et les aventures de Leia et Solo) se croisant en peu d'endroits mais liées par un montage parallèle aux transitions soignées (le passage d'une scène à l'autre se fait harmonieusement en s'appuyant sur des postures, des situations ou des ambiances comparables). Se concluant par une série d'échecs, ce volet est de loin le plus sombre et le moins superficiel de la trilogie. En revanche, Le retour du Jedi, en ciblant un plus jeune public, s'enlise plus d'une fois dans la niaiserie, non seulement en multipliant les gentils gags autour des Ewoks mais aussi en faisant évoluer les rapports du trio Leia/Skywalker/Solo de manière angélique. La violence, y compris morale, est totalement absente. Ce troisième épisode, appliquant conventionnellement son programme, n'a pour lui que ses compétences techniques, indéniables et toujours grisantes. L'insertion postérieure, par George Lucas, dans les trois films, de quelques images de synthèse est une aberration esthétique brisant la cohérence parfaite de ces objets. Cette bêtise annonce le naufrage de la trilogie suivante, un sommet de laideur. La première partie de La grande vadrouille (l'arrivée à Paris des trois parachutistes anglais en trois endroits différents) est vraiment réussie et presque constamment drôle, surtout, bien sûr, les séquences à l'Opéra. Le seul gag vraiment absurde est génial (De Funès cognant sa perruque posée à côté de lui et se faisant mal au crâne) et fait regretter qu'il n'y en ait pas d'autres. Le rythme faiblit sérieusement avec le périple vers l'auberge pour ne repartir qu'avec la tentative de passage en zone libre. Les quiproquos dans la Kommandantur sont sympathiques mais la réussite de la séquence tient plus à l'abattage des comédiens et aux croisements orchestrés par le scénario qu'à la mise en scène. Celle-ci reste assez plate, malgré quelques cadrages plus inventifs que d'habitude, et Oury ne sait absolument pas filmer la vitesse et l'action. Grâce à Marie Dubois, la bluette réservée à Bourvil est un peu plus supportable qu'ailleurs. Bien évidemment, le moindre Français croisé dans l'aventure est prêt à aider tout le monde, au nez et à la barbe des occupants.
La première partie de La grande vadrouille (l'arrivée à Paris des trois parachutistes anglais en trois endroits différents) est vraiment réussie et presque constamment drôle, surtout, bien sûr, les séquences à l'Opéra. Le seul gag vraiment absurde est génial (De Funès cognant sa perruque posée à côté de lui et se faisant mal au crâne) et fait regretter qu'il n'y en ait pas d'autres. Le rythme faiblit sérieusement avec le périple vers l'auberge pour ne repartir qu'avec la tentative de passage en zone libre. Les quiproquos dans la Kommandantur sont sympathiques mais la réussite de la séquence tient plus à l'abattage des comédiens et aux croisements orchestrés par le scénario qu'à la mise en scène. Celle-ci reste assez plate, malgré quelques cadrages plus inventifs que d'habitude, et Oury ne sait absolument pas filmer la vitesse et l'action. Grâce à Marie Dubois, la bluette réservée à Bourvil est un peu plus supportable qu'ailleurs. Bien évidemment, le moindre Français croisé dans l'aventure est prêt à aider tout le monde, au nez et à la barbe des occupants. Océans est un beau documentaire animalier, aux images parfois impressionnantes. Il ne faut pas en attendre plus. La "scénarisation" des séquences n'est pas excessive et surtout, le discours écologique est simple et direct, heureusement dénué du moralisme culpabilisateur de
Océans est un beau documentaire animalier, aux images parfois impressionnantes. Il ne faut pas en attendre plus. La "scénarisation" des séquences n'est pas excessive et surtout, le discours écologique est simple et direct, heureusement dénué du moralisme culpabilisateur de  La nuit au musée (rien que le titre, on pense déjà aux Marx Brothers) est une amusante comédie. La technique est impeccable, qui s'efforce d'animer toute la collection d'un Museum d'Histoire Naturelle, une fois la nuit tombée. On trouve peu de chutes de rythme, l'alternance du calme de la journée et de la furie nocturne étant bien géré. Le message véhiculé par cette histoire de père de famille paumé et divorcé qui regagne l'estime de son fils n'a certes rien de nouveau et le trio des vieux veilleurs de nuit qui s'avèrent être les méchants du film n'a rien de mémorable. L'intérêt tient plutôt dans l'aspect régressif du personnage de Ben Stiller. Cela ne donne pas toujours un résultat très fin (ni très drôle) mais cela intrigue plutôt, tout comme le font ces ruptures de rythme, assez étonnantes, en pleine folie ambiante (l'irrésistible psychanalyse d'Attila). (*)
La nuit au musée (rien que le titre, on pense déjà aux Marx Brothers) est une amusante comédie. La technique est impeccable, qui s'efforce d'animer toute la collection d'un Museum d'Histoire Naturelle, une fois la nuit tombée. On trouve peu de chutes de rythme, l'alternance du calme de la journée et de la furie nocturne étant bien géré. Le message véhiculé par cette histoire de père de famille paumé et divorcé qui regagne l'estime de son fils n'a certes rien de nouveau et le trio des vieux veilleurs de nuit qui s'avèrent être les méchants du film n'a rien de mémorable. L'intérêt tient plutôt dans l'aspect régressif du personnage de Ben Stiller. Cela ne donne pas toujours un résultat très fin (ni très drôle) mais cela intrigue plutôt, tout comme le font ces ruptures de rythme, assez étonnantes, en pleine folie ambiante (l'irrésistible psychanalyse d'Attila). (*) A Serious mana déjà été amplement commenté, dans un enthousiasme quasi-unanime. Je n'irai pas à contre-courant et je me limiterai donc à faire quelques remarques générales, de peur d'être trop redondant par rapport aux divers écrits de mes camarades blogueurs.
A Serious mana déjà été amplement commenté, dans un enthousiasme quasi-unanime. Je n'irai pas à contre-courant et je me limiterai donc à faire quelques remarques générales, de peur d'être trop redondant par rapport aux divers écrits de mes camarades blogueurs. L'âge d'or de la Roumanie : ainsi était qualifiée par la propagande de Ceaucescu la traversée des années 80. Les réalisateurs de cet ouvrage collectif retournent ironiquement l'expression pour traiter une poignée d'histoires tragi-comiques inspirées des "légendes" de l'époque. Contes de l'âge d'or (Amintiri din epoca de aur) prend la forme d'un film à sketchs dont le nombre semble varier d'une copie à l'autre. Celle présentée au festival de Pessac en contenait quatre, celle du dernier festival de Cannes, cinq, et une version intégrale devrait apparemment en compter six. Aucun de ces segments n'est "signé", l'ensemble du projet étant coordonné par l'auteur de
L'âge d'or de la Roumanie : ainsi était qualifiée par la propagande de Ceaucescu la traversée des années 80. Les réalisateurs de cet ouvrage collectif retournent ironiquement l'expression pour traiter une poignée d'histoires tragi-comiques inspirées des "légendes" de l'époque. Contes de l'âge d'or (Amintiri din epoca de aur) prend la forme d'un film à sketchs dont le nombre semble varier d'une copie à l'autre. Celle présentée au festival de Pessac en contenait quatre, celle du dernier festival de Cannes, cinq, et une version intégrale devrait apparemment en compter six. Aucun de ces segments n'est "signé", l'ensemble du projet étant coordonné par l'auteur de