(Jacques Audiard / France / 2009)
■■■□
 Un prophète était probablement l'un des plus sérieux prétendants à la Palme d'or du dernier festival de Cannes, sera assurément bien placé dans ma liste de fin d'année et s'impose pour l'instant comme le meilleur film français sorti en 2009. J'avoue toutefois qu'il m'est assez difficile d'en rendre compte. Ce nouvel Audiard m'a laissé sur une étrange sensation de film inattaquable. Je ne parle pas ici d'un éventuel étalage de bonnes intentions (on n'y trouve pas, fort heureusement, la prudence qui tétanise la majorité des cinéastes lorsqu'ils se penchent sur les réglements de comptes communautaires, prudence qui trahit leur peur de voir leurs histoires particulières être prises pour des généralités et qui les pousse au final à ne rien dire du tout de la réalité). Non, je parle en fait de la difficulté extrême qu'il y a à s'y agripper et à en tirer quelques fils. Je me trompe peut-être mais il me semble ne pas être le seul à avoir ainsi buter quelque peu contre sa surface (si celle de Dasola est assez enthousiaste, les notes d'autres blogueurs émérites comme Vincent et Rob Gordon laissent paraître une admiration très contenue). L'attente était-elle trop forte, après les échos, prolongés tout l'été, de l'excellent accueil cannois ? Il y a de cela, mais pas seulement.
Un prophète était probablement l'un des plus sérieux prétendants à la Palme d'or du dernier festival de Cannes, sera assurément bien placé dans ma liste de fin d'année et s'impose pour l'instant comme le meilleur film français sorti en 2009. J'avoue toutefois qu'il m'est assez difficile d'en rendre compte. Ce nouvel Audiard m'a laissé sur une étrange sensation de film inattaquable. Je ne parle pas ici d'un éventuel étalage de bonnes intentions (on n'y trouve pas, fort heureusement, la prudence qui tétanise la majorité des cinéastes lorsqu'ils se penchent sur les réglements de comptes communautaires, prudence qui trahit leur peur de voir leurs histoires particulières être prises pour des généralités et qui les pousse au final à ne rien dire du tout de la réalité). Non, je parle en fait de la difficulté extrême qu'il y a à s'y agripper et à en tirer quelques fils. Je me trompe peut-être mais il me semble ne pas être le seul à avoir ainsi buter quelque peu contre sa surface (si celle de Dasola est assez enthousiaste, les notes d'autres blogueurs émérites comme Vincent et Rob Gordon laissent paraître une admiration très contenue). L'attente était-elle trop forte, après les échos, prolongés tout l'été, de l'excellent accueil cannois ? Il y a de cela, mais pas seulement.
Dans Un prophéte, chaque séquence semble évidente, par son traitement esthétique, par le jeu d'acteur qu'elle donne à voir et par sa place au sein d'un scénario parfaitement agencé. L'évidence laisse-t-elle sans voix ? L'entrée en matière est absolument remarquable. Malik est envoyé en Centrale pour 6 ans et découvre la taule. On suit son arrivée, le dépôt de ses vêtements, la fouille, l'entretien avec le surveillant, la plongée dans cette lumière si particulière et les premiers croisements de regards qui font baisser les yeux. Audiard n'a pas besoin de nous jeter à la figure des bastonnades et des tortures stylisées à la Hunger pour faire affleurer la crainte et l'envie d'être n'importe où sauf ici. Le lieu (construit pour le tournage, si j'ai bien suivi) est investi de manière extraordinaire, notamment en visualisant les tensions entre les différents clans à travers leur occupation du territoire de la prison (les différents bâtiments, les différentes parcelles dans la cour, les différents lieux de rendez-vous des caïds).
Manipulé et poussé à tuer un détenu gênant, Malik se retrouve sous la protection du Corse Luciani, qui le prend sous son aile et lui fait de plus en plus confiance. Au milieu des nationalistes, Malik reste toutefois "l'Arabe", tandis que les "Barbus" le traîtent de sale Corse. Il semble coincé, mais, profitant des "leçons" et des connaissances de Luciani (à l'insu de ce dernier) et d'un régime de semi-liberté, il parvient à se frayer son chemin en navigant dangereusement mais intelligemment entre les diverses mafias italiennes, corses, arabes et gitanes. La ronde criminelle qui se joue sous nos yeux est absolument passionnante, le système de réseaux multiples faisant rebondir d'un groupe à l'autre en élargissant sans cesse le champ d'action, tout en restant relié au centre névralgique que constitue la prison. La description des trafics et de la vie quotidienne à la Centrale est striée par des séquences de thriller impeccablement rythmées et fortement incarnées. Peut-être Audiard aurait-il pu assêcher encore son film en s'en tenant à cette observation et à ces griffures car les trouées irréelles, bien qu'elles marchent la plupart du temps (le fantôme de l'homme tué montrant à nouveau une évidence : la hantise d'un acte insoutenable), se trouvent légèrement en-deça du reste.
En plus du plaisir de voir enfin un cinéaste français qui ne prenne pas de gants pour filmer la criminalité dans son pays, à la suite de certains américains et italiens, j'ai apprécié, comme tout le monde, l'interprétation d'ensemble, la solidité du scénario, le retour sur la thématique du lien filial construit et coupé, la gestion du temps (plus de 2h30 sans regarder sa montre) et l'équilibre tenu entre la fascination et la répulsion (jusqu'à la scène finale).
Alors quoi ? Audiard, après trois films déjà remarquables, avait passé un palier avec De battre mon coeur s'est arrêté (2004), entre autres grâce à la mise en scène des corps, au travail réalisé avec Romain Duris, à l'appel du pied vers le meilleur cinéma américain des années 70 (à propos d'Un prophète, on pourrait très injustement ironiser sur l'inscription scorsesienne, en arrêt sur image, des noms de certains personnages dans un coin de l'écran, en disant que l'on s'attend presque à entendre débouler les Rolling Stones sur la bande-son, mais Audiard, très raisonnablement, module son effet au fil du temps). Les mêmes qualités se retrouvent d'un film à l'autre et on sent qu'il ne reste plus qu'une marche à gravir, vraiment pas loin, celle qui mène au chef-d'oeuvre. Peut-être faudra-t-il revoir Un prophète dans dix ans pour décider s'il se tient toujours juste en dessous du meilleur film français sur le sujet (Le Trou de Jacques Becker) ou s'il en est l'égal.
 On ne peut pas dire que Les derniers jours du monde, le nouveau film des frères Larrieu, soit tendu comme un string, tant au niveau du scénario qu'à celui de la mise en scène. Ça flotte, ça tangue, ça digresse, ça monte, ça descend, c'est de l'à-peu-près et du n'importe quoi, c'est foutrement inégal et, en bout de course, fichtrement intéressant.
On ne peut pas dire que Les derniers jours du monde, le nouveau film des frères Larrieu, soit tendu comme un string, tant au niveau du scénario qu'à celui de la mise en scène. Ça flotte, ça tangue, ça digresse, ça monte, ça descend, c'est de l'à-peu-près et du n'importe quoi, c'est foutrement inégal et, en bout de course, fichtrement intéressant. Chicago et ses environs, 1933-1934 : John Dillinger braque des banques, est traqué par l'agent Melvin Purvis, s'évade de prison, tombe amoureux de la jolie Billie, voit ses compagnons tomber un à un et finit plombé par la police à la sortie d'un cinéma.
Chicago et ses environs, 1933-1934 : John Dillinger braque des banques, est traqué par l'agent Melvin Purvis, s'évade de prison, tombe amoureux de la jolie Billie, voit ses compagnons tomber un à un et finit plombé par la police à la sortie d'un cinéma. Oui...
Oui...
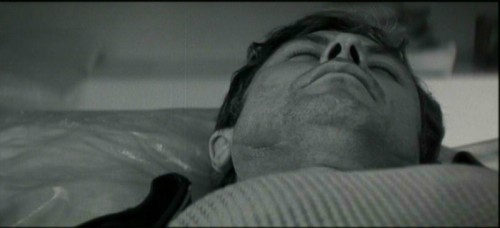

 Prologue : Un chauffeur de taxi conduit un mystérieux passager, immobile et muet (on reconnaît dans l'ombre la silhouette de l'acteur-cinéaste). En cours de route, la pluie se met à tomber, l'orage gronde, les éléments se déchaînent, la radio ne répond plus. L'homme au volant ne retrouve pas son chemin et se demande à voix haute "Où suis-je ?". Le réponse s'affiche alors sur le noir de l'écran : comme nous, il vient de tomber dans Le temps qu'il reste (The time that remains), une fiction d'Elia Suleiman.
Prologue : Un chauffeur de taxi conduit un mystérieux passager, immobile et muet (on reconnaît dans l'ombre la silhouette de l'acteur-cinéaste). En cours de route, la pluie se met à tomber, l'orage gronde, les éléments se déchaînent, la radio ne répond plus. L'homme au volant ne retrouve pas son chemin et se demande à voix haute "Où suis-je ?". Le réponse s'affiche alors sur le noir de l'écran : comme nous, il vient de tomber dans Le temps qu'il reste (The time that remains), une fiction d'Elia Suleiman. Chouchouté par
Chouchouté par  Le troisième film d'Eric Rohmer intéresse avant tout aujourd'hui d'une part par son inscription dans un mouvement artistique précis, celui de la Nouvelle Vague dont il intègre les principales composantes (tournage dans les rues, jeunesse des protagonistes, goût pour la provocation verbale ou comportementale) et d'autre part par son appartenance à la série des Contes moraux. Deuxième numéro de cette collection, après La boulangère de Monceau, La carrière de Suzanne, comme les autres opus rohmériens, part d'une proposition narrative claire et semble établir un programme tout en s'ingéniant à l'ouvrir au final à l'imprévu. Hâtons-nous de préciser que le film n'égale ni les meilleures oeuvres des jeunes camarades regroupés sous l'étiquette NV, ni les Rohmer suivants (lequel ne donne vraiment la mesure de son immense talent, à mon sens, qu'à partir de Ma nuit chez Maud en 1969).
Le troisième film d'Eric Rohmer intéresse avant tout aujourd'hui d'une part par son inscription dans un mouvement artistique précis, celui de la Nouvelle Vague dont il intègre les principales composantes (tournage dans les rues, jeunesse des protagonistes, goût pour la provocation verbale ou comportementale) et d'autre part par son appartenance à la série des Contes moraux. Deuxième numéro de cette collection, après La boulangère de Monceau, La carrière de Suzanne, comme les autres opus rohmériens, part d'une proposition narrative claire et semble établir un programme tout en s'ingéniant à l'ouvrir au final à l'imprévu. Hâtons-nous de préciser que le film n'égale ni les meilleures oeuvres des jeunes camarades regroupés sous l'étiquette NV, ni les Rohmer suivants (lequel ne donne vraiment la mesure de son immense talent, à mon sens, qu'à partir de Ma nuit chez Maud en 1969). J'ai tué ma mère est revigorant comme une chanson punk. Du punk tendance
J'ai tué ma mère est revigorant comme une chanson punk. Du punk tendance