(Ulrich Seidl / Autriche / 2007)
■■■□
 Près de deux ans après sa séléction officielle au festival de Cannes, où il fut plutôt mal reçu (ce qui explique assurément ce décalage), nous pouvons enfin nous frotter depuis janvier au deuxième long métrage de fiction d'Ulrich Seidl, cet Import Export qui vient après un Dog days déjà peu consensuel.
Près de deux ans après sa séléction officielle au festival de Cannes, où il fut plutôt mal reçu (ce qui explique assurément ce décalage), nous pouvons enfin nous frotter depuis janvier au deuxième long métrage de fiction d'Ulrich Seidl, cet Import Export qui vient après un Dog days déjà peu consensuel.
Import : Olga, infirmière en Ukraine, ne s'en sort pas avec son bébé, sa mère, son salaire de misère et son appartement sans eau courante. Après avoir tenté une expérience d'hôtesse sexuelle par webcam, elle a enfin l'opportunité de rejoindre une amie en Autriche. Là-bas, elle accumule les petits boulots de femme de ménage, jusqu'à être employée, pour ce même poste, dans un service de gériatrie. Malgré le profond mépris qu'éprouve à son encontre l'infirmière en place, elle se lie fortement aux différents patients.
Export : A Vienne, Pauli, toujours à court d'argent, perd son job d'agent de sécurité après s'être fait tabassé par un petit gang de Turcs. Il vit chez sa mère et son père (ou son beau-père ?), Michael, avec qui il s'engueule régulièrement. Eux deux se voient chargés de livrer des jeux et des distributeurs de bonbons, avec leur camionnette, jusqu'en Slovaquie et en Ukraine. Tout au long du voyage, le père n'aura de cesse de provoquer son fils, l'envoyant seul dans un immeuble coupe-gorge, le poussant à draguer avec lui les filles de bars et lui imposant enfin d'assister à un petit jeu pervers avec une prostituée.
A travers ces deux histoires, que l'on suit en parallèle, Seidl peint de manière impressionnante un univers sordide qui englobe aussi bien les pays de l'Est que nos contrées occidentales car, que l'on se place d'un côté où de l'autre, que l'on fasse le trajet de gauche à droite ou de droite à gauche, le constat est le même, terrifiant : paysages hivernaux, habitats insalubres, chambres d'hôtels tristes, pavillons de mauvais goût et surtout, humiliations continuelles... Les deux récits croisés avancent mais les trajectoires semblent s'annuler et au final, nous resterons bloqué dans la pénombre de cette chambre d'hôpital, au milieu de ces vieilles femmes clouées au lit, entendant l'une d'elles répéter inlassablement "Ca pue... Mort... Mort...". Le monde, vu par Seidl, est en train de crever. Son film est cru, affreux, désespérant... et assez fascinant.
Tout d'abord, la construction est absolument imparable : d'une part, le montage, très sec, rend le sentiment de l'inéluctable dans le va-et-vient régulier entre les histoires d'Olga et de Pauli et d'autre part, l'alternance permet la mise en place d'un subtil système d'échos d'un récit à l'autre (des situations ou des postures qui se répondent ou s'opposent malicieusement mais jamais mécaniquement). Les cadrages sont souvent fixes et frontaux mais savent aussi se libérer lorsqu'il le faut et Seidl gère précisément la durée de ses plans, jamais ennuyeux. Bien des choses difficiles sont enregistrées par la caméra, mais la puissance de ce cinéma n'est peut-être nulle par ailleurs aussi évidente que dans la très brève scène où Pauli laisse son chien déchiqueter un ours en peluche. L'image vient au terme d'une séquence dans laquelle le jeune homme débarque sans prévenir avec son nouveau molosse chez sa copine qui, craignant beaucoup les chiens, commence à paniquer totalement. A la fin, donc, Seidl coupe court au dialogue et raccorde sur un plan où il ne laisse dans le cadre que Pauli et son chien s'excitant sur le nounours. On ne voit ni n'entend plus la fille. Où est-elle passée ? Fin de la séquence, on passe à autre chose, on n'entendra plus parler d'elle.
Le parcours suivi par les deux protagonistes, qui ne se rencontrent jamais, est jalonné d'étapes humiliantes. Si éprouvantes qu'elles soient, ces épreuves traduisent surtout une chose : la résistance des corps et de l'esprit à la barbarie. Jamais nous ne voyons Olga ou Pauli s'effondrer réellement. Aucun pathos, aucun apitoiement. Même au coeur de la violence et du sordide, il y a cette force inébranlable des deux personnages. Voilà l'une des raisons de l'absence de complaisance et de spectaculaire malsain dans Import Export. De plus, si Seidl compose des plans élaborés et filme un environnement oppressant, il semble nous laisser toujours une certaine liberté, une échapatoire, une lueur, par ces cadrages qui laissent beaucoup d'espace au dessus des personnages, par ce rire jaune qui naît du grotesque, par l'attachement indéfectible qui finit par nous lier à Olga et Pauli, toute latitude que nous refusait récemment Steve McQueen avec Hunger, autre film-choc bien mieux reçu lui, puisque là, la cause à défendre était indiscutable. Les rares critiques enthousiasmés par Import Export insistent assez sur la dimension politique du film. Mais il faut préciser que Seidl ne vise pas le Cyber-Sex, la Prostitution, le Marché Noir, le Gangstérisme, le Capitalisme ou que sais-je encore avec des majuscules. Non, il pointe des actes précis et personnalisés qui traduisent les penchants de la plupart des êtres humains pour l'humiliation de l'autre, se gargarisant ainsi de leur illusion de toute puissance. Le fait qu'une partie de ces actes ouvertement violents ou plus insidieux soit perpétrée par des personnes sensées être responsables ou protectrices (pères et mères de famille, patron d'entreprise, consultant pour chômeurs, infirmière) ne fait qu'accentuer le sentiment de fin du monde.
Les gestes d'Olga et de Pauli ne sont peut-être que des gestes de retrait, mais dans cet univers-là, ils prennent presque valeur de révolte, d'espoir en tout cas. Ulrich Seidl est décidément un sacré cinéaste.
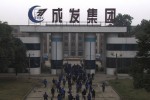 Moi qui, il y a peu, trouvais que l'année cinéma 2009 démarrait bien et promettait une belle moisson dès le printemps, je commence à déchanter sérieusement. Je prie pour que le prochain Barnum cannois change la donne, sans quoi je vais finir par limiter mon activité de cinéphile au cercle domestique et à la chronique de dvd (sur lesquelles j'ai d'ailleurs du retard). La déconvenue du jour vient de Jia Zhangke, duquel j'attendais pourtant beaucoup. Mais après avoir trouvé ses trois premiers longs-métrages admirables (Xiao Wu pickpocket, Platform, Unknown pleasures) puis émis quelques réserves sur les deux suivants (The World, Still life), il était sans doute fatal que le sixième m'ennuie pour de bon.
Moi qui, il y a peu, trouvais que l'année cinéma 2009 démarrait bien et promettait une belle moisson dès le printemps, je commence à déchanter sérieusement. Je prie pour que le prochain Barnum cannois change la donne, sans quoi je vais finir par limiter mon activité de cinéphile au cercle domestique et à la chronique de dvd (sur lesquelles j'ai d'ailleurs du retard). La déconvenue du jour vient de Jia Zhangke, duquel j'attendais pourtant beaucoup. Mais après avoir trouvé ses trois premiers longs-métrages admirables (Xiao Wu pickpocket, Platform, Unknown pleasures) puis émis quelques réserves sur les deux suivants (The World, Still life), il était sans doute fatal que le sixième m'ennuie pour de bon. Dans la brume électrique (In the electric mist), directed byBertrand Tavernier, est un polar d'ambiance, estimable et soigné, mais trop classique pour que l'on ne s'étonne pas d'un accueil critique aussi enthousiaste (jusque dans feu-Les Inrockuptibles et dans les Cahiers !, si j'en crois
Dans la brume électrique (In the electric mist), directed byBertrand Tavernier, est un polar d'ambiance, estimable et soigné, mais trop classique pour que l'on ne s'étonne pas d'un accueil critique aussi enthousiaste (jusque dans feu-Les Inrockuptibles et dans les Cahiers !, si j'en crois  Fred, surnommé Chéri, est un jeune homme nageant dans les eaux d'un demi-monde aisé, celui des courtisanes vieillissantes de la fin de la Belle Époque, dont fait partie sa mère et sa protectrice favorite, Léa. Cette dernière passe bientôt du statut de "marraine" de Chéri à celui de maîtresse. Malgré la différence d'âge, la liaison est passionnée et semble indestructible, jusqu'à l'annonce d'un mariage arrangé qui sépare les deux amants avant des retrouvailles douloureuses. Christopher Hampton adapte Colette pour Stephen Frears et Michelle Pfeiffer joue Léa. Le trio des Liaisons dangereuses est ainsi reformé. J'ai eu beau chercher, je n'ai trouvé à Chéri absolument aucune des qualités du beau film d'il y a vingt ans...
Fred, surnommé Chéri, est un jeune homme nageant dans les eaux d'un demi-monde aisé, celui des courtisanes vieillissantes de la fin de la Belle Époque, dont fait partie sa mère et sa protectrice favorite, Léa. Cette dernière passe bientôt du statut de "marraine" de Chéri à celui de maîtresse. Malgré la différence d'âge, la liaison est passionnée et semble indestructible, jusqu'à l'annonce d'un mariage arrangé qui sépare les deux amants avant des retrouvailles douloureuses. Christopher Hampton adapte Colette pour Stephen Frears et Michelle Pfeiffer joue Léa. Le trio des Liaisons dangereuses est ainsi reformé. J'ai eu beau chercher, je n'ai trouvé à Chéri absolument aucune des qualités du beau film d'il y a vingt ans... Le rude quotidien d'une famille d'éleveurs kazakhs, en pleine steppe, et les espoirs d'Asa, le jeune frère de la mère. Le sujet du film appelle la captation de paysages grandioses et la méditation devant les grands espaces mais par sa mise en scène, Sergey Dvortsevoy refuse d'un bout à l'autre cette posture. Tulpan s'ouvre par un plan dont la surface est envahie, brutalisée, agressée. Ce qui s'avère être un troupeau de moutons met un certain temps à évacuer le cadre et à laisser enfin le lieu du récit être indentifié (la yourte plantée au milieu de nulle part). Poussière ou bruit, tout fait écran, du début à la fin (comme Tulpan, la fille que convoite Asa, restera cachée jusqu'au bout, derrière un rideau ou une porte). Ce ne sont pas seulement les objets qui font obstruction : les corps prennent toute la place, cadrés à la poitrine ou traversant incessamment le champ, à l'image du petit dernier de la famille, intenable.
Le rude quotidien d'une famille d'éleveurs kazakhs, en pleine steppe, et les espoirs d'Asa, le jeune frère de la mère. Le sujet du film appelle la captation de paysages grandioses et la méditation devant les grands espaces mais par sa mise en scène, Sergey Dvortsevoy refuse d'un bout à l'autre cette posture. Tulpan s'ouvre par un plan dont la surface est envahie, brutalisée, agressée. Ce qui s'avère être un troupeau de moutons met un certain temps à évacuer le cadre et à laisser enfin le lieu du récit être indentifié (la yourte plantée au milieu de nulle part). Poussière ou bruit, tout fait écran, du début à la fin (comme Tulpan, la fille que convoite Asa, restera cachée jusqu'au bout, derrière un rideau ou une porte). Ce ne sont pas seulement les objets qui font obstruction : les corps prennent toute la place, cadrés à la poitrine ou traversant incessamment le champ, à l'image du petit dernier de la famille, intenable.
 Cette longue introduction désabusée pour évoquer brièvement L'autre, film attendu, film ambitieux, film à moitié réussi, film à moitié raté. Patrick Mario Bernard et Pierre Trividic ont décidé d'aborder le thème de la folie et là réside à mon avis, le défaut de l'oeuvre. Même s'ils s'attachent à un personnage défini, ils décrivent moins un cas précis (comme l'a si puissamment fait Kerrigan avec Keane) qu'ils ne parlent du problème "en général", qu'ils l'illustrent. La mise en scène est surchargée de signes : champ large mais constamment obstrué par des caches en amorce, caméra fébrile et près des visages, bande son inquiétante, jeux de miroirs, raccords déstabilisants, ambiances nocturnes irréelles... Le sous-texte est lui aussi excessif : références à la magie et à l'antiquité, omniprésence de l'alcool, contamination de la misère sociale, caractère liberticide des nouvelles technologies... Cette insistance dans la forme et le fond semble traduire un manque de confiance dans la capacité (pourtant réelle chez les cinéastes) à emmener le spectateur aux confins du fantastique. Donnée pour perturbée dès le départ, l'héroïne, comme la mise en scène, n'évolue pas (alors que la description d'un glissement progressif vers la folie aurait été certainement plus satisfaisant, vu ce que peut proposer par moments Dominique Blanc, dans la modulation de sa voix par exemple). Dans L'autre, nous ne voyons pas le monde par les yeux du personnage, mais nous regardons celui-ci s'y débattre. Cela peut faire toute la différence entre un film bouleversant et un exercice de style brillant mais vain.
Cette longue introduction désabusée pour évoquer brièvement L'autre, film attendu, film ambitieux, film à moitié réussi, film à moitié raté. Patrick Mario Bernard et Pierre Trividic ont décidé d'aborder le thème de la folie et là réside à mon avis, le défaut de l'oeuvre. Même s'ils s'attachent à un personnage défini, ils décrivent moins un cas précis (comme l'a si puissamment fait Kerrigan avec Keane) qu'ils ne parlent du problème "en général", qu'ils l'illustrent. La mise en scène est surchargée de signes : champ large mais constamment obstrué par des caches en amorce, caméra fébrile et près des visages, bande son inquiétante, jeux de miroirs, raccords déstabilisants, ambiances nocturnes irréelles... Le sous-texte est lui aussi excessif : références à la magie et à l'antiquité, omniprésence de l'alcool, contamination de la misère sociale, caractère liberticide des nouvelles technologies... Cette insistance dans la forme et le fond semble traduire un manque de confiance dans la capacité (pourtant réelle chez les cinéastes) à emmener le spectateur aux confins du fantastique. Donnée pour perturbée dès le départ, l'héroïne, comme la mise en scène, n'évolue pas (alors que la description d'un glissement progressif vers la folie aurait été certainement plus satisfaisant, vu ce que peut proposer par moments Dominique Blanc, dans la modulation de sa voix par exemple). Dans L'autre, nous ne voyons pas le monde par les yeux du personnage, mais nous regardons celui-ci s'y débattre. Cela peut faire toute la différence entre un film bouleversant et un exercice de style brillant mais vain. Un peu désarmé devant ce téléfilm qui m'a tenu jusqu'au bout mais qui ne me parle absolument pas. Isabelle Adjani y joue une prof de français à bout de nerf prenant en otage sa classe de collégiens agités. L'invraisemblance du postulat semble tout d'abord bien assumée puisque l'on croit se diriger vers un huis-clos fortement théâtralisé et se détachant petit à petit du réel. Malheureusement nous ne sommes pas au théâtre, mais à la télévision et la machinerie de la fiction à la française prend vite le dessus, traitant également ce qui se passe à l'extérieur des murs : vignettes humoristiques consacrées au personnel enseignant, emballement médiatique et tractations avec le RAID, dirigé par un improbable Denis Podalydès. Le film se veut tragi-comique, bousculant le politiquement correct. Certes, deux ou trois répliques arrivent à faire sourire, mais toutes les autres tombent à l'eau : elles sentent trop le bon mot de scénariste, elles sont dîtes avec trop d'application (la télé a horreur de tout ce qui n'est pas parfaitement lisible ou audible, il n'est donc pas étonnant que tout cela semble manquer de vie). Sans être abominable, la mise en scène, répétitive, ne parvient jamais à faire monter une quelconque tension, la désamorçant par l'humour et repoussant la violence par écran interposé (celui d'un téléphone portable). Il ne peut rien arriver de bien terrible et si la fin est tout de même dramatique, elle n'est là que pour illustrer la morale de l'histoire, faire réfléchir le spectateur mis ainsi à la place des ados à qui l'on vient de donner une grande leçon et qui sauront in fine se retrouver fraternellement. Sans doute aurait-il fallu que ce récit se décolle du réel, propose véritablement une expérience singulière, au lieu de cataloguer tous les problèmes de notre société (même avec humour). Car tout y passe : le racisme, le sexisme, le manque de moyens dans l'éducation, la brutalité policière, les tensions communautaristes, les problèmes de couple, le fossé des générations, la pression médiatique, l'abrutissement par la télévision, les viols filmés au portable, la suffisance ministérielle... De la distanciation, de la cruauté, de l'invention plastique, voilà, entre autres choses, ce qui manque à La journée de la jupe, puisque, le thème de la réversibilité du statut de victime aidant, il semble que le vague modèle du film soit le Dogville de Lars von Trier. Enfin, disons que les comédiens ne sont pas vraiment en cause et qu'Adjani, une nouvelle fois (rappelez-vous La repentie), se rate, mais au moins, elle se rate corps et âme.
Un peu désarmé devant ce téléfilm qui m'a tenu jusqu'au bout mais qui ne me parle absolument pas. Isabelle Adjani y joue une prof de français à bout de nerf prenant en otage sa classe de collégiens agités. L'invraisemblance du postulat semble tout d'abord bien assumée puisque l'on croit se diriger vers un huis-clos fortement théâtralisé et se détachant petit à petit du réel. Malheureusement nous ne sommes pas au théâtre, mais à la télévision et la machinerie de la fiction à la française prend vite le dessus, traitant également ce qui se passe à l'extérieur des murs : vignettes humoristiques consacrées au personnel enseignant, emballement médiatique et tractations avec le RAID, dirigé par un improbable Denis Podalydès. Le film se veut tragi-comique, bousculant le politiquement correct. Certes, deux ou trois répliques arrivent à faire sourire, mais toutes les autres tombent à l'eau : elles sentent trop le bon mot de scénariste, elles sont dîtes avec trop d'application (la télé a horreur de tout ce qui n'est pas parfaitement lisible ou audible, il n'est donc pas étonnant que tout cela semble manquer de vie). Sans être abominable, la mise en scène, répétitive, ne parvient jamais à faire monter une quelconque tension, la désamorçant par l'humour et repoussant la violence par écran interposé (celui d'un téléphone portable). Il ne peut rien arriver de bien terrible et si la fin est tout de même dramatique, elle n'est là que pour illustrer la morale de l'histoire, faire réfléchir le spectateur mis ainsi à la place des ados à qui l'on vient de donner une grande leçon et qui sauront in fine se retrouver fraternellement. Sans doute aurait-il fallu que ce récit se décolle du réel, propose véritablement une expérience singulière, au lieu de cataloguer tous les problèmes de notre société (même avec humour). Car tout y passe : le racisme, le sexisme, le manque de moyens dans l'éducation, la brutalité policière, les tensions communautaristes, les problèmes de couple, le fossé des générations, la pression médiatique, l'abrutissement par la télévision, les viols filmés au portable, la suffisance ministérielle... De la distanciation, de la cruauté, de l'invention plastique, voilà, entre autres choses, ce qui manque à La journée de la jupe, puisque, le thème de la réversibilité du statut de victime aidant, il semble que le vague modèle du film soit le Dogville de Lars von Trier. Enfin, disons que les comédiens ne sont pas vraiment en cause et qu'Adjani, une nouvelle fois (rappelez-vous La repentie), se rate, mais au moins, elle se rate corps et âme. L'affaire était mal engagée : une bande annonce à faire fuir ("Par le réalisateur de Will Hunting" claironne le distributeur, conscient que les amateurs de Van Sant vont, de toute manière, aller voir le film et qu'il faut cibler plutôt ceux qui ne connaissent que ses travaux hollywoodiens), une affiche moche, la lecture en biais, sur mes supports papiers favoris, de deux ou trois articles positifs mais étrangement mollassons et, pour enfoncer le clou, un double assassinat, chez le
L'affaire était mal engagée : une bande annonce à faire fuir ("Par le réalisateur de Will Hunting" claironne le distributeur, conscient que les amateurs de Van Sant vont, de toute manière, aller voir le film et qu'il faut cibler plutôt ceux qui ne connaissent que ses travaux hollywoodiens), une affiche moche, la lecture en biais, sur mes supports papiers favoris, de deux ou trois articles positifs mais étrangement mollassons et, pour enfoncer le clou, un double assassinat, chez le  Près de deux ans après sa séléction officielle au festival de Cannes, où il fut plutôt mal reçu (ce qui explique assurément ce décalage), nous pouvons enfin nous frotter depuis janvier au deuxième long métrage de fiction d'Ulrich Seidl, cet Import Export qui vient après un
Près de deux ans après sa séléction officielle au festival de Cannes, où il fut plutôt mal reçu (ce qui explique assurément ce décalage), nous pouvons enfin nous frotter depuis janvier au deuxième long métrage de fiction d'Ulrich Seidl, cet Import Export qui vient après un  En nous collant d'entrée à la roue de Beto, père de famille uruguayen vivant de la contrebande transfrontalière cycliste et quotidienne de divers denrées, de manière attentive et empathique, les co-réalisateurs des Toilettes du Pape (El baño del Papa), César Charlone et Enrique Fernandez, nous mènent moins vers De Sica et son voleur de bicyclette que vers Ken Loach, celui des comédies graves et des petites victoires dans la défaite. Oeuvrant au sein d'une cinématographie des plus discrètes bien qu'ayant déjà donné naissance à au moins un coup d'éclat (Whisky de Juan Pablo Rebella et Pablo Stoll en 2004), les cinéastes arrivent avec ce premier long-métrage à faire naître chez le spectateur un peu plus que l'inévitable sympathie (parfois condescendante) qu'entraîne un tel effort.
En nous collant d'entrée à la roue de Beto, père de famille uruguayen vivant de la contrebande transfrontalière cycliste et quotidienne de divers denrées, de manière attentive et empathique, les co-réalisateurs des Toilettes du Pape (El baño del Papa), César Charlone et Enrique Fernandez, nous mènent moins vers De Sica et son voleur de bicyclette que vers Ken Loach, celui des comédies graves et des petites victoires dans la défaite. Oeuvrant au sein d'une cinématographie des plus discrètes bien qu'ayant déjà donné naissance à au moins un coup d'éclat (Whisky de Juan Pablo Rebella et Pablo Stoll en 2004), les cinéastes arrivent avec ce premier long-métrage à faire naître chez le spectateur un peu plus que l'inévitable sympathie (parfois condescendante) qu'entraîne un tel effort.