(Jacques Tati / Suède - France / 1974 & Jacques Tati et Sophie Tatischeff / France / 1978-2000)
■□□□ /■■□□
Pour finir notre mini-cycle Tati, jetons un coup d'oeil sur les deux points de suspension qui clôturent l'oeuvre après Trafic (1971).
 Bien que le dernier long-métrage de Jacques Tati ait été distribué dans les salles françaises à la fin de l'année 1974, Parade n'est pas un film de cinéma. Il s'agit d'une commande passée par la télévision publique suédoise, consistant à capter en vidéo un spectacle de cirque.
Bien que le dernier long-métrage de Jacques Tati ait été distribué dans les salles françaises à la fin de l'année 1974, Parade n'est pas un film de cinéma. Il s'agit d'une commande passée par la télévision publique suédoise, consistant à capter en vidéo un spectacle de cirque.
Il y a deux façons de juger l'oeuvre. Si l'on opte pour la plus bienveillante, on insistera sur la singularité du projet. Tati, filmant avec quatre caméras pendant trois jours, rend hommage aux spectacles vivants (cirque, music-hall, concerts). A la représentation classique, il intègre pleinement le public, abolissant les frontières entre gradins, scène et coulisses et montrant que des spectateurs ou des ouvriers peuvent devenir tout naturellement des artistes, magiciens ou acrobates. Plusieurs plans sont d'ailleurs cadrés depuis le fond du décor, de manière à avoir le public à l'image. A côté de cette perméabilité des univers qui permet un spectacle total, on retrouve un autre thème récurrent : l'enfance. Une petit garçon et une petite fille dans le public sont deux des "héros" du film. Après le spectacle, une fois les gradins et la piste désertés, Tati les laisse prendre possession des lieux, assurant ainsi le passage de témoin. Voilà pour la politique de l'auteur.
Si l'on s'attache maintenant à ce qui se passe réellement sur l'écran pendant 1h25, le résultat n'est pas très captivant. Tati-acteur est dans la peau du Monsieur Loyal. Il n'est cependant au centre que d'une poignée de séquences, toutes de mime sportif (gardien de but, tennisman, boxeur...), exercice qui fit sa réputation à ses débuts au music-hall. La succession des numéros des autres artistes n'échappe pas à la règle du genre : l'inégalité. De jongles impressionnants, on passe à un pénible rodéo avec une mule et avant un savoureux concerto burlesque par trois vieux musiciens, on supporte un languissant intermède musical.
Dans l'esprit du cinéaste, ce spectacle se veut démocratique, au sens où tout le monde peut en être l'un des acteurs. Louable intention, contredite cependant par plusieurs choses. D'une part c'est bien lui Tati, le metteur en scène, le Mr Loyal et la star du show, que l'on vient voir. D'autre part, les intervenants descendant des gradins sont de manière bien trop évidente des professionnels. Que l'on ne s'y trompe pas, même avec tous ces jeunes spectateurs suédois peace and love, Parade n'est pas un happening.
Pressé par le temps et serré par son budget, Tati ne peut pas peaufiner tous les gags comme à son habitude et certains sont mal mis en valeur par le cadre et la photo. Le son, si important ailleurs, se réduit le plus souvent à quelques bruitages et au vacarme de l'audience. Le film n'est donc ni très rigoureux, ni très naturel.
Parade était sans doute en 1974 une bonne émission de télévision. Mais même à l'époque, cela ne suffisait certainement pas à en faire un bon film.
 Plus intéressant est le documentaire tourné en 1978, à la demande de Gilbert Trigano. Celui-ci proposa à Tati d'immortaliser la journée du 26 avril où Bastia affrontait les Hollandais du PSV Eindhoven, en match aller de la finale de coupe de l'UEFA. Oubliées dans une cave pendant des années, les bobines du film furent restaurées et montées par Sophie Tatischeff, fille du réalisateur, en 2000, pour aboutir à ce Forza Bastia de 26 minutes.
Plus intéressant est le documentaire tourné en 1978, à la demande de Gilbert Trigano. Celui-ci proposa à Tati d'immortaliser la journée du 26 avril où Bastia affrontait les Hollandais du PSV Eindhoven, en match aller de la finale de coupe de l'UEFA. Oubliées dans une cave pendant des années, les bobines du film furent restaurées et montées par Sophie Tatischeff, fille du réalisateur, en 2000, pour aboutir à ce Forza Bastia de 26 minutes.
On suit d'abord les préparatifs de la fête, les déambulations des supporters et la transformation de toute une ville en blanc et bleu. Les images d'une population en liesse sont des plus classiques mais elles sont rendues assez touchantes par le passage du temps et réhaussées par le regard légèrement décalé de Tati qui, de façon impressionniste, aime s'attarder sur une vieille dame, une petite fille ou un chien. Pour que le film décolle véritablement, il faut un coup de pouce du destin. Il arrive sous la forme d'un violent orage. Un déluge s'abat sur Bastia, douchant l'enthousiasme des supporters dans le stade et rendant le terrain impraticable.
Tout le film semble alors suivre les hauts et les bas par lesquels passe le public : l'inquiétude, les encouragements et les silences. Armé de balais, de seaux ou de sacs de sable, on tente désespérément de redonner à la mare aux canards l'allure d'un terrain de foot. Après de longues discussions entre officiels, le coup d'envoi peut finalement être donné (la télévision, déjà en 1978, semble dicter ses impératifs), mais la fête commence à avoir un drôle de goût. Du match, nous ne voyons que des jambes pataugeant dans la boue. Tati préfère braquer ses caméras sur les supporters, filmer les réactions d'un public de plus en plus stressé. Au bout de 90 minutes dantesques, les locaux ne pourront faire mieux qu'un frustrant 0-0.
De la matinée joyeuse et ensoleillée, nous sommes passé à la tristesse d'une nuit humide. Le film n'a pas besoin de dire la suite : quinze jours plus tard, Eindhoven gagnait le match retour 3-0 et brisait les espoirs français de sacre européen.
P.S. 1 : Merci beaucoup à Michèle et à Joachim pour les prêts de dvd.
P.S. 2 : Après avoir vu les quatre longs-métrages avec lui (j'ai volontairement évité, je le rappelle, Playtime et Trafic), voici les préférences de mon fiston de 6 ans, "du plus rigolo au moins drôle" : 1- Jour de fête, 2- Les vacances de Mr Hulot, 3- Parade, 4- Mon oncle. Si vous êtes parents, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire...
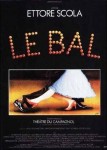 Bien que je sois incapable d'émettre un jugement sur Le bald'Ettore Scola, compte tenu de l'éloignement, ce film m'est cher pour deux raisons. Tout d'abord, lorsque je vois cette affiche, je la vois au mur du cinéma que je fréquentais alors, celui de Nontron (24300, sous-préfecture de la Dordogne, 3400 habitants). C'est dans cette salle, la plus près de mon chez moi d'adolescent, dans la campagne périgourdine, que j'ai réellement découvert le cinéma. L'année de mes 12 ans, Le baly avait été programmé (peut-être même deux fois, la seconde, début 1984, à l'occasion d'une sortie post-Césars d'où Scola était reparti avec les prix du Meilleur réalisateur et du Meilleur film, ex-aequo avec A nos amours) et je revois très bien ce film annoncé dans le dépliant-programme. La deuxième raison est qu'il s'agit de l'un des films préférés de mon père qui, bien que n'étant pas cinéphile, pouvait s'enticher à l'époque de quelques oeuvres à la fois populaires et suffisamment originales, comme Apocalypse now ou Il était une fois en Amérique (rappelons que Scola balayait ici cinquante ans d'histoire sans sortir d'une salle de bal et sans laisser prononcer un seul mot pas ses personnages).
Bien que je sois incapable d'émettre un jugement sur Le bald'Ettore Scola, compte tenu de l'éloignement, ce film m'est cher pour deux raisons. Tout d'abord, lorsque je vois cette affiche, je la vois au mur du cinéma que je fréquentais alors, celui de Nontron (24300, sous-préfecture de la Dordogne, 3400 habitants). C'est dans cette salle, la plus près de mon chez moi d'adolescent, dans la campagne périgourdine, que j'ai réellement découvert le cinéma. L'année de mes 12 ans, Le baly avait été programmé (peut-être même deux fois, la seconde, début 1984, à l'occasion d'une sortie post-Césars d'où Scola était reparti avec les prix du Meilleur réalisateur et du Meilleur film, ex-aequo avec A nos amours) et je revois très bien ce film annoncé dans le dépliant-programme. La deuxième raison est qu'il s'agit de l'un des films préférés de mon père qui, bien que n'étant pas cinéphile, pouvait s'enticher à l'époque de quelques oeuvres à la fois populaires et suffisamment originales, comme Apocalypse now ou Il était une fois en Amérique (rappelons que Scola balayait ici cinquante ans d'histoire sans sortir d'une salle de bal et sans laisser prononcer un seul mot pas ses personnages).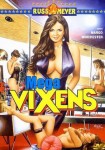 Combat de poids lourds au rayon érotisme : Walerian Borowczyk, lâché film après film par ses défenseurs, proposait un Art d'aimerqui ne semblât pas regarnir ses troupes et Russ Meyer qui, lui, connaissait plutôt une apothéose critique et publique avant de décliner par la suite (l'évolution de sa carrière dessinant ainsi une courbe logiquement mammaire), nous mettait sous le nez ses Megavixens.
Combat de poids lourds au rayon érotisme : Walerian Borowczyk, lâché film après film par ses défenseurs, proposait un Art d'aimerqui ne semblât pas regarnir ses troupes et Russ Meyer qui, lui, connaissait plutôt une apothéose critique et publique avant de décliner par la suite (l'évolution de sa carrière dessinant ainsi une courbe logiquement mammaire), nous mettait sous le nez ses Megavixens.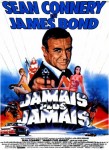 Mieux vaut finir ce panorama avec quelques oublis des mois précédents. En Octobre était sorti l'un des films les plus réputés du grand Raoul Ruiz (voir plus bas), Les trois couronnes du matelot. En novembre, la guerre des Bond battait son plein : quelques semaines après Roger Moore dans Octopussy, Sean Connery retrouvait le costume de 007 dans Jamais plus jamais(pratiquement pas de souvenir de cet épisode-là, mais le nom de son réalisateur, Irvin Kershner, auteur de quelques films personnels et solide artisan au service de la grosse machine hollywoodienne comme avec le deuxième et le meilleur Star wars, est généralement gage de qualité). J'ai également oublié de mentionner le mois dernier les sorties de Erendira(fable sud-américaine qui m'a passablement ennuyé il y a quelques années, pourtant signée Ruy Guerra), de Vassa(de Gleb Panfilov, cinéaste russe, auteur notamment du très beau Thème) et de Quand faut y aller, faut y aller, énième ânerie troussée pour Terence Hill et Bud Spencer, que j'avais adoré à l'époque.
Mieux vaut finir ce panorama avec quelques oublis des mois précédents. En Octobre était sorti l'un des films les plus réputés du grand Raoul Ruiz (voir plus bas), Les trois couronnes du matelot. En novembre, la guerre des Bond battait son plein : quelques semaines après Roger Moore dans Octopussy, Sean Connery retrouvait le costume de 007 dans Jamais plus jamais(pratiquement pas de souvenir de cet épisode-là, mais le nom de son réalisateur, Irvin Kershner, auteur de quelques films personnels et solide artisan au service de la grosse machine hollywoodienne comme avec le deuxième et le meilleur Star wars, est généralement gage de qualité). J'ai également oublié de mentionner le mois dernier les sorties de Erendira(fable sud-américaine qui m'a passablement ennuyé il y a quelques années, pourtant signée Ruy Guerra), de Vassa(de Gleb Panfilov, cinéaste russe, auteur notamment du très beau Thème) et de Quand faut y aller, faut y aller, énième ânerie troussée pour Terence Hill et Bud Spencer, que j'avais adoré à l'époque.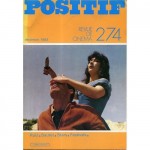 Lorsque le mois arrivant n'annonce rien de très palpitant, les revues de cinéma ont le choix entre trois solutions (seule Cinéma 83(300) met en vedette Jean-Claude Brialy). Possibilité n°1 : se plonger dans un passé méconnu. Ainsi, pour les Cahiers du Cinéma (354), le meilleur film du mois est Les anges du boulevard, classique du cinéma chinois des années 30, réalisé par Yuan Muzhi et resté inédit en France jusqu'alors. Possibilité n°2 : revenir sur des films déjà à l'affiche. La Revue du cinéma(389) parle de Pialat et de Sautet, en mettant Garçon ! en couverture. Starfix(10) fête le retour de Sean Connery. Possibilité n°3 : se projeter vers l'avenir. Cinématographe(95) titre joliment "En attendant Godard" (puisque Dieu allait redescendre parmi nous en janvier 84 et nous offrir Prénom Carmen). Dans un autre registre, Premiere (81) va voir les stars en plein désert, sur le tournage de Fort Saganne. Comme Depardieu vient de faire leur dernière une (avec Les compères), c'est Sophie Marceau qui s'y colle. Il y a en fait une autre possibilité : choisir un cinéaste qui fait toujours l'actualité, un cinéaste avec qui l'on s'entretient en ayant à chaque fois deux films de retard sur lui. Par exemple, Raoul Ruiz. Profitant de la sortie récente des Trois couronnes du matelot, de celle imminente de La ville des pirates et de bien d'autres projets en cours, Positif (274) propose un entretien fleuve avec le réalisateur chilien exilé en France, agrémenté de plusieurs études, six mois à peine après un numéro spécial des Cahiers du Cinéma déja imposant.
Lorsque le mois arrivant n'annonce rien de très palpitant, les revues de cinéma ont le choix entre trois solutions (seule Cinéma 83(300) met en vedette Jean-Claude Brialy). Possibilité n°1 : se plonger dans un passé méconnu. Ainsi, pour les Cahiers du Cinéma (354), le meilleur film du mois est Les anges du boulevard, classique du cinéma chinois des années 30, réalisé par Yuan Muzhi et resté inédit en France jusqu'alors. Possibilité n°2 : revenir sur des films déjà à l'affiche. La Revue du cinéma(389) parle de Pialat et de Sautet, en mettant Garçon ! en couverture. Starfix(10) fête le retour de Sean Connery. Possibilité n°3 : se projeter vers l'avenir. Cinématographe(95) titre joliment "En attendant Godard" (puisque Dieu allait redescendre parmi nous en janvier 84 et nous offrir Prénom Carmen). Dans un autre registre, Premiere (81) va voir les stars en plein désert, sur le tournage de Fort Saganne. Comme Depardieu vient de faire leur dernière une (avec Les compères), c'est Sophie Marceau qui s'y colle. Il y a en fait une autre possibilité : choisir un cinéaste qui fait toujours l'actualité, un cinéaste avec qui l'on s'entretient en ayant à chaque fois deux films de retard sur lui. Par exemple, Raoul Ruiz. Profitant de la sortie récente des Trois couronnes du matelot, de celle imminente de La ville des pirates et de bien d'autres projets en cours, Positif (274) propose un entretien fleuve avec le réalisateur chilien exilé en France, agrémenté de plusieurs études, six mois à peine après un numéro spécial des Cahiers du Cinéma déja imposant.

 En une seule nuit, de la tombée du jour au petit matin, le jeune George La Main traverse une série d'épreuves qui le font basculer douloureusement de l'adolescence à l'âge adulte. Un traumatisme, un désir inextinguible de vengeance, une histoire d'amour et une autre d'amitié trahie : rarement comme dans The big night aura-t-on eu l'impression d'une telle condensation, et ce d'autant plus que le film ne dure que 72 minutes.
En une seule nuit, de la tombée du jour au petit matin, le jeune George La Main traverse une série d'épreuves qui le font basculer douloureusement de l'adolescence à l'âge adulte. Un traumatisme, un désir inextinguible de vengeance, une histoire d'amour et une autre d'amitié trahie : rarement comme dans The big night aura-t-on eu l'impression d'une telle condensation, et ce d'autant plus que le film ne dure que 72 minutes. On trouve ces jours-ci sur le toujours recommandé Inisfree, entre une merveilleuse note autobiographique sur La prisonnière du désertet une brève réjouissante à propos des Monty Pythons, une
On trouve ces jours-ci sur le toujours recommandé Inisfree, entre une merveilleuse note autobiographique sur La prisonnière du désertet une brève réjouissante à propos des Monty Pythons, une 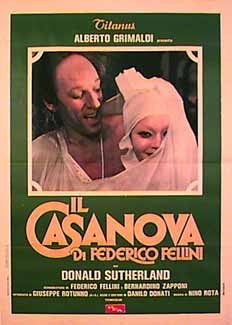
 Vivant avec sa grande soeur et sa mère dans une petite ville de Pologne, le jeune garçon Stefek traverse la pause estivale en observant son petit monde, en jouant avec le hasard et en se persuadant que son père absent depuis si longtemps est bien là, sur le quai de la gare, et pourrait lui revenir. Un conte d'été polonais (Sztuczki) est basé sur une suite de courtes scènes impressionnistes, souvent humoristiques et sensuelles. Andrzej Jakimowski (réalisateur, producteur et scénariste) place un enfant au centre de son récit, mais de Stefek à la moindre silhouette de clochard, chaque personnage du film, quelque soit son importance, trouve sa place dans un bel équilibre. Le cadre ouvert (pratiquement toutes les scènes se passent en extérieurs) est cependant restreint à la bourgade, ce qui nous épargne les arabesques parfois fatigantes du film d'auteur choral contemporain.
Vivant avec sa grande soeur et sa mère dans une petite ville de Pologne, le jeune garçon Stefek traverse la pause estivale en observant son petit monde, en jouant avec le hasard et en se persuadant que son père absent depuis si longtemps est bien là, sur le quai de la gare, et pourrait lui revenir. Un conte d'été polonais (Sztuczki) est basé sur une suite de courtes scènes impressionnistes, souvent humoristiques et sensuelles. Andrzej Jakimowski (réalisateur, producteur et scénariste) place un enfant au centre de son récit, mais de Stefek à la moindre silhouette de clochard, chaque personnage du film, quelque soit son importance, trouve sa place dans un bel équilibre. Le cadre ouvert (pratiquement toutes les scènes se passent en extérieurs) est cependant restreint à la bourgade, ce qui nous épargne les arabesques parfois fatigantes du film d'auteur choral contemporain.



 Andrzej Wajda souhaitait réaliser ce film sur les
Andrzej Wajda souhaitait réaliser ce film sur les