
Wes Anderson n'est pas un cinéaste, c'est un maquettiste. Et Moonrise Kingdom n'est pas un film, c'est une maison de poupée. Il n'est pas rare, le long de ses quatre-vingt-quinze minutes, de tomber sur un plan donnant l'impression d'un modèle réduit, alors que le décor est manifestement à taille réelle, que des acteurs s'y déplacent. Cela vaut même pour certains extérieurs, les contours y étant si bien taillés que la vie paraît avoir déserté. Belle cohérence cinématographique me dira-t-on, en avançant les notions d'univers personnel, de bande dessiné et d'animation. Personnellement, je vois surtout à ce fait esthétique deux conséquences : un rapetissement et une mécanisation.
Tout ce que touche Wes Anderson, il le miniaturise. Il raconte des petites histoires, ne filme que des petits riens, s'émeut de petits malheurs, procure de petites émotions. Réduits eux aussi, les objets peuvent s'accumuler dans le cadre tout en étant parfaitement disposés. Ce sont, la plupart du temps, des emblèmes renvoyant à une époque passée et rêvée. Un objet pourrait symboliser ce cinéma-là : le fanion, ce petit drapeau que l'on s'échange lors des rencontres sportives, bout de tissu daté du jour et pourtant totalement désuet.
Tout ce que filme Wes Anderson, il le mécanise. Une poignée de minutes seulement, le récit devient un petit peu prenant. Lors de l'arrivée dans le camp du cousin Ben, l'agitation donne d'abord de la vigueur, puis un beau et long ralenti produit une rupture rythmique libérant enfin une pointe d'émotion. L'élan du cœur est accompagné dans sa durée et non, comme ailleurs, mis à distance, décalé ou aussitôt effacé par le découpage. Mais plus encore que le récit, faussement alerte, ce sont les personnages qui souffrent de cette mécanisation. Comme d'habitude chez notre cinéaste-chineur, ils sont caractérisés par un habit qu'ils ne quittent pas ou bien par un objet dont ils ne se séparent jamais. On insiste donc cette fois-ci sur des lunettes, des jumelles, un mégaphone... Le but est de provoquer le rire et la poésie, en même temps ou alternativement. Devant ce "comique" de répétition, j'ai surtout bâillé.
A propos de personnages, je remarque autre chose. Celui interprété par Tilda Swinton se présente lui-même de la façon suivante : "I'm Social Services". Cette femme ne porte pas de nom. Et les autres pourraient tout aussi bien être désignés comme "le sheriff", "le garçon", "la fille"... Comment s'attacher à ce groupe de marionnettes ? Comment s'émouvoir d'une décision pleine de bienveillance comme celle que prend finalement le sheriff alors que celui-ci n'est qu'un (in)signe inamovible ?
Ces figurines peuplent un monde étroit et fermé sur lui-même. En dehors du cadre de la caméra de Wes Anderson, rien n'existe. Pas étonnant qu'il ne filme que des maisons, des camps, des criques et des îles. Quant au maniement de l'ellipse, il n'intervient que comme clin d'œil. Tel est le cas dans la séquence de confrontation en sous-bois, pastiche du cinéma de Tarantino. Voilà une référence étonnante puisque déboulant dans un film supposé célébrer les retrouvailles avec l'innocence enfantine. Peu importe, l'enfance n'est ici qu'apparence. Les petits héros de Moonrise Kingdom sont trop bousculés par le découpage "humoristique" du cinéaste pour que leurs attitudes, leurs répliques, leurs sentiments soient réellement ceux de leur âge. Ils ne s'appartiennent pas et c'est bel et bien le marionnettiste qui parle à travers eux.
Enfin, comme il fallait s'y attendre avec cet Auteur, l'escapade se termine sur un happy end et une nouvelle ode à la famille. Les choses rentrent dans l'ordre après la tempête purificatrice et tout est bien bouclé. La maison de poupée se referme. Nous avons profité d'une jolie chanson pop et de couleurs chatoyantes. Nous avons traversé le musée de la miniature, pas dérangé mais l'esprit ailleurs.
****
 MOONRISE KINGDOM
MOONRISE KINGDOM
de Wes Anderson
(Etats-Unis / 95 min / 2012)

 DE ROUILLE ET D'OS
DE ROUILLE ET D'OS
 L'ENFANT D'EN HAUT
L'ENFANT D'EN HAUT
 CECI N'EST PAS UN FILM (In film nist)
CECI N'EST PAS UN FILM (In film nist)
 2 DAYS IN NEW YORK
2 DAYS IN NEW YORK
 DARK SHADOWS
DARK SHADOWS
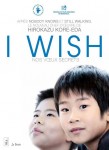 I WISH, NOS VŒUX SECRETS (Kiseki)
I WISH, NOS VŒUX SECRETS (Kiseki)
 BELLFLOWER
BELLFLOWER
 LE POLICIER (Ha-shoter)
LE POLICIER (Ha-shoter)
 LES ADIEUX A LA REINE
LES ADIEUX A LA REINE